Chronique pour tous
 Notre ami Hervé GAUTIER, grand amateur de littérature et auteur de deux romans "Un été Niortais" et "Le rendez-vous de Sainte-Pezenne", nous présente mensuellement un roman ou un film qu’il a aimé et nous fait partager "sa critique".
Notre ami Hervé GAUTIER, grand amateur de littérature et auteur de deux romans "Un été Niortais" et "Le rendez-vous de Sainte-Pezenne", nous présente mensuellement un roman ou un film qu’il a aimé et nous fait partager "sa critique".
Cette initiative a pour but, non seulement d’inciter chacun de nous à lire le livre sélectionné mais aussi à découvrir des auteurs, qui ne sont pas toujours récompensés par des prix littéraires.
Retrouvez en image la chronique de Hervé Gautier
- Quand les portes et les volets sont clos
- L ELOGE DE LA MARATRE - Mario VARGAS LLOSA - Gallimard Edite
- Bristol - Jean Echenoz - Les editions de Minuit. .
- J ai peche, peche dans le plaisir - Abnousse Shalmani - Gras
- Le nom sur le mur - Herve Le Tellier - Gallimard.
- Yasmina Reza - Albin Michel.
- Sur Les chemins noirs - Sylvain Tesson- Gallimard.
- Triste tigre - Neige Sinno - P.O.L.
- PARIS - BRIANCON - Philippe Besson - Juillard.
- Veiller sur elle - Jean-Baptiste Andrea - L iconoclaste.
- Fuir l Eden - Olivier Dorchamps - Finitude.
- Le moine et le venerable - Christian Jacq - Robert Laffont.
- Nous sommes la nuit - Gwenael Le Guellec - Editions Prisma.
- Histoires de la nuit - Laurent Mauvignier
- Ce que faisait ma grand-mere a moitie nue sur le bureau ....
- Ecritures carnassieres - Erve - Editions Maurice Nadeau.
- Le jeune homme - Annie Ernaux - Gallimard.
- Le dimanche des Rameaux - Claire Sainte-Soline - Grasset
- Le sixieme enfant - Un film de Leopold Legrand.
- Terra Alta - Javier Cercas - Actes sud.
- Guerre - Louis-Ferdinand Celine - Gallimard.
- aneantir - michel houellebecq- flammarion.
- Le grand monde - Pierre Lemaitre- Calman Levy.
- Les abeilles grises- Andrei Kourkov - Liliane Levy
- L'amie prodigieuse (enfance-adolescence) - Elena Ferrante.
- Changer-l'eau des fleurs - Valerie Perrin - Albin Michel.
- Premier sang - Amelie Nothomb - Albin Michel.
- La plus secrete memoire des hommes - Mohamed Mbougar Sarr -
- Tuer le fils - Benoit Severac - La manufacture des livres.
- Betty - Tiffany Mc Daniel - Gallmeister.
- L'age du doute - Andrea Camilleri - Fleuve Noir
- Clair de femme - Romain Gary - Gallimard.
- Le desert des Tartares - Dino Buzzati - Robert Laffont.
- Le banquet annuel de la confrerie des fossoyeurs Mathias En
- L'Anomalie Herve Le Tellier Gallimard (Prix Goncourt 2020)
- Glace - Bernard Minier - Pocket
- L'enfer du commissaire Ricciardi - Maurizio de Giovanni
- Tous les hommes n' habitent pas le monde de la meme facon
- Un bel morir - Alvaro Mutis - Grasset.
- L arrache-coeur - Boris Vian - Editions Jacques Pauvert.
- Les attentifs - Marc Mauguin - Robert Laffont.
- La nuit, le jour et toutes les autres nuits - Michel Audiard
- La Mere Lapipe dans son bistrot - Pierrick Bourgault
- Ne d'aucune femme - Franck Bouysse La manufacture de livre
- Livre(s) de l'inquietude - Fernando Pessoa.
- Mamie Luger Benoit Philippon-Editions Equinox-Les ArEnes
- Serotonine Michel Houellebecq (Flammarion)
- L'euphorie des places de marché Christophe Carlier
- La vérité sur l'affaire Harry Quebert Joël Dicker
- La vie automatique Christian Oster (Éditions de l'Olivier)
- Amok Stefan Zweig (Stock)
- Elsa mon amour - Simonetta Greggio (Flammarion)
- Les chasseurs dans la neige J-Yves Laurichesse (HDougier)
- Dora Bruder Patrick Modiano (Gallimard)
- Un homme - Philip Roth (Gallimard)
- W ou le souvenir d'enfance Georges Perec (Denoël-1975)
- L'ordre du jour - Eric Vuillard (Actes sud) Prix Goncourt 2
- Les chaussures italiennes Henning Mankell (ed. Seuil)
- Les belles endormies Yasunari Kawabata (A Michel)
- Giboulées de soleil - Lenka Hornnakova-Civade (Alma Éditeur)
- Les étoiles s'éteignent à l'aube Richard Wagamese (Zoé)
- La symphonie du hasard (1) Douglas Kennedy Belfond
- La disparue de Saint-Maur - JChristophe Portes (City éd.)
- Dulmaa Hubert François (Éd. Thierry Marchaisse)
- La complainte du paresseux Sam Savage (Actes Sud)
- Les rêveuses Frédéric Verger (Ed. Gallimard)
- Où j'ai laissé mon âme Jérôme Ferrari (Actes sud)
- Rien Emmanuel Venet (Éd. Verdier)
- Une étrange affaire au bureau des hypothèques -J Chesneau
- Chanson douce Leïla Slimani (Ed. Gallimard, Goncourt 2016)
- Nouvelles inquiètes Dino Buzzati (Ed. Robert Laffont)
- Otages intimes - Jeanne Benameur (Actes Sud)
- La honte Annie Ernaux (Gallimard)
- Le voyant - Jérôme Garcin (Gallimard)
- En finir avec Eddy Bellegueule Édouard Louis (Seuil)
- Je dirai malgré tout que cette vie fut belle - J d'Ormesson
- Olype de Gouges Catel & Bocquet (Casterman écritures)
- BILQISS Saphia Azzeddine - Stock
- LE BAR SOUS LA MER Stefano BENNI Actes Sud
- DANS LES BOIS ETERNELS Fred Vargas (Ed. Viviane Hamy)
- TRAITE SUR LA TOLERANCE - Voltaire (Gallimard)
- Boussole Mathias Enard (Actes Sud)
- NAGER - Richard Texier (Gallimard)
- Le poids du papillon - Erri de Luca (Gallimard-Feltrinelli)
- L'arrière saison Philippe Besson (Juillard)
- La boule noire Georges Simenon (Le livre de Poche)
- En attendant Robert Capa - Suzanne FORTES (H d'Ormesson)
- Pas Pleurer - Lydie Salvayre (Goncourt 2014)
- Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier P. Modiano
- Murmurer à l'oreille des femmes - Douglas Kennedy (Belfond)
- Barbe Bleue Amélie NOTHOMB (Albin Michel)
- Lulu femme nue - Etienne Davodeau - Futuropolis (B.D.)
- Oscar et la Dame rose - Eric Emmanuel Schmitt
- Les creux de maisons - E Pérochon (Ed. du Rocher)
- Au revoir la haut - Pierre LEMAITRE (A Michel-Goncourt 2013)
- Cheval de guerre- Michael Morpurgo (Folio Junior)
- Le pigeon - Patrick SÜSKIND FAYARD.(1987)
- 14 - Jean Echenoz Éditions de Minuit
- Blood Ties Un film de Guillaume CANET
- Bleus horizons Jérôme GARCIN (Ed. Gallimard)
- Les Pays Marie-Hélène LAFON (Ed. Buchet Chastel)
- Berthe Morisot, le secret de la femme en noir D BONA
- L'année du volcan - Jean-François PAROT - JC LATTES
- L'oubli est la ruse du diable Max Gallo (XO Éditions)
- Le chapeau de Mitterrand Antoine LAURAIN (Flammarion)
- CELINE Henri GODARD (Ed. Gallimard)
- GALA - Dominique BONA (Flammarion 1995)
- Amour - Michael HANAKE - Palme d'Or Cannes 2012
- Le Rapport de Brodeck Philippe CLAUDEL (Stock)
- La dactylographe de Mr James Michel Heyns (Ed. Ph Rey)
- Chien du Heaume - Justine NIOGRET (Mnémos éditions)
- CODE 1879 - Dan WADDELL (Éditions Rouergue noir)
- La vie est belle - Un film de et avec Roberto BENIGNI (1997)
- Rien ne s'oppose à la nuit - Delphine de VIGAN - JC LATTES
- Maman - Un film d'Alexandra LECLERE
- Le crabe-tambour Un film de Pierre SHOENDOERFFER (1977)
- Un magistrat en guerre contre le nazisme - D TANTIN
- Les Enfants du Marais Un film de Jean BECKER (1999)
- Valentine Pacquault Gaston CHERAU (Plon, 1921)
- L'île des chasseurs d'oiseaux (Peter MAY Rouergue NOIR)
- Meurtres sur le fleuve jaune - Frédéric LENORMAND (Fayard)
- Le cadavre anglais Jean-François PAROT JC LATTES
- La fête des pères - Hervé GAUTIER
- Les patins - Hervé GAUTIER
- La baronne meurt à cinq heures - F. LENORMAND - JC. LATTÈS
- Ni à vendre ni à louer Un film de Pascal RABATÉ
- Les Clés de Saint-Pierre - Roger PEYREFITTE (Flammarion)
- Le Marin à l'ancre - Bernard GIRAUDEAU (Ed. Métailié)
- Je suis une force qui va ! et je serai celui-là ! - V. HUGO
- L'écluse des inutiles - Jean-François POCENTEK
- Des hommes et des dieux - Xavier BEAUVAIS
- La carte et le territoire - Michel HOUELLEBECQ
- Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants M. ENARD
Quand les portes et les volets sont clos
Quand les portes et les volets sont clos - Marie-Christine Renaudeau – Hello Éditions.
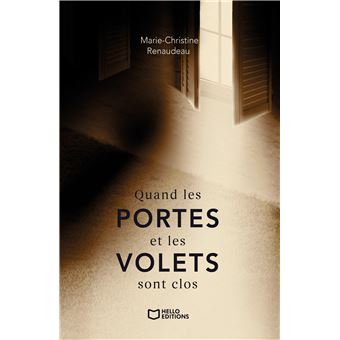
Le titre donne la dimension intimiste et la 4° de couverture le contexte de ce récit autobiographique où l’auteure narre par le menu les phases successives de sa relation à la fois enthousiaste au début, puis de plus en plus conflictuelle avec cet homme devenu son mari. Cette « femme du boulanger », pourtant reconnue comme une battante a dû supporter pendant des années les vexations, humiliations, mensonges, trahisons, viols conjugaux, adultères, souffrances avant qu’il n’en vienne aux coups, dans le seul espoir d’avoir un enfant avec lui et de le voir redevenir comme avant. Au fil des pages on loue sa patience, on déplore la domination de son conjoint qui entretient sa culpabilisation constante, son refus de voir l’évidence, mais aussi sa résignation, son silence, son déni, d’autant que celui qui aurait dû la protéger la considère comme la responsable de tout ce qui, à ses yeux, va de travers. En réalité cet homme est alternativement attentionné, gentil, violent, manipulateur, cruel, destructeur. Pourtant la persévérance de l’auteure et surtout le soutien de ses parents, de ses amis, de sa fille, lui ont permis de mener à terme une procédure longue, éprouvante, d’obtenir le divorce et de faire reconnaître son combat par la cour d’Assises et par la collectivité sous la forme d’un Prix. Car c’est bien d’un combat dont il s’agit et ce livre est un témoignage destiné à aider toutes les autres femmes victimes comme elle d’une telle emprise traumatisante. C‘est une victoire sur soi-même, sur le silence et la résignation, un acte de vie, puisque l’auteur au terme de ces années de galère a ouvert une boulangerie à Bordeaux, commerce actuellement vendu, mais son combat continue en faveur des femmes meurtries et elle s’implique personnellement dans ce qui est de plus en plus un problème de société. Toutes choses égales par ailleurs cela évoque le procès de Gisèle Pélicot qui a permis de prendre conscience de l’importance des violences faites aux femmes. Même si les circonstances sont ici différentes, ce genre de faits étaient couverts par le non-dit et même s’ils faisaient l’objet de plaintes, elles étaient auparavant (et même encore maintenant notamment dans l’affaire Inès Mecellem) rarement reçues par la police et donc poursuivies par la justice.
Le phénomène des « femmes battues » n’est pas nouveau et le couple est aussi un lieu de tensions. On l’a longtemps ignoré hypocritement et quand on en parlait c’était à mots couverts voire ironiques, les femmes étaient traditionnellement considérées comme inférieures aux hommes et physiquement moins fortes qu’eux qui estimaient avoir sur elles quelque chose comme un droit non écrit. Les crimes dits « passionnels » sont restés longtemps impunis, puis il y eut une prise de conscience due sans doute à l’évolution de la société.
On s’avisa qu’au cours de l’histoire l’action de certaines d‘entre elles avait été déterminante, que des artistes les avaient célébrées, on créa des associations de sauvegarde et de soutien, des possibilités d’appels anonymes et des structures d’accueil, un ministère, on fit des statistiques, on publia des photos, on fit mine de découvrir que certaines d’entre elles avaient péri dans la plus grande indifférence, on inventa même le mot « féminicide ». Chaque jour qui passe nous met devant une évidence qui pourtant ne date pas d’hier, les communautés humaines sont de plus en plus folles, minées par la violence et perdent chaque jour un peu plus leurs repères, leurs boussoles, leurs valeurs traditionnelles, et que les membres de nos sociétés deviennent de plus en plus agressifs, perpétrant des actes irraisonnés et irraisonnables, même parmi les plus jeunes.
Raconter une telle histoire faite de violences psychologiques et physiques, de silences, d’incompréhensions, d’illusions au sein du couple qui est une sorte de microcosme, n’est pas une chose aisée simplement parce que l’écriture est en elle-même une souffrance et que mettre des mots sur ce qui s’est avéré être un échec conjugal demande du temps, du courage, de la résilience et le résultat n’est pas forcément au rendez-vous de cette démarche d’autant que sa publication n’est pas non plus facile.
C’est moins un exorcisme personnel qu’une invitation à réfléchir sur le mariage qui a longtemps été considéré comme un pilier de la société, sur l’amour conjugal que les plus optimistes font rimer avec « toujours », sur les relations homme-femme au sein du couple.Garder le silence en se disant que ça n’intéressera personne a longtemps été la règle.
Ce livre, écrit dans un style abrupt à la mesure du sujet, met en exergue cette violence qui de plus en plus affecte notre société.
L ELOGE DE LA MARATRE - Mario VARGAS LLOSA - Gallimard Edite
Loin du registre qui a fait sa notoriété, l'auteur explore un univers familial particulier, celui, vu à la fois avec les yeux d'adulte et ceux d'un enfant, d'une femme, non seulement épouse mais aussi maîtresse, en ce qu'elle est la complice active des jeux de l'amour, mais surtout la belle-mère. 
Cette dernière emprunte son lien de parenté au mariage, c'est-à dire qu'elle apparaît un peu par hasard dans la vie de gens qui n'ont rien fait pour la connaître. Elle est souvent l'intruse, le mauvais côté de l'image de la femme. Ici, il s'agit de la marâtre, terme un peu péjoratif qui désigne la deuxième femme du père, souvent plus jeune que lui, à la suite de cette détestable habitude qu'ont les hommes d'épouser, surtout en secondes noces, des femmes-enfants!
Ils puisent en elles leur vitalité retrouvée, la volonté de combattre les affres de la vieillesse qui vient et parfois l'échec de leur premier mariage. Elle est porteuse de symboles mais aussi de promesses qu'elle ne doit pas décevoir. Pour l'enfant, dit « du premier lit »elle remplace la mère disparue ou partie, sans pour autant prendre sa place, bien au contraire. Il l'accueille souvent mal et s'engage entre eux un combat fait de subtiles attaques ou d'affrontements violents peut-être parce que le complexe d'œdipe s'habille ici d'autres apparences, que chacun marque son territoire et tient à ses prérogatives parfois durement acquises.
Mais le titre nous indique qu'il s'agit d'un éloge et donc que vont être battues en brèche les idées reçues que le sujet génère. Il s'agit d'une mise en perspective d'un trio, le père, Don Rigoberto, jouisseur-esthète et fort amoureux de Lucrecia, sa deuxième épouse, marâtre de son fils Alfonso. On pourrait croire qu'il va s'agir du théâtre d'une lutte entre ces trois personnages. D'ailleurs, l'auteur sollicite à la fois la culture et l'attention de son lecteur, par l'évocation qu'il fait de tableaux aussi différents que ceux de Jacob Jordeans, du Titien, de Fra Angélico ou de Fernando de Szyszlo. Les époques et les écoles s'y mélangent, comme le figuratif et l'abstrait.
Vargas Llossa y livre sa lecture de ces œuvres où se retrouve toujours un trio, et, en filigrane, une histoire d'amour. Cet amour est à la fois chaste et jouisseur, emprunt de retenue ou de licence, humain et divin. Le corps de la femme y est alternativement montré et caché, mais aussi joliment évoqué avec des mots choisis. Un troisième personnage vient souvent s'immiscer dans le tableau, soit qu'il y est déjà et parle, soit qu'il en est le commentateur extérieur qui, à la manière du chœur antique traduit pour le lecteur-témoin les pensées de la femme ou se charge de débroussailler le subtil écheveau de ses désirs secrets, oscillant entre lubricité et vertu parce qu' ainsi va la vie et que le plaisir procède de ces deux facettes.
En même temps, la femme, prétexte aux désirs masculins est présentée alternativement comme objet mais aussi comme sujet de l'action amoureuse, à la fois passive et active. L'auteur nous rappelle, à travers ces fables érotico-esthétiques, en réalité de longs poèmes, que l'amour n'est pas un acte bestial, voué à la seule procréation ou à l'assouvissement d'instincts animaux, la démarche, et ce qu'il en résulte est au contraire toute en nuances, faite de prolégomènes et de soins des apparences sans lesquels la séduction spontanée paraît impossible.
En filigrane, je souhaite voir l'image de la mort, pendant de celle de l'amour et qui en est parfois la conséquence comme l'est paradoxalement la vie avec tous les fantasmes inhérents aux relations ambiguës hommes-femmes, mais aussi enfants-adultes.
Je choisis de voir dans ce texte, non un éloge comme l'indique le titre, mais une vengeance subtilement accomplie du beau-fils qui amène habillement sa marâtre à se compromettre et grâce à un écrit anodin, sorte de mise en abyme du livre de Vargas Llosa, à dénoncer l'adultère, à amener son père à se séparer de cette épouse infidèle ainsi démasquée, à le forcer peut-être à rester fidèle à son ancienne épouse, même si, pour cela, il doit perdre sa joie de vivre retrouvée et pénétrer de plain-pied dans la mort.
C'est probablement une manière de retrouver son père et peut-être aussi de le détruire, tant les relations entre les humains sont complexes, faites d'amour et de haine, de luttes et d'apaisements, de sincérité et de mensonge.
Hervé GAUTIER - Avril 2025
Bristol - Jean Echenoz - Les editions de Minuit. .
Bristol, ce n’est ni une ville d’Angleterre, ni un carton d’invitation, ni le nom d’un grand hôtel,mais celui d’un petit homme sans grande envergure, plutôt couleur muraille, obscur producteur de cinéma de son état, dont la journée commence plutôt mal.
En ce matin d’automne parisien l’occupant du cinquième étage de son immeuble vient, dans le plus simple appareil, de se défenestrer. Cela ne le perturbe pas et il passe son chemin parce qu’il a en tête un film dont on comprend très vite qu’il ne figurera pas dans les annales du cinéma d’auteur, une vraie panouille. Nous le retrouverons plus tard dans une séquence amoureuse avec Geneviève, en Afrique pour l’incertain tournage de scènes ratées mais qui mettent en exergue à la fois une imagination fertile quoique incertaine et une opportune volonté de falsification des comptes trop dispendieux au goût de la production. 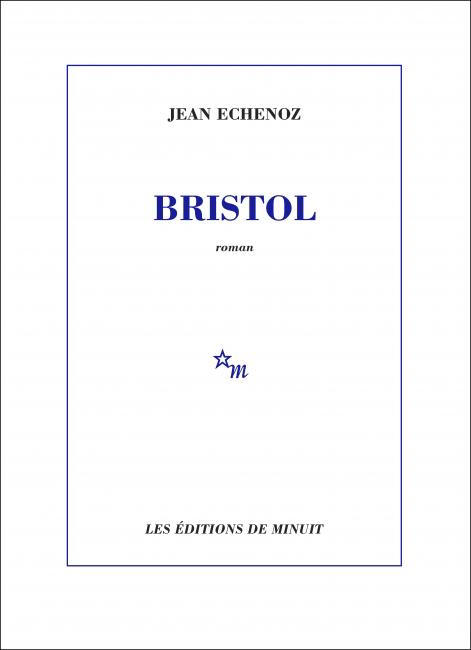
Echenoz aime faire voyager ses personnages. Mais cette affaire bien mystérieuse de défenestration se trouve être le départ, non d’une instruction judiciaire comme on pouvait s’y attendre, mais d’aventures aussi inattendues que entremêlées, d’où il ressort un parfum d’échec, de solitude et de mélancolie déjà ressenti dans ses autres romans.
Il est bien digne de l’Oulipo (ouvroir de littérature potentielle) dont il fut l’invité d’honneur en 2001 tant son style est original. Non seulement son écriture est parfois minimaliste, parfois à ce point précise qu’on peut aisément y voir une volonté de son auteur de pratiquer l’hypotypose qui est l’art de décrire une scène d’une façon tellement réaliste qu’on à l’impression d’y assister au moment même où elle est décrite, ce qui ne l’empêche pas, à l’occasion de multiplier les digressions qui peuvent égarer le lecteur.
Elle emprunte beaucoup au cinéma dans son architecture même, multipliant les « gros plans » exprimés par des formules d’une étonnante précision, parlant du « nacré des cirro-cumulus », du « piqué des infrutescences », mais qui sonnent bien et des images parfois étonnantes voire incongrues qui révèlent une grande richesse de vocabulaire et un sens percutant de la formule. Il pousse même la complicité jusqu’à s’adresser directement à son lecteur, à lui confier ses remarques personnelles! Bref, comme je l’ai déjà dit dans cette chronique, j’aime bien son humour.
Je continue à découvrir l’œuvre d’Echenoz, toujours avec le même plaisir à cause du style, peut-être aussi du suspens et de la faculté qu’il a d’étonner son lecteur, même si ici l’épilogue m’a un peu déçu.
Hervé GAUTIER - Février 2025
J ai peche, peche dans le plaisir - Abnousse Shalmani - Gras
D’abord une rencontre imaginaire, dans le Téhéran des années 50 de Forough Farrolkhzad, 26 ans, divorcée et scandaleuse à cause de sa vie sentimentale et de ses poèmes sensuels et de Cyrus Alir Maziari, un timide étudiant de 20 ans. Il traduit pour elle en persan les poèmes érotiques de Pierre Louÿs inspirés par sa liaison avec Marie de Régnier à la Belle Époque en France.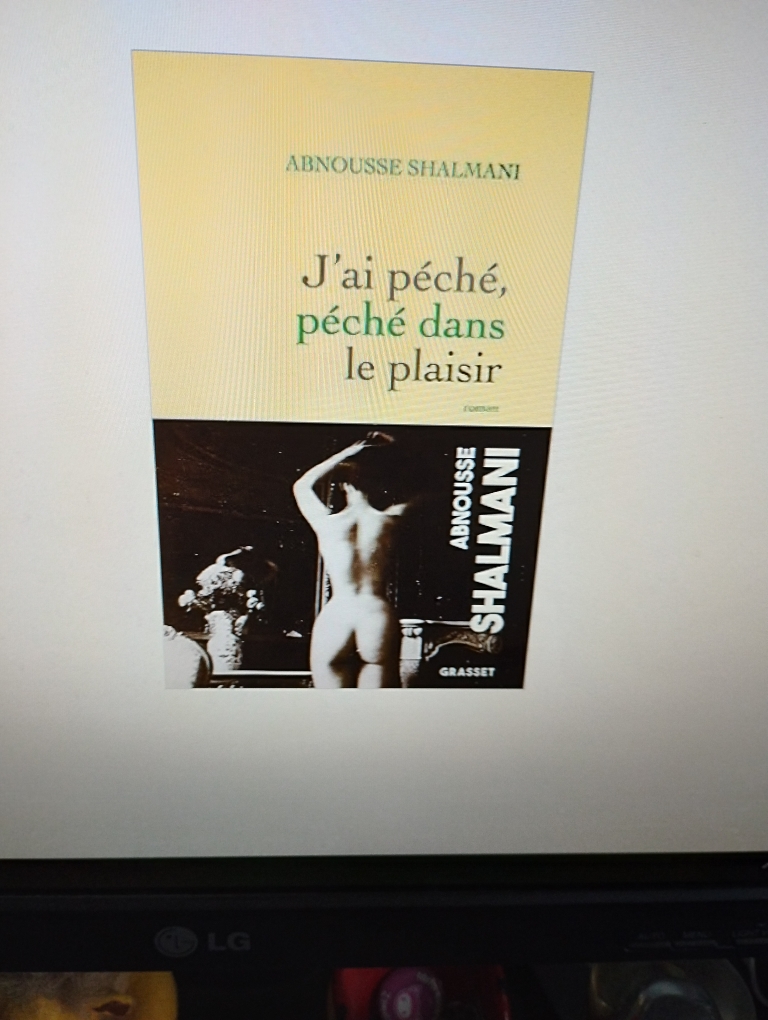
Forough, malgré la morale pesante de son temps et bien que presque tout oppose ces deux femmes, en fait un modèle de vie, un symbole de liberté, s’approprie cette écriture qui la déculpabilise et veut que ses amours ressemblent à celles de Pierre et de Marie face à un Cyrius qui la désire et qui lui délivre son message pour mieux la posséder. Pendant douze ans, ils vont vivre un amour baigné par l’exemple de leurs modèles au point de leur ressembler.
Ce roman met donc en respective deux vies réelles, celle de l’Iranienne Forough Farrolkhzad (1934-1967), poète, actrice, réalisatrice de cinéma et celle de la Française Marie de Régnier (1875-1963), femme de Lettres, fille de José-Maria de Hérédia. Ce rapprochement est réalisé par le miracle de l’écriture romanesque par le truchement de Cyrus, un personnage imaginaire lui aussi, qui raconte à sa maîtresse la vie librement amoureuse et tumultueuse de Marie à qui elle veut de plus en plus ressembler.
Malgré un mariage arrangé pour de basses raisons financières, Marie est amoureuse de Pierre Louÿs (1870-1925), un dandy séducteur, poète et romancieret avec qui elle vivra un amour mouvementé, passionné, fuyant parfois . Elle fixe les limites de ce mariage qui défient les règles sociales de son milieu autant que les convenances, mais correspondent bien à son époque de salons littéraires parisiens, de dîners mondains et de recherche effrénée du plaisir sous toutes ses formes, multipliant les amants, et pas seulement, en face d’un mari complaisant.
L’histoire de Marie et de Pierre rappelle que l’amour fou existe, avec ses moments intenses et ses souffrances, entre bonheur et malheur etqu’unepremière passion ne s’oublie jamais. La vie de Farough est bien différente, animée elle aussi par la passion de la poésie, nourrieau départ par l’amour d’un mari mais qui finit par la décevoir. Après son divorce elle pratique une sensualité déchaînée, la recherche d’une jouissance sans frein ni lendemain, à l’imitation de la tolérance de l’occident, malgré tout le poids d’une société où elle ne se sent pas à sa place et qui couvre d’opprobreles femmes poètes, les femmes libres.
Son aventure romanesque avec Cyrus s’achève, comme sa courte vie par un banal accident mais il reste comme orphelin de Forouhg, partagé entre ses racines persanes et sa vie parisienne, ému par une rencontre avec une Marie vieillissante mais encore belle. Les vies de ces deux femmes se rejoignent dans le bonheur de l’écriture, la recherche effrénée de l’amour et du plaisir, leur rejet d’une société hypocrite, une ode à l‘indépendance et peut-être un certain poids du destin.
Ce roman replonge le lecteur à la fois dans la Belle Époque et dans un Orient qui a toujours fasciné les Européens, dans la vie qui impose son cours, ses épreuves et sa solitude, dans l’acte d’écrire qui s’impose ou se dérobe mais, quand il existe qui reste un jalon souvent plein de nostalgie et de remords.
Bien documenté, plein de sensibilité,de sensualité, ce roman est remarquablement écrit et procure une agréable lecture. Tout au long de près de 200 pages Abnousse Shalmani, de Téhéran à Paris, déroule son parti-pris romanesque, la vie amoureuse de ces deux femmes. J’ai même, mais c’est une interprétation personnelle, aperçu quelques traits communs entre l’auteure et certains personnages de ce roman.
J’ai déjà dit dans cette chronique que je suivais avec intérêt les interventions journalistiques télévisées d’Abnousse Shalmani autant que son parcours créatif. J’ajoute que j’apprécie qu’elle ait choisi la langue française, qu’elle se la soit appropriée, elle, l’Iranienne, arrivée en France à l’âge de huit ans, pour s’exprimer et dérouler une œuvre à laquelle je suis attentif. En ce sens l’immigration est bien une richesse. J’apprécie aussi qu’elle remette en lumière l’amour dans la poésie qui est une forme d’expression délicate et émouvante et spécialement la poésie érotique à travers l’œuvre de Pierre Louÿs, poète quelque peu oublié,la créativité de Marie de Régnier, également un peu négligée par les programmes scolaires et celle de Forough Farrolkhzad, peu connue en France et dont le titre de ce roman s’inspire.
En outre cette œuvre s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel de la reconnaissance de la liberté des femmes face au machisme et de leur droit à disposer de leur corps.Ce roman est à cheval entre l’Orient et l’Occident, avec leurs spécificités morales, culturelles, religieuses, nous donne une autre vision de l’Iran que celle que l’actualité nous délivre.
Il a été couronné cette année par le « Prix Simone Veil » dont un des buts est de mettre en lumière des femmes exceptionnelles quelque peu oubliées et également par le « Prix Gisèle Halimi » qui consacre le combat des femmes pour leur liberté et la lutte pour l’égalité des sexes.
Hervé GAUTIER - Novembre 2024
Le nom sur le mur - Herve Le Tellier - Gallimard.
A la recherche d’une maison en Provence, l’auteur, trouve une vieille bâtisse avec un nom inconnu gravé maladroitement sur le vieux crépis. C’est pour lui le début d’une quête qui le met en présence de quelques photos présentant un jeune homme d’une vingtaine d’années, André, mort en 1944 face aux Allemands et dont le nom figure sur le monument de la commune.
Ces maigres reliques le montrent enlaçant sagement une jeune fille, Simone, et attestent l’avenir qu’elles portent parce que ce qu’on demande avant tout à la vie c’est d’être heureux et qu’à cet âge tout est possible. 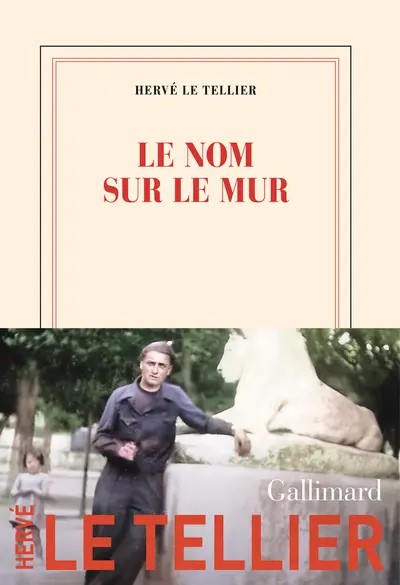
Mais le destin qu’on ignore en a décidé autrement et la vie ne tient pas toutes les promesses auxquelles on fait semblant de croire. André tombera sous les balles ennemies, Simone se mariera plus tard avec un autre mais confiera à sa fille ces fragiles clichés parce que, si la vie continue, le papier glacé a conservé trace de ces moments heureux avec, pour ceux qui restent, un sentiment d’injustice et l’inévitable mais inutile sentiment de culpabilité.
L’auteur ne peut évoquer cette histoire intime sans la remettre dans son contexte historique de l’Occupation, de la guerre, de la Résistance et de la collaboration qui par ailleurs met en évidence le côté sombre de l’être humain ordinaire et en révèle les tristes facettes qu’on se dépêche d’oublier mais que des circonstances « exceptionnelles » suffisent à révéler. Il revient à son sujet à travers l’histoire d’André, destiné au STO eu égard à son âge et qui gagne le maquis. Son engagement patriotique lui sera fatal.
J’ai lu sans désemparer ce livre fort bien écrit non seulement parce qu’il est un témoignage d’autant plus émouvant qu’il est agrémenté de photographies, mais aussi parce qu’il fait revivre, l’espace de quelques dizaines de pages, la mémoire d’un de ceux, anonymes, qui sont morts pour que nous soyons libres. André, figé dans la mort, aura toujours vingt ans, ne connaîtra ni décrépitude de la vieillesse ni les nombreuses déceptions dont l’existence n’est pas avare.
A titre personnel, j’apprécie qu’un écrivain profite de sa notoriété pour faire revivre la trace d’un de ces héros oubliés.
Hervé GAUTIER - Septembre 2024
Cette pièce de théâtre, car c’en est une, met en scène trois amis de longue date mais assez différents, Serge, est amateur d’art et dermatologue, Yvan, Marc est ingénieur en aéronautique, Yvan est d’un milieu un peu plus modeste mais qui s’adapte comme il peut à son nouvel emploi dans une papeterie et prépare son mariage. 
Serge vient d’acheter très cher un tableau de maître, vingt briques quand même, blanc mais où il voit des légères nuances de gris et même de rouge et le présente alternativement à ses deux amis.
Il se trouve que la présentation qu’il en fait à Yvan et à Marc ne déclenche pas leur enthousiasme. Marc d’abord qui se déclare choqué que son ami ait acheté si cher un tableau si simple qu’il qualifie d’ailleurs autrement. Il en devient même vulgaire dans la conversation qu’ils ont sur l’art contemporain face à Serge qui voit dans l’art moderne une nécessité.
Yvan ne s’oppose pas à son ami, serait même assez d’accord avec lui, ne souhaitant pas que cette œuvre devienne une pomme de discorde entre eux et les oppose définitivement. Il paraît décontenancé par cette discussion entre Marc et Serge, voudrait bien jouer les modérateurs, mais est davantage préoccupé par les préparatifs de son mariage et cette situation qu’il n’a pas voulue se retourne contre lui, met en évidence sa solitude, son désarroi face à l’avenir.
On a vraiment l’impression qu’il vivait cette longue amitié comme une félicité et qu’elle s’effondre lors de cette soirée qui se voulait amicale. Il est un fait qu’il y a entre eux une différence de niveau culturel et social et Yvan en a bien conscience.
On s’attend à un débat sur l’art qui a effectivement lieu à travers les citations que fait Serge de l’œuvre Sénèque ou de Paul Valéry, de ses aphorismes sur son tableau et les affirmations de Marc sur sa place dans son époque, la fonction de l’art et le ton monte progressivement entre eux.
Mais c’est plutôt sur l’amitié que leurs conversations s'orientent. Il y a même des raisons assez obscures qui ressortent dans leurs propos, une vieille histoire entre Marc et Serge bien antérieure à ce tableau mais qui avait déjà trait à l’art. Cela dit, on comprend vite que, comme toutes les choses humaines, cette vieille complicité qui les unit est fongible et consomptible et ils prennent soudain conscience qu’elle a la solidité d’un château de cartes dans un courant d’air. Ils en deviennent même carrément agressifs... au détriment d’Yvan, au propre comme au figuré. Ce tableau, acheté un petite fortune par Serge, suscite des jalousies cachées de la part de Marc, puis des remarques acerbes et mesquines du même Serge sur Paula, la compagne de Marc.
Notre vie est suffisamment compliquée et chacun à le droit de trouver un dérivatif pour la supporter ; pour Marc, c’est l’homéopathie et un improbable psychiatre aux propos sibyllins, pour Yvan c’est cette amitié commune et l’organisation temporairement compliquée de son mariage, alors pour Serge, si ce tableau lui vient en aide dans son quotidien, lui permet de rêver et de s’évader, pourquoi pas ?
On peut aussi voir dans cette confrontation ce que fait sur nous une œuvre d’art, tableau, livre ou sculpture, une émotion ou une occasion de bon investissement.
Même si cette pièce choisit de parler de la fragilité de l’amitié, j’y ai vu une réflexion sur l’art, sur la peinture en particulier et j’ai bien aimé la fin qui est non seulement originale mais aussi rassurante.
Quand le tableau était le seul support capable de représenter un portrait, il se devait d’être ressemblant. Depuis l’invention de la photographie, l’art pictural s’est affranchi de cette fonction de représentation. Dès lors, les artistes ont recherché la couleur, le mouvement, l’émotion, le message, jusque dans les formes les plus épurées de leur art, allant même jusqu’au non figuratif ou même l’abstrait, ce qui, dans le domaine de cette recherche est parfaitement acceptable. Cela dit, cette posture laisse aussi la place à beaucoup d’autres interprétations .
J’ai apprécié cette pièce de théâtre, simplement lue parce qu’on peut aussi lire une telle œuvre sans forcément la voir, mais aussi parce qu’elle met en scène, avec un humour de bon aloi, les relations entre les êtres humains à travers l’art et ce qu’il provoque chez eux.
Cette pièce, montée en 1994 avec Pierre Vaneck, Fabrice Luchini et Pierre Arditi, vaut son pesant d’émotions, de colère et d’apaisement.
Hervé GAUTIER - Août 2024
Sur Les chemins noirs - Sylvain Tesson- Gallimard.
D’abord la chute d’un toit, le coma, l’hôpital, avec de graves séquelles sur son corps, puis le vœu un peu fou de traverser la France à pied s’il s’en sort, un peu comme ces combattants qui au plus fort des combats jurent d’entrer en religion s’ils survivent. Pour ce voyage, l’auteur privilégie cependant les sentiers abandonnés qui lui permettent de voir le pays sous un jour différent, un trajet de Nice à l’extrême pointe du Cotentin, trois mois de marche solitaire, parfois entrecoupée par un accompagnement amical, dans le rougeoiement de l’automne.

Ce seront « les chemins noirs » mais aussi une manière originale de mener sa rééducation, de renouer avec la vie sauvage, l’aventure, la liberté, un œil sur la carte IGN, l’autre sur les pages d’un livre, une balade intellectuelle mais aussi une bonne manière de conjurer la perte de poids qui est une des obsessions de notre société actuelle, de parfaire sa condition physique. Ce mode de vie itinérant est pour lui l’occasion de renouer avec la marche et la nature, la vie simple, bucolique et marginale, de sortir des sentiers battus de la civilisation, un vrai défi, une renaissance après avoir frôlé la mort.
Sa « longue marche » au milieu de spectacles changeants, loin des villes, de leur bruit et de leur goudron, lui donne à voir des villages fantômes, des maisons fermées, désertées, des fermes abandonnées, des lieux déserts mais hérissés d’interdictions placardées, des chemins qui disparaissent des cartes, mangés petit à petit par les agriculteurs qui les intègrent à leurs parcelles cultivables et on songe à ce que Gaston Couté disait déjà des « mangeux d’terre ». Son cheminement à la fois attentif et passionné lui fait communier avec le silence,la lenteur, suscite en bloc des questions simples qui dérouteraient les énarques décideurs, lui donne à voir une nature détériorée par la folie des hommes, par les aberrations de la gestion comptable qui favorisent l’économie au détriment de l’écologie, une agriculture devenue industrie, les méfaits de la mondialisation et de notre addiction aux nouvelles technologies qui nous masque, par écrans interposés, la simple beauté des choses et colonise notre propre vie au quotidien.
Parcourir ainsi cette géographie rurale l’invite à revisiter l’histoire désormais sacrifiée au nom de la modernité des lieux parcourus, à réfléchir sur le présent et à méditer sur un avenir jugé quelque peu incertain.
J’ai aimé ce trajet, vécu sans doute comme le prolongement de quelque chose. J’en ai apprécié le style fluide et poétique, riche de descriptions et j’ai presque eu envie de reprendre à mon compte cet art du voyage à pied, moi dont les origines charentaisesme font goûter le port de ces pantoufles confortables et préférer l’été.
Que reste-t-il de ce périple transversal que seule l’eau, tolérée par la faculté, est venue irriguer, le vin, symbole et richesse des régions traversées lui étant interdit ? Des souvenirs journellement engrangés, des images lyriques confiées à la page blanche, les bivouacs nocturnes entre feu de camp et sommeil de belle étoile où les repas semblaient accessoires, bref un livre plein de remarques en forme d’aphorismes et de citations d’intellectuels.
Sylvain Tesson ne laisse pas indifférent, suscite même la polémique par ses écrits et son impact dans l’opinion. Pour moi je retiens ce livre qui fut une belle découverte..
Hervé GAUTIER - Juillet 2024
--
Triste tigre - Neige Sinno - P.O.L.
Prix Femina 2023 
De sept à dix-sept ans, dans les années 90, Neige a été violée par son beau-père, elle a porté plainte à dix-huit. Il a avoué, il a été jugé et condamné.
C’est une confession, une réflexion sur l’inceste, une révolte, mais aussi un texte hybride où l’auteur s‘exprime à la première personne et s’adresse directement au lecteur qu’elle invite à prendre son témoignage avec précaution. Ce n’est en effet ni un récit, ni une fiction, c’est une sorte demande faite au lecteur de se mettre dans sa tête de victime. C’est aussi, un témoignage en forme d’avertissement pour informer et protéger tous les enfants ainsi abusés.
Elle avoue que très tôt elle a eu l’intuition qu’écrire serait « le centre de sa vie ». Ce livre est aussi une réflexion sur l’écriture, la possibilité et l’impossibilité de l’exercer, l’indispensable temps de la maturation des mots. C’est plutôt sur cet aspect des choses que va ma réflexion. Elle décrit, avec parfois des détails assez sordides, les différentes phases de cette agression et analyse alternativement ce qui se passe dans sa tête et dans celle de son violeur, prenant comme références des ouvrages littéraires, des citations, d’autres exemples de bourreaux, de pervers ; sans négliger ce long et difficile examen, je me suis intéressé davantage à la thérapie qu’elle a choisie pour tenter de se libérer de cette opprobre.
Très tôt, à travers un journal intime, d’ailleurs offert par son beau-père, elle a confié au papier ce qu’était son calvaire, mais elle l’a rapidement brûlé. Trente années plus tard,parce que cette forme d’écriture nécessite le temps du recul et du mûrissement, elle a écrit ce livre pour tenter une nouvelle fois de mettre des mots sur ses maux mais aussi de faire enfin éclater son dégoût trop longtemps contenu,en cherchant un sauvetageéventuel dans la littérature.
Ce sont les quelques phrases laconiques de la quatrième de couverture où elle confie cet échec qui m’ont décidé à lire ce livre. Les mots, la littérature et l’art en général sont considérés comme une forme d’exorcisme d’un mal-être pour ceux qui peuvent s’exprimer ainsi. Ils se créent une sorte de bulle qu’ils espèrent salvatrice.
Pourtant, il arrive souvent que cette démarche incertaine soit si aléatoire qu’elle s’accompagne de l’usagede paradis artificiels et que leur quête débouche sur le suicide. La posture artistique entreprise est donc vaine pour celui qui l’a mise en œuvre, même si elle enfante des chefs- d’œuvres légués à l’humanité.C’est une idée reçue, véhiculée par les médias ou généralement admise dans l’opinion que les mots libèrent. Je n’ai pas vraiment eu ce sentiment ici et j’ai d’ailleurs toujours prétendu le contraire.
Ce n’est pas seulement une rébellion contre cet homme sans nom. Au procès son beau-père a avoué, ce qui était peut-être une forme d‘expiation mais aussi une stratégie pour peser sur le jury populaire des Assises.La justice est certes passée, il a payé sa dette à la société, cinq ans avec les réductions de peine pour bonne conduite. Ce livre est donc aussi une critique du système pénal et pénitentiaire et la réclusion de son parâtre n’a rien changé pour elle puisque, au terme de sa peine, cet homme a refait sa vie, libre et parfaitement capable de recommencer. Quant à elle, cette sanction a donc été sans effet puisqu’ellea tout perdu et portera cela toute sa vie avec la solitude le poids de cette enfance volée.
II y a certes eu des prix qui ont récompensé cet ouvrage, consacrant sa démarche courageuse et lui ouvrant les portes d’une carrière littéraire renouvelée et prometteuse, mais qu’en est-il de ce livre ?
Le titre évoque un poème de William Blake et l’auteure dessine un être, son beau-père, au début présenté comme quelqu’un avec « des bons côtés » mais dont l’auteure, au fil de la narration, dévoile le vrai visage, celui d’un prédateur qu’elle souhaite rendre triste par la publication de ce livre, la révélation de sa vraie nature. C’est aussi peut-être une sorte de revanche, une justice personnelle contre le tribunal qui à ses yeux a failli.
Les mots prennent leur source dans l’autobiographie mais avec une forte empreinte émotionnelle. Cela induit une écriture apparemment anarchique dans l’architecture du texte mais qui génère une lecture rapide et fluide. C’est difficile d’aborder le thème de l’inceste, longtemps tabou, dans le cadre de la famille qui est un des piliers traditionnels de notre société et qui est censée porter nos valeurs sociales, éducatives, morales, religieuseset qu’on est naturellement porté à la défendre. Pourtant, c’est bien en son sein que se développent d’abord les mensonges les hypocrisies et les trahisons qui ont souvent pour effet, sinon pour but, de détruire l’un de ses membres, évidemment plus vulnérable, surtout s’il s’agit d’un enfant. Elle dénonce également tous ceux dont c’était pourtant le rôle qui n’ont pas su ou pas voulu voir ce qui lui arrivait et la protéger. A ses yeux leur culpabilité éventuelle et de principe n’est pas suffisante.
Un livre est souvent porteurd’un message. Celui-ci ne se contente pas de raconter une histoire, il est un témoignage pour tous les enfants devenus grands qui ont à subir un traumatisme, de nature sexuel ou autre qui peut s’exprimer commela domination d’un puissant sur un vulnérable, qui a été de nature à leur voler leur enfance. La solitude et la tristesse qui en résulte a de grandes chances de les poursuivre toute leur vie.
La lecture d’un tel livre est forcément subjective et ne laisse pas indifférents tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont subi une blessure semblable ou différente dans leur enfance.
Hervé Gautier - Avril 2024
PARIS - BRIANCON - Philippe Besson - Juillard.
J'ai assez pris le train durant ma jeunesse, michelines omnibus aux couleurs délavées et qui s'arrêtaient à toutes les gares de la campagne ou trains de nuit aux compartiments bondés et pleins de militaires rejoignant leur caserne, pour ne pas être tenté de monter dans celui-là aussi. Cela n'avait pourtant à l'époque rien à voir avec le mythique Orient-Express et tous ses fantasmes et je passais souvent la totalité du voyage dans le couloir ou dans les soufflets et même si aujourd'hui ce sont des trains-couchettes, principalement à destination du sud de la France, je me suis dit que cela me rajeunirait.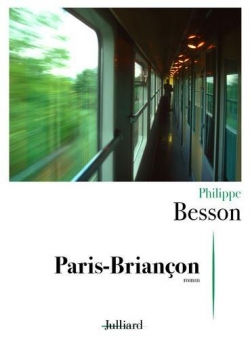
J'ai toujours été attiré par les trains parce que j'en ai été longtemps le client assidu et que l'espace de quelques heures on se retrouve en promiscuité avec des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on peut lier conversation pour ensuite ne plus jamais les croiser.
Pendant ces entretiens improvisés, dans le huis-clos des compartiments, on pratique la philosophie du café du commerce, on raconte souvent sa vie en une sorte de confession, les questions se font parfois indiscrètes, les réponse aussi, on refait le monde, on parle de la météo, de la politique, à en oublier le sommeil, d'autant plus facilement qu'on a affaire à un inconnu. J'ai toujours été attiré par cette ambiance propre aux trains.
Philippe Bessons plante ici le décor des personnes, jeunes ou vieux, d'horizons professionnels différents et aux motivations diverses d'être ici, qui vont se rencontrer pour un voyage ferroviaire nocturne de plus de douze heures. Souvent ils ne se connaissaient pas auparavant et vont se découvrir.
Au début on a l'impression d'être dans l'ambiance traditionnelle des romans de l'auteur avec son lot de rencontres masculines dictées par la chance comme il les affectionne, telle celle d'Alexis et de Victor dans la torpeur d'un long trajet. Leur rencontre éphémère que rien ne laissait prévoir révèle autant une découverte mutuelle que la certitude de devoir vivre avec ce secret. Rien ne devait se passer, tous devaient arriver à Briançon sans encombre et reprendre le cours de leur vie après cet intermède nocturne, la routine…
Puis c'est l'accident brutal et avec lui la mort. Elle fait partie de la vie, en est simplement la fin et on oublie un peu vite que nous n'en sommes que les usufruitiers, que nous sommes mortels, qu'elle peut nous être enlevée sans préavis et surtout au moment où nous y attendons le moins, même si nous menons notre existence en faisant semblant de l'oublier.
On songe au thème de la fatalité, du hasard malheureux, d'un enchaînement d'évènements évoquant la fragilité de notre vie, la certitude que nous ne sommes que de passage, qu'un rien peut soudain faire changer radicalement les choses, que se trouver « au mauvais endroit au mauvais moment » peut être fatal, que ceux qu'on a aimés ou simplement appréciés l'espace d'un instant peuvent simplement basculer de l'autre côté et qu'on ne les reverra plus jamais, que la quasi totalité d'entre nous ne laissera de son passage sur terre qu'un nom sur une pierre tombale...
Face à cela s'est installé cette habitude qui s'est ancrée dans notre quotidien, ce « droit à l'information » quelque peu dérisoire au regard de l'horreur et à la souffrance d'autrui, faisant de chacun d'entre nous de véritables voyeurs demandeurs d'images, qu'elles viennent des réseaux sociaux ou de la télévision. de tels événements qui émaillent notre quotidien révèle la cruauté de notre existence mais aussi sa futilité.
Les trains de nuit que j'ai connus n'ont plus rien de commun avec les intercités actuels, évidemment plus confortables mais j'ai retrouvé avec plaisir le style de Philippe Besson et les personnages attachants qu'il nous donne à voir.
Cela m'évoque cette parole d'Apollinaire « crains qu'un train ne t'émeuve pas ».
Hervé GAUTIER - Février 2024
Veiller sur elle - Jean-Baptiste Andrea - L iconoclaste.
Prix Goncourt 2024.

Qu’est ce qui provoque chez un humain le choix du monastère : le mysticisme, la volonté de se couper du monde, la nécessité de se cacher… ?
Cela a été le choix de Michelangelo Vitaliani, dit Mimo qui va rendre son dernier souffle dans une abbaye et surtout près de sa dernière œuvre qu’il laisse comme un testament. Il fut un garçon pauvre et peu favorisé par la vie qu’on a ignoré, méprisé mais qui a réussi à imposer très jeune son extraordinaire talent de sculpteur.
Sa vie a été un long combat contre sa condition même si elle a emprunté des détours parfois marginaux, même s’il a un temps croisé le fascisme de Mussolini et l’ombre du Vatican.
Le hasard lui a fait rencontrer Viola Orsini, une aristocrate rebelle et imprévisible, héritière d’une famille riche et prestigieuse mais qui a vu en ce jeune homme socialement différent d’elle, une sorte de double dont elle ne pouvait se passer, une sorte de caprice du destin. Si son parcours a parfois été plus en phase avec celui d’une jeune fille de son rang et malgré les différences de classe, ils se sont très jeunes juré fidélité dans le petit village où ils vivaient, sans que jamais une vie commune ni des relations charnelles ne viennent altérer cette promesse. Un amour vrai comme celui qui ne se réalise jamais, un amour que se portent deux êtres également capables de se détester.
Ce roman est la saga de leur deux familles déclinée sur la première moitié du XX° siècle mais aussi de leur deux parcours, cahoteux mais toujours animés par leurs rêves communs et par cet amour platonique, avec en contrepoint l’histoire bouleversée de cette période.
L‘auteur, avec ce quatrième roman, se révèle être un talentueux conteur grâce à une écriture fluide et poétique. J’ai lu ce long texte (près de 600 pages) avec le plaisir de la découverte et de la curiosité d’un lecteur attentif et passionné.
J’ai déjà dit dans cette chronique que, à mon humble avis, quelques romans couronnés par le prix Goncourt ne le méritaient pas. Ce n’est évidemment pas le cas de cet roman magistral, plein de senteurs d’orangers et du soleil de l’Italie
Hervé GAUTIER - Janvier 2024
Fuir l Eden - Olivier Dorchamps - Finitude.
L’Éden-Tower est vraiment très mal nommée. C’est un type d’immeuble caractéristique des années 50/70 construit en béton, représentatif du style « Brutaliste » que viennent photographier les touristes et les spécialistes de l’architecture moderne dans cette banlieue cosmopolite de Londres, près d’une gare. C’est une sorte de monument historique si mal entretenu que rien n’y fonctionne correctement. C’est là que vit Adam, dix-sept ans, avec son père, un ouvrier écossais alcoolique et violent, appelé« l’autre », et sa petite sœur Lauren. La mère est déjà partie sous d’autres cieux avec un autre homme, abandonnant tout ce petit monde à sa misère et les deux enfants ne veulent qu’une chose, quitter cet enfer pour retrouver leur mère. Adam ne veut pas devenir dealer, ni violent non plus, comme c’est le quotidien des jeunes ici. Il s’attache à être pour sa petite sœur une sorte de mère de substitution, un rempart contre ce père indigne. Il travaille au supermarché du coin pour un salaire de misère, traîne avec ses copains, Ben, un somalien adepte du Street Art et Pav un Polonais. Il n’a jamais vraiment quitté son quartier, rêve de voir la mer et passe son temps à réfréner comme il peut son surplus de testostérone. Adam croise sur un quai de gare le regard d’Eva et ses intentions supposées suicidaires. Son sac à main qu’elle lui a bizarrement abandonné lui permet de retrouver son adresse puisqu’il en est tombé passionnément amoureux. Un peu par hasard, il se retrouve le lecteur improbable d’une vieille professeure de faculté aveugle qui peu à peu lui redonne confiance en lui et l’éveille à la littérature. Sa rencontre furtive avec Eva lui révèle que l’amour est aveugle, qu’elle est sans doute inaccessible, que c’est une fille riche qui vit dans un autre quartier plus huppé, au-delà de la voie ferrée qui sert de frontière à son quartier pouilleux, mais qui s’intéresse quand même à lui. Quand il prend enfin conscience de ce qu’il s’est réellement passé lors de leur rencontre à la gare et qu’on ne peut pas revenir en arrière, lui qui n’a jamais eu de chance fait face aux circonstances et fait un choix difficile mais courageux qui hypothèque tous ses espoirs. Ainsi, sans qu’il le sache, la silhouette d’Eva s’estompe et disparaît définitivement alors que cette jeune fille aurait pu lui permettre de fuir définitivement son destin de garçon malmené par la vie : une façon d’illustrer l’impossible amour de deux êtres que tout oppose et la certitude qu’on échappe rarement à son milieu. Une sorte de roman social à la Ken Loach qui se déroule sur huit ans, une autre facette de ce XXI° triomphant.
Le livre refermé me laisse une impression forte et surtout juste. Je n’ai pas vraiment aimé le style pourtant en vogue actuellement et bien dans le style du roman, en revanche j’ai apprécié cette histoire écrite à la première personne par Adam comme un témoignage teinté de désespoir et de déchirements. C’est un garçon bien, plein de bonne volonté et de générosité pour sa famille mais il ne pourra pas échapper à son destin. L’amour impossible, la poisse qui le poursuit et l’ambiance malsaine dans laquelle vit Adam le rendent sympathique et j’ai eu pour lui plus que de l’empathie puisque cet amour fou qui aurait pu l’aider à se sortir de cet enfer se dérobe à lui. Ce roman me paraît illustrer ce qu’est notre société actuellement, caractérisée par un « ascenseur social » dont on nous parle à l’envi, mais qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Adam quittera certes l’enfer de l’Eden mais, tiraillé entre l’espoir et l’angoisse, restera malgré tout dans sa condition modeste, avec la fatalité qui pèse sur lui et qui sans doute ne le lâchera pas.
Olivier Dorchamps est lauréat du Prix Cezam 2023 avec ce roman.
Son premier roman "Ceux que je suis" a été acquis lors de la remise du prix à La Rochelle le 7/10/2023. Il a été dédicacé par l'auteur aux lecteurs de l'Atscaf 79.
Ces deux ouvrages sont dors et déjà à votre disposition dans notre bibliothèque.
Hervé GAUTIER - Novembre 2023
Le moine et le venerable - Christian Jacq - Robert Laffont.
Après avoir fait partager ses connaissances en égyptologie et les enquêtes de l’inspecteur Higgins, Christian Jacq renoue ici avec un autre aspect de sa création littéraire.
Les guerres ont cette caractéristiques de faire se rencontrer des êtres qui, sans ces circonstances exceptionnelles, ne se seraient jamais croisés. Nous sommes en 1944 et deux hommes, un médecin, François Branier, Vénérable de « Connaissance », une loge maçonnique qui respectait l’humanisme originel de l’obédience et qui s’inscrivait hors des combines politiques et de la quête des honneurs et des promotions sociales, et un moine bénédictin. Ils sont enfermés ensemble dans une forteresse par les nazis. Himmler veut en effet percer les secrets de la Maçonnerie et les pouvoirs divinatoires et thérapeutiques du moine au profit du nazisme. C’est ce qui leur vaut cette détention certes dure mais plus privilégiée qu’elle ne serait dans un camp de concentration.
Tout oppose les deux hommes sur le plan philosophique et doctrinale, le Dieu chrétien contre le Grand Architecte, la foi de la religion révélée contre les secrets de la loge, mais la captivité qui leur est imposée va les rapprocher dans la résistance qu’ils entendent opposer à l’ennemi et leur volonté de s’évader. Les manœuvres des nazis pour obtenir des informations en mettant en rivalité les deux hommes autant que leurs procédés visant à ce qu’ils se méfient l’un de l’autre et se trahissent, le jeu du chat et de la souris mené par les Allemands pour amener le Vénérable à dévoiler ses secrets et les manœuvres de ce dernier pour les cacher rendent ce roman passionnant. A un certain moment, on ne sait plus si le commandant du camp accuse le Vénérable d’être Maçon ou de diriger un réseau terroriste.
C’est un roman haletant, bien écrit, bien documenté sur la Maçonnerie et les discussions entre le moine et le Vénérable à propos de leurs croyances respectives sont instructives et sont aussi une invitation à la tolérance.
Hervé GAUTIER - Octobre 2023
Nous sommes la nuit - Gwenael Le Guellec - Editions Prisma.
Yoran Rosko, la quarantaine, photographe breton, s’est exilé au Japon pour se rapprocher de la belle Reiko dont il est follement amoureux. Il doit peut-être à une achromatopsie qui lui fait voir le monde en noir et blanc son attirance vers la nuit, les ruelles et les quartiers sombres. Sa participation à un « photo game », sa curiosité autant que le hasard le mettent en présence d’une photo de crime d’autant plus terrible que sa mise en scène est mystérieuse, fait appel à la culture spécifique nippone, aux rituels d’un autre âge et ne correspond pas vraiment à ce à quoi on pouvait s’attendre dans la chambre d’un « love hotel ». L’aspect énigmatique du cliché publié sur internet, sa possible signification ésotérique, l’incitent à en décrypter le sens artistique, les médias ayant surnommé les auteurs inconnus de ce meurtre les « Tueurs au tableau » puis les « Tueurs aux estampes », Japon oblige- parce que la scène évoquait une œuvre d’art. Ce meurtre sera suivi d’autres tout aussi mystérieux, toujours sur le même mode opératoire. Yoran n’est ni policier ni détective privé mais cette série d’exécutions et sa volonté d’en comprendre le sens, l’amènent, au cours de la poursuite de ces tueurs de l’ombre, à fréquenter le monde marginal de la nuit, d’y faire d’improbables rencontres, d’explorer autant la mythologie que l’art de vivre des Japonais, jusqu’à mettre sa vie en danger dans la touffeur de Tokyo. Sa quête peuplée de fantômes le mène dans d’autres contrées du Japon, en Italie et jusqu’en République Tchèque.

Le hasard m’a fait lire ce roman au moment où les réseaux sociaux sont les vecteurs des violences qui gangrènent notre société au point de la déstabiliser d’une manière inattendue et surtout incompréhensible. Ils sont également présents dans ce livre où l’espèce humaine, dans tout ce qu’elle a de plus horrible, est mise en scène.
Après « Armorican Spycho »-Prix du suspens 2019 et Prix du Goéland masqué 2020 » puis « Exil pour l’enfer « , ce roman clôt sa trilogie armoricaine. Gwenael Le Guellec poursuit les pérégrinations au Japon de son personnage favori que nous retrouverons sans doute plus tard avec le même plaisir . Ce n’est pas vraiment un roman policier au sens traditionnel du terme mais plutôt un « thriller-voyageur » à mi-chemin entre le roman noir et le thriller. Il y a donc des meurtres (spectaculaires) de l’argent, avec forcément des magouilles bancaires, du sexe, du sang, de la vengeance, des poursuites mouvementées. C’est le terreau traditionnel de ce genre littéraire qui exploite la face sombre de l’espèce humaine. L’auteur, au long de ces 500 pages, mêle modernité et tradition, avec de la musique en fond sonore, distille à la fois le suspense et l’intérêt de son lecteur par le mystère et le dépaysement qu’il lui procure. Il explore en effet, à l’occasion de ce qui ressemble à une véritable enquête, la géographie, l’histoire, le folklore et les légendes des lieux traversés qui évidemment recèlent en eux-mêmes des explications. La connaissance de la culture, du mode de vie et de l’esprit nippon, si différents de ceux de l’occident, la qualité de la documentation sont remarquables, notamment celle relative aux arts martiaux. Je retiens également, le livre refermé, une réflexion bienvenue sur la vanité des choses humaines suscitée par la phrase mise en exergue. Il procède par petites touches pour créer le climat délétère propre aux thrillers et y invite à la fin un chat qui vient ajouter son côté mystérieux. En outre, le style fluide et agréable à lire – tout particulièrement dans les descriptions- m’a procuré un bon moment de lecture. Ce fut une belle découverte.
Ce roman, don de l'auteur, fait évidemment partie des livres de notre bibliothèque
Hervé GAUTIER – Septembre 2023
Histoires de la nuit - Laurent Mauvignier
D’emblée, le décor est planté, un hameau de trois maisons au nom mystérieux et inquiétant au milieu de nulle part, une maison vide, la deuxième occupée par Christine, une artiste-peintre retirée des mondanités qui s’est réfugiée là pour finir ses jours, Patrice Bergogne, un agriculteur bourru qui a toujours vécu ici, c’est un brave homme, un peu naïf mais surtout amoureux de son épouse la belle Marion qui travaille dans la ville d’à côté, Ida leur jeune fille à qui Christine sert de Tatie. Tout est modeste et désert ici et les lettres anonymes de menace déposées chez l’artiste prennent soudain une dimension énigmatique, viennent troubler la paix de ce microcosme rural et précèdent une visite qui se révèle vite indésirable.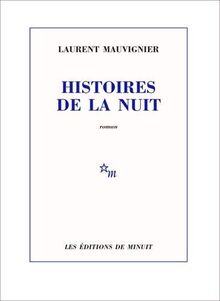
C’est aussi l’histoire de ce couple mal assorti qu’observe Christine, où l’amour a laissé place à la routine et où les époux s’éloignent l’un de l’autre à cause de l’usure inévitable du couple, avec leurs petits accrocs ordinaires et les petites libertés qu’on s’octroie dans le secret. Ida qui adore ses parents grandit dans cette famille et se réfugie dans ces « histoires de la nuit », un livre plein d’aventures à la fois effrayantes et merveilleuses qui nourrissent ses rêves. Cela aurait pu durer comme cela pendant des années sans même qu’on voit le temps passer, mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille, avec ses bouleversements qui interviennent quand on s’y attend le moins, avec cette volonté de croire que tout est possible et que peuvent prévaloir l’oubli, la bonne foi, la justice, le bon droit contre l’opportunisme et la trahison, contre les envieux, les destructeurs qui se croient tout permis parce qu’ils ont une parcelle de pouvoir et qu’ils entendent en abuser ou contre ceux qui ont choisi d’évoquer un passé aux souvenirs délétères. C’est compter sans le hasard qui fait partie de la vie bien plus qu’on ne veut l’admettre, sans le passé qui vient soudain présenter sa créance qu’on croyait oubliée, avec le silence qui n’est qu’un bouclier dérisoire contre des turpitudes longtemps cachées, avec son lot de rancœurs et sa volonté de vengeance contre toutes les injustices qu’on nous a imposées, le poids d’une enfance assassinée, ses ressentiments contre la vie que d’autres nous ont obligés à subir avec suffisance et arrogance parce que les comptes se règlent toujours d’une façon ou d’une autre. On peut avoir la naïveté d’inventer un passé banal à ceux qu’on a choisi pour les siens et avec qui on a résolu de lier sa propre vie, ou de ne pas trop chercher à connaître le déroulé de périodes où on n’était pas, la réalité revient toujours pour remettre les choses à leur vraie place, elle nous ouvre les yeux qu’on avait malencontreusement maintenus fermés. Leur vrai image s’impose alors à nous dans toute sa rudesse, dans toute sa cruauté, les ressentiments longtemps tus éclatent dans le déroulement brutal des événements, les zones d’ombre apparaissent enfin, nous révélant l’étendue de notre erreur et de leur hypocrisie. Le pardon est désormais impossible tant les choses ont été si longuement et sciemment cachées. C’est un peu tout cela qu’Ida découvre lors de cette soirée qui se voulait festive mais qui la fait soudain sortir de son univers protégé de l’enfance, lui révélant autrement que dans ses contes du soir le monde des adultes, leur violence, leurs mensonges, leurs non-dits, leur volonté de domination, leurs aspirations à la liberté et leur image qui soudain se délite. Le visage convenu de Marion s’efface au rythme des mots prononcés, son image se gomme peu à peu en révélant une autre bien moins idyllique, des comptes se règlent entre frères mais Patrice non plus n’est pas en reste et il ne sort pas indemne de tout cela.
Malgré des phrases un peu longues, ce roman est agréable à lire, avec une écriture à la fois brute et fluide, un luxe de détails et de précisions, une architecture subtile ce qui maintient l’attention et l’intérêt du lecteur jusqu’à la fin. A travers un récit aux multiples rebondissements, l’auteur nous présente une analyse psychologique à la fois fine et brutale, une galerie de portraits d’où la nature humaine ne ressort pas grandie parce que l’habiller de vertus et de bons sentiments est une erreur. Les situations qu’il nous donne à voir sont pertinentes et révélatrices d’une volonté de mystification, de violence, de secret qui caractérisent les êtres humains noyés dans une société qui a perdu ses repères traditionnels et c’est aussi le rôle de l’écrivain que d’être un miroir de son temps et de l’humanité. J’ai aimé ce roman où s’insinue une intrigue si habillement menée qu’elle tient le lecteur en haleine , distillant dans un huis-clos pesant un suspense de bon aloi.
"Les éditions de Minuit."
Hervé GAUTIER
Ce que faisait ma grand-mere a moitie nue sur le bureau ....
Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général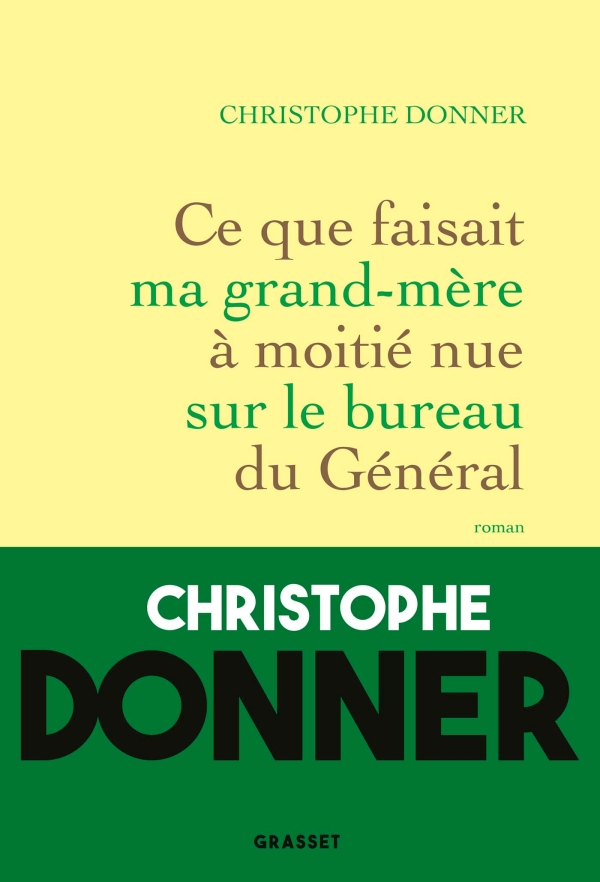
– Christophe Donner – Grasset.
Ce titre quelque peu racoleur est sans doute de nature à décider les plus sceptiques. Quant au Général, malgré le fait que nous ayons de plus en plus d’officiers étoilés, il ne peut s’agir que de de Gaulle puisque dans la mémoire collective des Français il n’y en aura jamais qu’un seul dont on prend même la précaution d’enrichir son grade d’une majuscule. Pourtant cela colle mal avec l’image qu’a laissé de lui « l’homme du 18 juin » qu’on imagine assez mal en Don Juan, mais on ne sait jamais !
J’ai été un peu perdu au début avec ce roman qui est la suite d’un ouvrage précédent que je n’ai pas lu, avec ces histoires entrecroisées d’oligarque russe qui a fait fortune grâce à la cryptomonnaie et qui achète à l’auteur le roman qu’il est en train d’écrire sur sa famille et plus spécialement sur la figure du docteur Henri Gosset, son arrière-grand-père qui soigna le fils révolté du royaliste Léon Daudet, un des fondateurs de l’Action française qui faillit faire basculer la France dans le fascisme et sur cette partie de la vie du jeune officier de Gaulle qui croisa pour la première fois le déjà vieux Pétain au début du XX° siècle. Cela sent le drame œdipien de la lutte à mort du fils contre le père sans qu’on sache très bien parfois qui veut tuer l’autre. Mais la grand-mère dans tout cela et la raison de sa posture qu’on imagine au service d’une ambition précise que la morale d’aujourd’hui semble vouloir hypocritement bannir des relations hommes-femmes pourtant immuables ? Qui était-elle? C’est Denise, dite Amin, quant aux véritables raisons, peut-être pas forcément historiques de sa présence sur le bureau du général, elles sont assez surprenantes. Que m’étais-je imaginé ?
Tout cela m’a paru intéressant sur le plan historique, mais quand même bien confus et surtout romancé. J’ai appris des choses sur les relations entre de Gaulle et Pétain, les postures déférentes mais fermes du jeune capitaine conscient de sa valeur et suffisantes et hiérarchiques du vieux maréchal avide d’honneurs. On sait comment tout cela va se terminer. Il est souvent question de l’auteur et surtout de Léon Daudet, le fils du célèbre écrivain, politicien ambitieux et surtout de sa famille, de son fils Philippe, adolescent perturbé, fugueur et anarchiste et de son projet un peu fou, pourtant réalisé. Une véritable saga avec des morts, et pas seulement à cause de la guerre, des adultères, des ambitions politiques, des démêlés judiciaires...
C’est étonnant, écrit sur le mode jubilatoire, et il faut attendre les dernière pages pour connaître la raison de la présence incongrue de cette femme sur un meuble quasiment historique. Finalement j’ai bien aimé et cela m’a donné en tout cas l’envie de découvrir cet auteur prolifique.
Hervé GAUTIER
Février 2023
Ecritures carnassieres - Erve - Editions Maurice Nadeau.
C'était plutôt mal parti pour lui qui fut un enfant dont la mère alcoolique se débarrassa comme d'une chose encombrante, puis ce fut un parcours cahoteux de familles d'accueil en foyers, avec pour seul refuge la solitude et les larmes face à l'indifférence, aux sanctions des adultes et au temps qui s'étire dans l'ennui. Il n'en faut pas plus pour aimer la marginalité, ponctuée parfois d'une amitié fugace, de petits bonheurs, d'échecs, d'abus de toutes sortes, de détestation de soi, d'autodestruction par l’alcool le tabac, la drogue, l’idée du suicide... De “cas social” il devient tout naturellement asocial, peut-être plus mature que les autres enfants, ce genre de circonstances donnant très tôt une autre vision des choses et des gens que celle traditionnellement idyllique de l’enfance. Par réaction, il se fait des illusions d'avenir, se rêve autrement, il lit et même écrit tout ce que sa vie cabossée lui inflige. Il doit se rappeler aussi tous les propos suffisants des bien-pensants, ceux qui proclament à l’envi « qu’il suffit de vouloir pour pouvoir » parce qu’ils ont eu la chance qu’il n’a pas eue. Puis il se dit que les passades éphémères qui ont égrené sa vie n’ont qu’un temps, que le bonheur existe et qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas pour lui aussi. Il y eu une rencontre et avec elle, tous les fantasmes qu'on se tisse soi-même pour compenser tout ces manques et pour tenter de faire changer les choses. Ce fut un prénom, Claire, la naissance de ses deux filles, ses deux poumons comme il dit, c’est pour elles qu’il écrit et cela me paraît parfaitement légitime. Nous savons que l’enfance conditionne la vie future et lui qui n’a pas eu d’amour pendant cette période se révèle incapable d’aimer, quitte cette famille qu’il avait créée et voulue pour tenter d’exorciser ce qui ressemble de plus en plus à un destin funeste. Ainsi pour ses filles, il devient « un père absent » qui ne leur donnera pas l’amour auquel elles ont droit. On ne peut donner ce qu’on n’a pas. Comme tous les malheureux qui font ce qu’ils peuvent pour s’en sortir, il n’échappe donc pas à cette règle non-écrite qui fait qu’on reproduit malgré soi l’exemple qu’on voulait précisément éviter. Elles aussi manqueront de son affection. Son univers devient donc la rue, l’errance, la manche et les petits bulots pour survivre... Il n’est pas clochard, même s’il le dit souvent, puisqu’il se déplace sur le cadastre national et même au-delà des frontières, qu’il voyage et on songe à Jack Kérouac et peut-être aussi à la génération perdue qu’il incarna, on pense surtout à une fuite qui ne dit pas son nom pour échapper à ses semblables marginaux, aux regard des autres, à sa région sinistre et sinistrée et peut-être aussi à lui-même, à ses erreurs, à son mal-être, avec sa solitude pour seule compagne...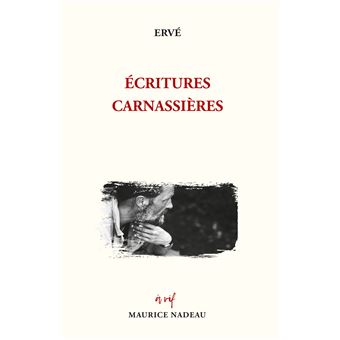
De courts chapitres d'une écriture « carnassière » c’est à dire féroce, abrupte, saccadée, comme la marque d’une révolte contre l’adversité. Elle n’est pas vraiment académique, se moque de la chronologie , mais elle a du caractère, est dénuée d'artifices et les moments de poésie et de paroles de chansons cachent mal les fêlures et le désespoir de cet écorché-vif. Dans son cas, l’écriture est un témoignage, celui d’un être qui choisit ainsi de réagir contre sa condition et ce faisant, en mettant des mots sur ses maux, il les adoucit au moins temporairement, même si j’ai toujours douté de l’effet cathartique de l’écriture. Il s’en sert pour exorciser ce destin néfaste et je ne suis pas sûr, malgré les apparences qui, nous le savons, sont trompeuses, que cela soit effectivement efficace simplement parce que les séquelles malsaines de cette enfance ont la vie dure.
Le hasard fait parfois bien les choses qui fait se rencontrer des êtres qui n'auraient sans cela eu aucune chance de le faire. Tel a été le cas quand l'écrivain Guy Birenbaum a croisé Ervé qui à l'époque était SDF et s’intéressa à lui. Il y aurait donc une justice (immanente?) qui rectifierait parfois les épreuves que la vie ne manque pas de nous envoyer, et cette malchance qui s'accroche à vous et ne vous lâche pas. Cette expérience semble donc avoir un épilogue heureux et ouvrir à Ervé des perspectives d’avenir. Tant mieux pour lui, il a eu de la chance dans son malheur, est sorti de sa condition en devenant écrivain, son premier livre est publié, c’est à dire qu’il a réalisé son rêve. Pourtant, à un moment où il est difficile de trouver un vrai éditeur sans avoir un bon parrainage, ou sans payer parfois cher sa prestation sans pour autant que la promotion du livre soit correctement faite, l’aventure que vit Ervé est plutôt rassurante et peut-être encourageante pour la foule de ceux, et ils sont nombreux, qui se voient contraints de remiser leur manuscrit dans la poussière d’un tiroir... et d’abandonner leur projet. Pour une fois qu’un éditeur, qui est un découvreur de talents, fait effectivement son métier, il serait vain de s’en plaindre.
Le livre refermé, cette histoire que j’ai lue avec attention et intérêt me laisse quelque peu perplexe. Je ne suis qu’un simple lecteur qui n’ait, par chance, jamais dû vivre sans toit mais, si je comprends la volonté de l’auteur de fonder une famille pour tenter d’oublier son enfance désastreuse, je reste dubitatif devant sa décision de revenir dans la rue et dans la marginalité avec son lot de mépris et de violences en oubliant ses responsabilités de père, ce qui aura sûrement les mêmes conséquences sur la vie de ses filles que l’irresponsabilité de sa mère a eue sur la sienne. Il a certainement tenté d’inverser le cours des choses mais elles se sont imposées à lui, malgré lui. D’une certaine manière et même s’il dit se détester, il fait valoir une certaine forme de liberté face à sa double paternité non assumée, laissant à sa compagne le soin de s’occuper de sa progéniture. Confesser son amour pour ses filles et sa femme est, dans ses conditions, sûrement insuffisant pour elles. D’autre part, il raconte son histoire qui est celle de beaucoup de gens jetés dans la rue à la suite d’accidents de la vie et ils seront sans doute nombreux à s’y retrouver.
J’ai bien conscience que je suis assez mal placé pour juger cet ouvrage et surtout le message qu’il contient, même si, toutes choses égales par ailleurs, mon empathie personnelle me fait partager ce mal-être.
Hervé GAUTIER
Le jeune homme - Annie Ernaux - Gallimard.
L’amour, est un des moteurs de la création artistique et Annie Ernaux nous avoue d’emblée que la simple jouissance sexuelle provoque pour elle l’écriture. A un certain moment de sa vie (elle a 54 ans) où elle connaissait peut-être une période de « sécheresse » créative, elle reçoit une lettre d’un étudiant de Rouen (« A ») qui admire en elle l’écrivain et peut-être aussi la femme. Leur relation dure de 1994 à 1997 au point qu’elle confie n’avoir jamais connu une telle ferveur de la part de ses autres amants. Pourtant tout les sépare, l’argent, le milieu social, la notoriété mais cet épisode rouennais permet paradoxalement à Annie de retrouver ses origines modestes et de revivre sa période « bohème » étudiante qu’elle avait aimée. Cette vie commune prend rapidement des accents d’initiation réciproque, une première vraie relation, un défi ou une une rencontre passionnée pour lui, un retour vers son passé et une quête de sa jeunesse pour elle, d’ailleurs pas forcément toujours agréable par l’effet miroir que de telles images tirées du passé pouvaient avoir ! Pour Annie cette différence d’âge n’était pas une honte, au contraire, elle correspondait à une quête de sa jeunesse enfuie et à une façon de transgresser un certaine forme de morale bourgeoise en ressuscitant la « fille scandaleuse » qu’elle avait été. Elle avoue qu’elle a vécu cet épisode comme une expérience réussie, loin d’une véritable passion, mais aussi comme une renaissance vers l’écriture. Un livre un peu court cependant pour montrer que, à l’occasion de cette aventure autobiographique amoureuse, ce qui importe vraiment pour elle c’est l’écriture, sa véritable raison de vivre.
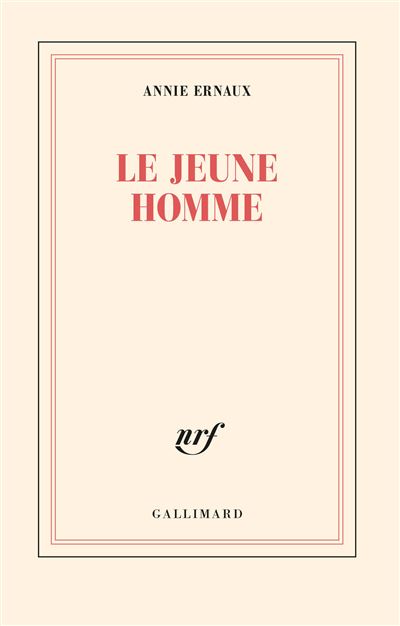 Ici elle confie avoir aimé un homme de trente ans son cadet et vécu avec lui. Au cours des générations précédentes, la relation entre un homme âgé et une femme plus jeune ne choquait personne et était même communément admise, quand l'inverse, pas forcément authentifiée par le mariage, suscitait parfois une réprobation gênée ou carrément un dramatique scandale, comme ce fut le cas pour Gabrielle Russier dans les années 60. Actuellement cette situation se révèle au grand jour et n'est plus comme auparavant soit réprouvée par une morale bien-pensante, soit cachée au nom d'on ne sait trop quoi. Même si une telle situation, d'ailleurs officialisée au plus haut sommet de l’État, peut susciter les quolibets, elle témoigne de l’évolution des mentalités.
Ici elle confie avoir aimé un homme de trente ans son cadet et vécu avec lui. Au cours des générations précédentes, la relation entre un homme âgé et une femme plus jeune ne choquait personne et était même communément admise, quand l'inverse, pas forcément authentifiée par le mariage, suscitait parfois une réprobation gênée ou carrément un dramatique scandale, comme ce fut le cas pour Gabrielle Russier dans les années 60. Actuellement cette situation se révèle au grand jour et n'est plus comme auparavant soit réprouvée par une morale bien-pensante, soit cachée au nom d'on ne sait trop quoi. Même si une telle situation, d'ailleurs officialisée au plus haut sommet de l’État, peut susciter les quolibets, elle témoigne de l’évolution des mentalités.
Déjà, l'an passé et par dérision on annonçait que le prix Nobel de littérature avait été décerné... à Annie Ernaux (L'italien Tommaso Debenedetti, spécialiste des fausses nouvelles qu'il démentait ensuite, avait déjà signé un canular sur Twitter annonçant la distinction attribuée à Annie Ernaux alors que l'Académie suédoise l'avait en réalité décerné cette année-là au romancier tanzanien Adbulrasak Gurnah). C'était évidemment faux mais cette année c'est vrai. Elle est la 17° femme à recevoir ce prix prestigieux et les Lettres françaises sont une nouvelle fois consacrées à travers elle. Je remarque que le jury suédois semble apprécier les écrivains français qui explorent leur mémoire personnelle dans leur œuvre puisqu’il a déjà distingué en 2014 Patrick Modiano qui a fait la même démarche créative.
On peut ne pas partager ses idées, mais elle les affirme avec conviction et constance. Elle ne fait pas partie de ces gens à qui une simple promotion fait perdre la tête et oublier leurs origines ou leur quotidien. Elle ne s'est pas contentée, tout au long de sa carrière littéraire, d’être une auteure à succès, elle n'a jamais fait mystère de ses modestes origines et en a même fait un des terreaux de sa créativité, tout comme elle a fait de sa personne et de sa vie la source de son inspiration, jusqu'au solipsisme. Elle a parlé des nombreuses facettes de sa propre vie, défrichant au passage les arcanes de la mémoire jusqu’à un trop grande facilité de confidences peut-être. On peut en penser ce qu'on veut mais après tout un écrivain puise dans sa vie sa propre œuvre créatrice ce qui est souvent l'occasion soit d' intéresser ses lecteurs soit parfois de les aider dans la leur.
Hervé GAUTIER
Le dimanche des Rameaux - Claire Sainte-Soline - Grasset
L'actualité a tiré le petit village de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) de son anonymat et de sa torpeur à cause du dossier compliqué et controversé des “bassines”, ces grandes retenues d'eau destinées à l'irrigation estivale des cultures. Sans vouloir prendre position sur ce qui semble vouloir être un catalyseur politique de la contestation, je me suis souvenu que ce nom a aussi été porté par une femme de Lettres, malheureusement oubliée, Claire Sainte-Soline (1891-1967), de son vrai nom Nelly Fouillet, qui adopta pour pseudonyme le nom d'un village deux-sévrien proche de son lieu de naissance. Elle fut une scientifique doublement agrégée de physique-chimie et de sciences naturelles, chercheuse universitaire, conférencière mais également enseignante pour obéir à son père, instituteur. Elle enseigna notamment à Blois, à Grenoble, à Paris et également à Fès au Maroc.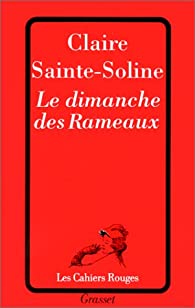
En 1934, elle publia son premier roman "Journée" qui évoque un village poitevin, ce qui lui valut l'attention d'André Gide puis plus tard de François Nourissier et le Prix Minerva. Cet ouvrage sera le début d'une vingtaine de romans et de quatre nouvelles, œuvres publiées quasiment annuellement. Elle donna également des conférences dans le cadre de "l'université populaire"pendant son séjour à Niort. Son style lui valut des éloges des critiques littéraires de l'époque, elle manqua d'une voix le Prix Femina en 1957 (avec « La mort de Benjamin » publié chez Grasset), ce qui lui conféra une certaine notoriété et lui valut son siège, l'année suivante, au jury de ce même Prix. Elle fut également membre du jury du “Prix du roman populiste”. Elle voyagea dans toute l'Europe, en Inde et au Japon et publia des récits de voyages ("Grèce", "Maroc"), un ouvrage de vulgarisation scientifique ("Petite physique pour les non physiciens") et la traduction d'un roman grec. Sa fille, Paulette Coquard qui naquit de son bref mariage avec l'artiste peintre Louis Coquard fut la première épouse de Pierre Moinot (1920-2007) romancier et académicien.
Son écriture, influencée par sa formation scientifique et par sa qualité d'enseignante, est précise, sobre, rigoureuse et rappelle le style des écrivains du XIX° siècle. Avec une certaine ironie, elle se révèle une observatrice attentive de l'espèce humaine, de son immoralité et de sa dureté. L'atmosphère de ses romans est sombre, lourde, les personnages sont souvent lâches et violents, parfois laissés pour compte, marqués par la révolte due à des fractures douloureuses que seul l'amour de la nature peut atténuer. Tout au long de sa vie et de son œuvre elle a fait montre d'un grand humanisme, d'un esprit libre frondeur voire anticonformiste (Elle déclara que « l’art est un guet-apens » et que, à ses yeux l’écrivain n’avait pas droit à plus de considération qu’un boulanger) , mais resta fondamentalement classique en refusant le “Nouveau Roman”.
Son nom a été donné à une allée à Niort où elle est inhumée, l'école de Melleran où elle est née porte son nom mais il semblerait qu'à l'exception du "dimanche des rameaux" (Grasset) aucun de ses romans n'ait été réédité.
« Le dimanche des Rameaux » publié en 1952 et réédité en 1997 est, nonobstant son titre printanier, un ouvrage sombre qui met en scène Marie, la narratrice, une femme mariée à Lucien, un sculpteur raté en mal d'inspiration et de commandes, ce qui compromet la situation financière du ménage. Cela n'empêche pas son mari d'imposer sous le toit conjugal, Berthe, son modèle qui est aussi sa maîtresse et une autre femme, Caroline, une danseuse qu'il veut séduire. Mina, l’enfant du couple que Lucien frappe souvent, lutte contre une grave crise d’appendicite et ce mini-harem sur lequel règne Lucien se complète avec la présence d'Alice, la servante. En ce dimanche des Rameaux, Marie, après l’avoir longtemps supportée par amour pour Lucien mais aussi peut-être par fatalisme mais surtout en souffrances, prend conscience de sa situation matrimoniale désastreuse définitive face à ce tyran domestique mais trouve le courage d'ironiser sur cet échec. La décision qu'elle prend et qui est le résultat d’une longue réflexion en fait un roman très actuel dont l'action respecte la classique unité de temps puisqu'il se déroule en vingt-quatre heures. Notre auteure, dans un texte fort bien écrit et agréable à lire, mène une remarquable analyse psychologique de ses personnages et se révèle être une observatrice attentive de l’espèce humaine plus spécialement dans les relations du couple. Elle montre la soumission de Marie puis sa révolte, dépeint Lucien comme un être violent, paresseux, un pervers d’une solide mauvaise foi. Marcel Arland a salué ce roman comme "une double satire : une satire, la plus virulente, contre la monstrueuse tyrannie de l'homme, son égoïsme, son inconscience… mais une satire aussi, mêlée de pitié, contre la faiblesse de la femme et sa complaisance dans l'humiliation".
Les événements de Sainte-Soline n’ont rien à voir avec cette auteure mais il serait bon que ses œuvres se retrouvent dans les rayons des librairies et des bibliothèques pour une redécouverte.
Hervé GAUTIER
Le sixieme enfant - Un film de Leopold Legrand.
Pour une femme dont l’instinct maternel est fort, ne pas pouvoir enfanter est un drame et quand la médecine s’est révélée impuissante et que le droit multiplie les conditions de l’adoption au point de la rendre impossible, faire appel à son imagination, même si elle contrevient à la loi, est tentant. C’est le thème de ce film qui met en scène un couple d’avocats dont l’épouse, Anna(Sara Giraudeau), a fait plusieurs fausses couches et dont Julien (Benjamin Lavernhe), commis d’office dans une procédure, rencontre Franck (Damien Bonnard), un délinquant marginal gitan qui, au terme de l’instance, lui offre un marché. Son épouse, Meriem (Judith Chemla) enceinte de son sixième enfant est déterminée, avec l’accord de son époux, à ne pas le garder parce qu’ils ne pourront pas l’élever, pour des raisons financières. Une transaction est donc mise sur pied, l’enfant à naître sera « vendu ». Cette offre est simple et Anna et Julien ne peuvent ignorer que la loi qualifie un tel acte de trafic d’êtres humains et évidemment le condamne mais, après pas mal d’hésitations, surtout de la part du mari, et qui mettent à mal l’équilibre du couple, ils prennent quand même la décision d’accepter.
C’est une intrigue déjà présente dans la littérature, notamment chez Maupassant et c’est aussi, de nos jours une chanson de Viktor Lazlo, Mais ce film est une adaptation du roman d’Alain Jaspard (« Pleurez des rivières » aux Éditions Héloïse d’Ormesson) où les personnages et les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, les événements plus ramassés, mais le sujet est parfaitement identique, celui d’un drame sur fond de choc des cultures, celui d’une rencontre de deux couples qui n’avaient aucune chance de se croiser, l’un, bourgeois parisien qui vit dans les beaux quartiers et l’autre qui survit en banlieuesur une aire réservée aux gens du voyage, une famille jeune mais triste, sans enfant et une autre plus âgée, joyeuse et pleine de gamins, mais tellement pauvre qu’elle ne pourra même pas faire face à la venue d’une autre bouche à nourrir. Il y a cependant dans cette opposition une note de liberté que la précarité ne gomme pas.
On pouvait se douter de l’épilogue, même si une décision contraire de dernière minute de la part de Meriem pouvait encore intervenir et empêcher la réalisation du projet. En outre, lors des préparatifs de l’accouchement et au cours de celui-ci, Meriem, plus âgée, est présentée comme une primo parturiente, mensonge qui ne pouvait échapper au médecin et à la sage-femme qui en ont d’ailleurs fait le signalement. D’autre part, je comprends parfaitement la réaction du fils aîné du couple qui analyse simplement la situation de la famille et l’accepte. Être l’aîné dans un contexte familial difficile mûrit plus vite un enfant et lui fait prendre conscience des réalités en hypothéquant son enfance. Catholique fervente, Meriem ne peut accepter l’avortement, en revanche, j’ai un peu de mal à concevoir que les gens du voyage, très croyants et également très attachés à leurs enfants se résolvent à vendre l’un d’eux. La complicité de ces deux couples, et spécialement des femmes que tout oppose, est bouleversante. Il faut cependant espérer pour Anna, qui prend sur elle toute la responsabilité de cette terrible histoire, que, même s’il s’agit d’une fiction, le jury des Assises soit majoritairement composé de femmes qui, mieux que des hommes comprendront ce problème.
C’est un très beau film, tout en nuances et en finesse, d’ailleurs couronné de nombreux prix (Prix du Public, d’interprétation féminine, de la meilleure musique et du meilleur scénario), servi par des acteurs talentueux et authentiques qui interprètent magistralement et dans le ton juste cette partition difficile. Une façon aussi de nous faire réfléchir sur la famille, la destiné des nantis par rapport aux plus pauvres qui sont aussi des êtres humains.
Hervé GAUTIER Octobre 2022
Terra Alta - Javier Cercas - Actes sud.
Traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujičič et Karine Louesdon.
Dans une petite ville de Catalogne, Gendesa, capitale de la Terra Alta, un meurtre atroce vient d’être commis, le massacre avec tortures et mutilations d’un vieux couple de riches industriels dans une villa isolée, les Adell. Lui, malgré ses quatre vingt dix ans dirige encore une importante cartonnerie, des riches dans une région pauvre. Pourtant l’affaire se présente plutôt mal sans indices ni traces d’effraction, même s’il apparaît que, malgré son catholicisme militant, ce patron parti de rien, sorte de potentat arriviste, exploitait ses ouvriers et suscitait des envieux. Ce n’était pas cependant une raison suffisante pour le tuer. On pense même à un meurtre rituel à cause de leur appartenance à l’Opus Dei. L’enquête vite classée ne tient que grâce à l’entêtement de Melchor Marín. C’est en effet lui qui, muté temporairement dans cette région éloignée de Barcelone pour sa sécurité, va être chargé de l’enquête. C’est surtout l’occasion de faire connaissance avec lui. Fils sans père d’une prostituée, il a grandi dans les bas-fonds de Barcelone et la pègre qu’il a très vite fréquentée l’a amené en prison où la nouvelle de l’assassinat sordide de sa mère et la lecture des « Misérables » ont fait de lui un révolté et l’ont déterminé à faire des études pour devenir… policier, ne serait-ce que pour découvrir son vrai père mais surtout pour découvrir les assassins de sa mère, un justicier obsédé par les injustices de ce monde, un homme tiraillé entre les figures emblématiques hugoliennes de Valjean et de Javer ! Malheureusement pour lui, il va s’apercevoir que la recherche effrénée de la justice peut mener aux pires injustices et que, sur cette terre catalane, le souvenir de la Guerre Civile espagnole n’est pas éteint.
Sa mutation dans cette région isolée où d’ordinaire il ne passe rien va certes être pour lui l’occasion de se ranger en rencontrant Olga sous l’égide des livres, en l’épousant et en lui faisant un enfant, mais cette affaire de meurtre va bouleverser durablement sa vie et son séjour ici.
Roman original, qui n’est pas sans soulever des questions philosophiques, morales et de conscience, agréablement écrit (traduit?) et qui ménage le suspense jusqu’au bout en associant cette fiction à l’Histoire du pays. Je l’ai lu passionnément et sans désemparer avec le souvenir tragique de cette Guerre Civile qui ensanglanta l’Espagne de 1936 à 1939, des assassinats sommaires pratiqués des deux côtés et de celui des Républicains et des brigades internationales sur le rythme entraînant de « Viva la quinta brigada », chant emblématique de ces volontaires qui luttèrent vainement pour la liberté et contre le fascisme.
En Espagne, sous la dictature de Franco, le souvenir de la guerre civile a été complètement occulté. Sous le régime suivant, plus démocratique, on a cherché à oublier toutes ces atrocités. Ce n’est que lors de la génération suivante, qui n’a évidemment pas connu ce conflit, que les jeunes écrivains espagnols s’en sont emparés, se le sont même approprié et l’ont intégré à leur œuvre, comme pour en exorciser toutes les horreurs. Javier Cercas, né en 1962 est de ceux-là. Je vais poursuivre la découverte de son œuvre.
Hervé GAUTIER Septembre 2022
Guerre - Louis-Ferdinand Celine - Gallimard.
Je suis toujours fasciné par les écrits qui refont surface des années après leur disparition, c’est à dire des mots confiés au support fragile du papier et qui résistent au temps, comme ce fut le cas des écrits de Fernando Pessoa. C’est d’autant plus étonnant dans ce cas qu’il s’agit de Céline, un des écrivains maudits de la Libération qui, craignant pour sa vie, quitta la France en juin 1944. Des manuscrits furent volés dans son appartement de Montmartre, dont « Guerre », qu’on retrouva miraculeusement en bon état en 2021, après une disparition de près de quatre-vingt ans. Cet ouvrage, écrit en 1934, où se mêlentautobiographie et fiction un peu débordante, évoque la grave blessure, puis la convalescence du brigadier Ferdinand Bardamu au début de la guerre de 1914. Nous retrouverons ce personnage dans « Voyage au bout de la nuit »(1932 – Prix Renaudot).C’est presque devenu une habitude pour les manuscrits de Céline puisque celui de « Voyage au bout de la nuit » est lui aussi réapparu en 2001 après soixante ans de mystère et la notoriété de l’écrivain a déterminé le Bibliothèque nationale de France à l’acquérir. Des manuscrits comme ,« Londres » et « La volonté du roi Krogold », également découverts récemment, seront publiés prochainement et on peut toujours imaginer que d’autres émergeront du néant !

Ce roman atteste du parcours de Céline, alors le maréchal des Logis Louis-Ferdinand Destouches, qui, âgé de 18 ans, fils unique d’une famille modeste et ayant connu une enfance difficile, devança l’appel et s’engagea dans l’armée pour trois ans, avec sans doute toutes les illusions qui vont avec. Il les perdra rapidement avec la guerre où il sera grièvement blessé dans une mission à aux risques. Décoré, il sera réformé comme invalide de guerre. Ainsi, dans ce roman comme dans bien d’autres, il mêle autobiographie et imagination.
Ce roman, écrit sans doute du premier jet (ce qui est assez rare chez Céline qui retravaillait ses textes), se situe en Flandres ou Ferdinand se réveille sur le champ de bataille, blessé, seul survivant au milieu des morts, récupéré par des soldats anglais, son hospitalisation et sa convalescence rocambolesque jusqu’à son départ pour Londres qu’il rejoint grâce à Angèle, une prostituée dont il devient l’ami. Dans ce roman il décline les désillusions qui sont les siennes qui marqueront l’ensemble de son œuvre et nourriront son pessimisme, notamment sur l’espèce humaine. A travers sa poétique et sa petite musique célinienne, entre légèreté, drame et même humanité, sa verve argotique, populaire et parfois cruelle, ses thèmes favoris y sont présents, l’horreur de la guerre, la mort, la vie, ses parents, l’espèce humaine, et la sexualité à travers les personnages féminins de l’infirmière, mademoiselle Lespinasse et Angèle, la prostituée dont le Bébert, le proxénète avec qui il se lie, est le protecteur. D’autres personnages se retrouveront aussi dans ses autres romans. A propos du sexe, très présent dans ce roman, il est probable que si le manuscrit avait été publié au moment de sa rédaction, il eût sans doute été quelque peu censuré.Ce roman dont évidemment l’édition ne passe pas inaperçue, éclaire une partie de la vie de l’écrivain encore inconnue, une sorte de chaînon manquant.
L’image de l’écrivain d’exception que fut Céline est ternie par ses prises de positions antisémites, comme beaucoup de monde à cette époque, et beaucoup moins collaborationniste qu’on a pu le dire, pendant l’Occupation, sa fuite en 1944, ce qui fait de lui à la fois un personnage sulfureux, contesté en tant qu’homme et un écrivain génial qui a révolutionné les Lettres françaises. On pense ce que l’on veut des écrivains comme Pierre Drieu La Rochelle et Robert Brasillach qui ont pris le parti de la collaboration avec les nazis mais il est probable que Céline, après avoir eu ce contact désastreux avec la guerre, a peut-être réagi ainsi face à ce deuxième conflit mondial.
Pour faire écho à ce roman, au moment où actuellement un autre danger menace la démocratie en Ukraine et peut être en Europe, ces quelques mots de Jacques Prévert, extraits d’un des plus beaux poèmes d’amour de la poésie française et qui porte le nom d’une femme « Oh Barbara, quelle connerie la guerre ».
Hervé GAUTIER Aout 2022
aneantir - michel houellebecq- flammarion.
Le roman s’ouvre sur la décapitation virtuelle de Bruno Juge, ministre des finances, diffusée en vidéo sur les réseaux sociaux. Cela a tout de la fake newsmais atteste la haine d’une partie de la population pour la politique. C’est plutôt un mauvais présage pour les élections présidentielles françaises de cette année 2027 pour lesquellesle Président qui, ne pouvant pas constitutionnellement se représenter,a choisiBrunopour seconder le candidat désigné, un minable incompétent, et surtout pour mieux assurer sa réélection après cet intermède présidentiel, ou peut-être garantirà Bruno un destin politique. Dans cette atmosphère de fièvre, nous revivons la préparation des interventions télévisées, la stratégie électorale, la folie des sondages, les techniques de communication, les projections politiques que les résultats ne manqueront pas de faire mentir comme à chaque fois. Nous sommes donc en pleine politique-fiction d’autant que des attentats terroristes d’une nouvelle génération mettent en échec les meilleurs informaticiens. D’autres inquiétantes vidéos révéleront d’autres attentats qui menacent l’équilibre du monde avec un détour par la DGSE, une réflexion sur le millésime de cette année et des suivantes sur le thème des nombres premiers et même une secte satanique, avec ses messages codés pas vraiment convaincants. Cela me paraît révélateur de notre actualité où la violence et la contestation nourrissent une vie politique instable, une menace sur la démocratie avec une inquiétante montée de l’abstention et une attirance vers un vote favorable aux extrêmes, le tout enveloppé dans la menace d’une troisième guerre mondiale et la folie destructrice d’un dictateur mégalomane.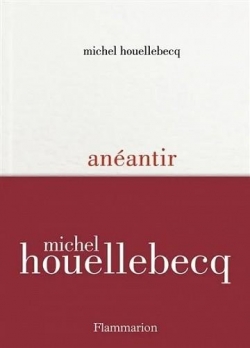
Cela conforte mon mantra personnel selon laquelle si la politique est une chose passionnante, ceux qui la font le sont beaucoup moins.
L’autre versant de cet ouvrage est consacré à la famille Raison, dont Paul, la cinquantaine dépressive, un peu perdu dans ses problèmes matrimoniaux et familiaux, haut fonctionnaire de Bercy et ami de Bruno est notre grand témoin. C’est à travers lui que ce texte se décline. Ces deux thèmes s’entremêlent tout au long de ces plus de 700 pages où nous vivons la saga de cette famille avec ses soubresauts et ses drames, liés en partie à la fin de vie végétative du père, à la désespérance d’un membre de la parentèle liée aux fake-news et à leurs ravages et à la désagrégation d’une famille. La fratrie de Paul, sa sœur Cécile, confite dans l’eau bénite et Aurélien qui peine à vivre de la culture, n’est pas brillante non plus, entre bouteilles d’alcool, rêves déjantés et surtout déroutants, adultères, séparations et divorce. Paulnous offre même une longue réflexion sur la souffrance et la mort. Je retire de l’ensemble de cette œuvre un sentiment de tristesse et de solitude des personnages. On est effectivement seul face à la camarde et la mémoire de la beauté de ce monde, de ces moments heureux et amoureux, peut être une antidote apaisante au mystère de cet instant fatal. Je dois dire que j’ai apprécié surtout les derniers chapitres sur ce thème qui illustre la condition humaine vouée à la souffrance et au trépas. J’en ai goûté la belle écriture enrichie de nombres de références culturelles, le style poétique dans les descriptions de la nature, notamment la Bretagne et les collines du Beaujolais, les allusions délicieusement érotiques dans l’évocation du paysage féminin.
Nous sommes dans un roman de Houellebecq où la contestation le dispute au pessimisme sans oublier les outrances et l’obsession sexuelle, c’est son registre personnel, ses fondamentaux et je ne suis pas de ceux qui les rejette, bien au contraire. Il y a certes des thèmes labyrinthiques qui sont parfois des impasses, mais ce que je lui reconnais volontiers, c’est d’être un fin observateur de l’espèce humaine dont la perversion et la volonté de nuire à son prochain, dans le but de s’enrichir ou simplement de faire le mal gratuitement pour se prouver qu’on existe, est une constante. Cette nature humaine, à laquelle nous appartenons tous et que Houellebecq dénonce si judicieusement, ne sera jamais rachetée par tous les Coluche et tous les Abbé Pierre et cela contraste avec tous les romans plus ou moins lénifiants que nous impose le paysage littéraire actuel. Sa plume acerbe est d’autant plus pertinente qu’elle met en scène les membres d’une même famille qui connaissent mieux que les autres le domaine d’application de leur méchancetés et de leurs mesquineries, la vulnérabilité de leur victime et savent là où ils doivent frapper pour être efficaces.
Alors, roman d’anticipation inspiré de l’actualité à cause des homonymies ou des ressemblances qui peuvent se deviner dans la vie publique de gens actuellement en place ou qui l’ont été, simple fiction ou délire d’écrivain dans un contexte politique de plus en plus bousculé et incertain. Quant à la projection un peu fantasmagorique de la future carrière de Bruno (qu’on aura reconnu sous les traits de Bruno Le Maire), j’espère qu’il ne s’agit pas là d’une récit à tendance flagorneuse et courtisane, dans l’espoir un peu fou d’obtenir à terme quelque prébende comme ce fut le cas, toutes choses égales par ailleurs, pour Philippe Besson après l’élection de Macron.
La société perd sa boussole et se délite de plus en plus, elle est minée par l’amnésie, la violence, l’envie d’en découdre et même de s’autodétruire quand la famille n’est plus un modèle pour les enfants, que l’Église qui a complètement manqué à son rôle de gardien de la morale, malgré la bonne volonté de nombre de membres du bas-clergé, provoque un intérêt grandissant pour les sectes et autres religions, que le personnel politique tangue entre opportunisme, démagogie, parasitisme, égocentrisme, corruption, compromissions à des fins bassement électorales, trahisons et palinodies, part de plus en plus à la dérive et que l’espèce humaine est décidément bien infréquentable. Il y a vraiment de quoi être inquiet. On pense ce qu’on veut de cet auteur, mais il est un fait que ce qu’il écrit ne laisse pas indifférent et fait débat. Je lui trouve, entre autre qualité, celle d’être un miroir de notre société déclinante qui de plus en plus abandonne ses repères et je sais gré à l’auteur de s’en faire l’écho. C’est en effet un des rôles de l’écrivain que d’être le témoin de son temps.
C’est peut-être (ou peut-être pas?) le sens du titre un peu énigmatique, non seulement sur la disparition de la démocratie mise à mal par les hommes politiques eux-mêmes, mais aussi sur l’accent mis par l’auteur à propos de l’aspect éphémère et transitoire de notre vie vouée à l’anéantissement, comme s’il voulait rappeler que nous n’en sommes que les usufruitiers et qu’elle peut nous être enlevée sans préavis. Je note la présentation de la première de couverture où le terme « roman » n’est pas mentionné comme auparavant, un peu comme si la nature de cet ouvrage était différente. Les noms de l’auteur, de l’éditeur et le titre lui-même sont écrits volontairement en minuscules, malgré le paradoxe d’une reliure cartonnée, gage de durée.
Même si je n’ai pas toujours partagé l’enthousiasme populaire autour de la sortie de certains de ses livres, je dois bien admettre que la publication d’un ouvrage de Houellebecq est toujours un événement culturel auquel il convient de porter attention et celui-ci ne fait pas exception. Si j’ai apprécié le style, je déplore un peu la longueur et même certaines longueurs et trop de précisons techniques qui n’ajoutent rien au texte, mais je ne me suis pourtant pas ennuyé à cette lecture qui a constitué pour moi un agréable moment.
Hervé GAUTIER Juillet 2022
Le grand monde - Pierre Lemaitre- Calman Levy.
La saga de la famille Pelletier commence à Beyrouth avec l’évocation de la prospère savonnerie familiale qu’aucun des quatre enfants ne veut reprendre. Jean, dit Bouboule, qui rate tout, part pour Paris, avec sa femme Geneviève, une détestable créature profiteuse, garce et adultère qui l’humilie en permanence. Il y retrouve François qui, après avoir fait croire qu’il était admis à Normale Sup tente des débuts laborieux dans le journalisme pour se spécialiser plus tard dans les « faits divers » ; pour Étienne c’est Saïgon à la poursuite de son amant, un légionnaire qui a disparu, quant à Hélène, la petite dernière restée dans le giron parental, elle ne rêve que d’évasion, en profitant quand même de la vie avec au fond d’elle sa fascination pour le grand monde parisien. Cette « fuite » des enfants de cette famille nous réserve pas mal de rebondissements.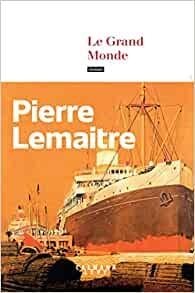
Pierre Lemaitre embarque son lecteur dans un autre monde. A Saïgon c’est la vie facile de « l’indo » avec la corruption, la concussion, les vapeurs d’opium, le trafic de piastres et la prostitution qui succèdent aux senteurs de savon de l’entreprise familiale. C’est aussi la guerre contre le Viêt-minh, ses atrocités, ses malversations et ses paradoxes comme on en rencontre dans tous les conflits armés. A Paris ce sont les années difficiles de l’après-guerre puis les Trente Glorieuses. Chacun des personnages de cette famille éclatée en appelle d’autres, non moins truculents, avec toutes ces aventures racontées avec une écriture vive et un évident plaisir narratif, plein de verve de suspens et d’humour mais aussi d’une grande précision documentaire et le culte du détail qui ne peuvent laisser le lecteur indifférent. On y rencontre un tueur en série, un chat, un « chevalier blanc » qui veut purger la société des maux qui la gangrène et spécialement de la corruption des hommes politiques, le grand prêtre d’une secte pas très catholique, une famille qui se veut respectable mais qui peu à peu se délite, une vieille affaire qui ressurgit puis une autre qu’on veut enterrer, dans l’ambiance de la guerre d’Indochine, la fin de la Deuxième guerre mondiale et ses tickets de rationnement, ses manifestions ouvrières durement réprimées et les Trente Glorieuses. Je ne sais cependant pas si, dans ce contexte, l’épilogue est vraiment porteur d’espoir ou de rebondissements.
C’est un récit jubilatoire que j’ai lu avec un réel plaisir et pas seulement parce que j’aime les sagas. On ne s’ennuie vraiment pas au cours de ces presque six cents pages. J’attends la suite avec intérêt et je ne suis pas le seul.
Hervé GAUTIER Juin 2022
Les abeilles grises- Andrei Kourkov - Liliane Levy
Traduit du russe par Paul Lequesne.
Nous sommes dans un petit village ukrainienne de la « zone grise » c’est à dire situé dans le Donbass entre l’armée régulière et les séparatistes pro-russes qui se livrent à des combats acharnés. Il ne reste plus grand monde sauf Sergueïtsh et Pachka, deux ennemis d’enfance que les événements ont cependant rapprochés. Ils ont fait taire leurs différents en réunissant leurs deux solitudes ce qui les oblige à s’entraider. Pourtant ils ne sont pas du même bord puisque que Sergueïtch, apiculteur, sympathise avec un soldat ukrainien, Petro, et Patchka s’approvisionne en nourriture auprès des Russes. Le quotidien est précaire, fait de bombardements et de la crainte des snipers et Sergueïch qui a grand soin de ses ruches, choisit de les éloigner de la guerre en les transportant dans d’autres contrées plus calmes et ensoleillées où il n’y pas de combats, en Ukraine puis en Crimée, mais son ennemi « véritable œil de Moscou » veille.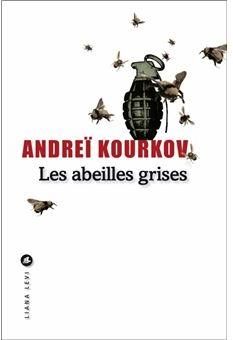
Ce roman est une sorte de fable. Les abeilles ne servent pas qu’à favoriser le sommeil, elles sont ici un symbole de paix et le miel est pour Sergueïtch plus qu’une marchandise ou une monnaie d’échange, mais c’est aussi pour lui l’invitation à la réflexion en les comparant à l’espèce humaine qui, à ses yeux, vaut moins qu’elles. Elles pourraient bien lui servir d’exemple pour le travail et l’organisation de la société. Elles sont aussi fragiles quand il les retrouve, grises et ternes après un séjour chez les Russes, un peu comme si elles avaient été contaminées ou peut-être infectées par eux pour diffuser une maladie bactériologique. Ce qu’il fait pour se délivrer de son doute est significatif. On ne coupe pas aux traditionnelles libations de vodka et de thé brûlant malgré la guerre mais c’est la vie qui prévaut, à l’image de Petro qui survit à tout ces bouleversements .
C’est évidemment un roman où fiction et réalité se confondent puisqu’il parle de cette guerre qui dure depuis quatorze années dans le Donbass. Ce n’est pas vraiment un roman aux accents prémonitoires comme « Le dernier amour du Président » qui met en scène quelqu’un qui est élu président à la surprise générale et qui doit faire face aux événements, mais il porte en lui de l’espoir. Cela évoque une réalité bien actuelle de ce pays.
Ce roman met en exergue le talent de cet auteur ukrainien, né en 1961, dont « les abeilles grises » est le dixième roman. Les descriptions qu’il fait de la nature sont agréables à lire. Ce livre est aussi l’occasion pour nous, à travers le personnage de Sergueïtch qui promène sur le monde qui l’entoure un regard à la fois humain et philosophe, de goûter l’humour ukrainien et son sens de la dérision et parfois de l’absurde. C’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’Ukraine, sur sa cuisine et le mode de vie de ses habitants et notamment sur Taras Chevtchenko (1814-1861) peintre et poète emblématique ukrainien qui symbolise la résistance de son pays contre les atteintes à sa liberté et à sa culture ainsi que l’émergence de l’esprit national. Cette référence n’est bien entendu pas sans évoquer la guerre qui a débuté en 2014 avec les revendications territoriales russes sur le Donbass et l’annexion de la Crimée et bien entendu les évènements actuels qui secouent l’Ukraine, injustement envahie et détruite par un « peuple frère » en vue de reconstituer l’ex-empire soviétique, sous la fallacieuse accusation de nazisme.
L'amie prodigieuse (enfance-adolescence) - Elena Ferrante.
Traduit de l'italien par Esla Damien. Gallimard.
Cette amitié qui lie Elena Greco, fille d'un portier à la mairie et Lila Cerullo, fille d'un cordonnier, deux petites napolitaines d'un quartier pauvre de cette ville, commence dans les années 50. Comme c'est souvent le cas, elles ne se ressemblent pas. Lila est petite, maigre, provocante et exerce un ascendant sur Elena, la narratrice, plus timide, réservée et calme. Cette période est pour elles pleine des folies et des phobies de l'enfance, les poupées qui parlent et auxquelles elles confient leurs secrets, les ogres que les terrorisent, les histoires qu'elles se racontent...et la peur de la mort avec tous ces gens, adultes et enfants, décédés de maladies ou d'accidents dans ce quartier oublié dont la vie, avec ses ragots, ses péripéties, ses violences et ces moments anodins, nous est largement détaillée. Les aléas de l'existence vont séparer ces deux amies et Lila, pourtant surdouée doit quitter l'école pour travailler dans l'échoppe de son père alors qu'Elena, un peu moins brillante, reste dans le cursus scolaire, même si Lila continue à accompagner les études de son amie, d'inspirer ses réflexions, tout en nourrissant des projets commerciaux autour de la chaussure et de l'atelier de son père. L'adolescence aussi va les séparer, et Elena, plus belle et plus vite formée, verra autour d'elle s'agglutiner les garçons quand Lila restera à la traîne, pas pour longtemps cependant. Leurs amours ne seront pas en reste puisque les deux adolescentes de quinze ans sont le point de mire des garçons frimeurs de leur quartier qui font tout pour les impressionner et s'en faire remarquer. Pour elles les choses ne seront pas si simples, soit que ceux qui les désirent sont souvent éconduits, soit qu'elles se heurtent elles-mêmes à l'indifférence, coincées entre le fantasme du grand amour de gosse et la volonté de leurs parents de réaliser pour elles un riche mariage, parfois malgré elles et le regard qu'elles portent sur les adultes est à la fois contempteur ou enthousiaste... Leurs vies vont donc se croiser, s'opposer, entre jalousie et admiration, complicité et critiques, projets avortés et amours contrariées, sur fond de souvenirs de la guerre, dans l'ombre de la Camora, du parti communiste et du Vésuve. Elles auront des idées d'avenir chacune dans leur domaine, souffriront de l'opposition entre les riches et les pauvres dont elles font partie, rêveront à l'amour, devront elles aussi abandonner leurs chimères.
Je me mets un instant à la place de Lila et de son projet d'usine de chaussures auquel elle a dû renoncer. Cette jeune fille a du caractère, c'est une rebelle, ce qui lui a valut des réprimandes du côté familial. C'est vrai qu'elle n'est pas soumise comme l'est en principe une jeune-fille italienne de cette époque. Quand on est jeune, on imagine son avenir et il n'est pas rare qu'on y croie si fort que l'on prenne cela comme une promesse de la vie. Mais cette vie ne nous fait aucune promesse ni même aucun cadeau et nos projets ne sont bien souvent que des fantasmes promis à la déception. Lila finit, à seize ans, par choisir le mariage où l'argent prend le pas sur l'amour, Elena au contraire continue d'opter pour les les études et même si c'est dur pour elle, ne néglige pas le jeu de la séduction en opposants ses différents soupirants… La séparation apparente entre les deux amies se manifeste de plus en plus parce qu'elles se retrouvent rapidement dans deux mondes différents, mais sans pour autant se perdre de vue.
C'est bien écrit et vivant, passionnant même et si on est un peu perdu dans la multiplicité des acteurs , la liste généalogique du début aide un peu à s'y retrouver et ce détail est appréciable.
C'est le premier volume d'une saga sur la difficulté de se faire une place quand la vie vous impose un départ dans la pauvreté. Il commence par l'annonce de la disparition inquiétante de Lila à 66 ans qui a toujours avoué à son amie sa volonté de disparaître sans laisser de trace. Elena remonte donc le temps pour consacrer cette amitié et ce même si elle trahit un peu la volonté de son amie, mais, ce faisant, elle veut aussi faire échec à l'oubli qui est un des grands défauts de l'espèce humaine.
Je termine en précisant que l'auteur, Elena Ferrante, nonobstant son talent d'écrivain maintenant reconnu, a, jusqu'à présent préservé son identité et sa vie privée. Je salue ce détail à un moment où bien des gens font n'importe quoi pour être connus et pour qui la notoriété est plus important que tout le reste.
Hervé GAUTIER Mars 2022
Changer-l'eau des fleurs - Valerie Perrin - Albin Michel.
Violette Toussaint, après avoir été garde-barrière, a un nom plutôt prédestiné pour son nouveau métier, elle est gardienne de cimetière ! Sa maison est un peu comme un confessionnal, elle y reçoit les confidences et les larmes des vivants qui viennent ici et, même si son mari est parti vers d’autres aventures bien terrestres, elle forme une sorte de famille décalée avec l’équipe de fossoyeurs et le jeune curé de ce village bourguignon. Dans ce lieu dédié au souvenir, Violette est un peu une veilleuse qui offre généreusement aux visiteurs un café chaleureux, mais elle en est aussi le jardinier, la chroniqueuse, l’organisatrice… On y trouve des fleurs, bien sûr, mais aussi tous les chats perdus y ont leurs habitudes et sont un peu les passeurs d’un au-delà mystérieux. Dans ce lieu, elle est y apprend plus de choses que dans les livres sur l’espèce humaine, sur la mort, sur Dieu, sur l’éternité, sur l’amour conjugal, sur la fidélité et sur le souvenir, pourtant jurés à un conjoint devant son cercueil et parfois même gravés dans le marbre. Tout cela ne pèse rien face à la réalité quotidienne et le véritable culte des morts est surtout dédié aux amants et aux maîtresses disparus. Pourtant elle est seule, serviable et dévouée mais cassée définitivement par la vie, un peu comme si un destin funeste lui collait à la peau.
Tout cela aurait pu durer longtemps quand survient un policier, à la fois curieux et un peu amoureux d’elle qui est lui-même dépositaire des dernières volontés de sa mère et témoin de ses amours tumultueuses. Leur rencontre sera une parenthèse dans la vie de Violette et peut-être un nouveau cheminement vers ce bonheur qui semble lui échapper. Elle hésitera longtemps à cause de cette destinée qui la tient en marge, qui lui interdit de vivre et d’aimer pleinement. Sa vie d’avant n’a pas été belle mais elle l’a acceptée avec ses rares joies et ses peines profondes, se laissant porter par le temps en se disant sans doute que les choses pourraient s’arranger même si elle n’y croyait pas, en choisissant de ne pas réagir, en privilégiant les rares moments de paix, en continuant à vivre entre le passé et le présent, à en avoir le vertige.
J’avoue que je ne connaissais Valérie Perrin qu’à travers l’Italie où elle a été traduite et appréciée. Le roman, malgré ses 660 pages m’a paru bien court et je ne me suis pas ennuyé, bien au contraire, tant il est prenant et agréablement écrit. J’ai eu plaisir à faire la connaissance de Violette qui n’a pas vraiment connu l’amour ni même l’affection mais qui, malmenée, trahie par la vie, et surtout humiliée par ses proches qui se sont acharnés sur elle, a toujours voulu dispenser autour d’elle tout le bien qu’elle pouvait. Son histoire est émaillée d’anecdotes drôles et émouvantes, de chagrins, de regrets, de remords de trahisons et surtout d’un deuil impossible à apprivoiser, de certitudes destructrices contre lesquelles on ne peut rien. Ce que je retiens, c’est cette longue quête d’explications menée individuellement et secrètement par Violette et par son mari. Cela ressemble à une enquête un peu maladroite où se mêlent la culpabilité, la haine des gens au sein même de cette famille, les certitudes d’autant plus solides qu’elles sont infondées et le malheureux hasard. L’épilogue de cette triste histoire qui aurait pu être belle mais ne l’a pas été, favorisera la résilience de Violette et son acceptation des épreuves qu’elle a dû subir. Il reste de ces tranches de vie une impression d’impuissance, de solitude, de mal-être, de fatalité, d’injustices, d’amour impossible, un peu comme si elle voulait se laisser porter par le temps, comme si la mort qu’elle côtoie physiquement chaque jour était sa véritable compagne qui à la fois ressemble à une attente ou à un refus. Le cheminement intérieur de Violette est bouleversant entre passivité face à la fatalité et volonté de vivre selon son désir malgré sa désespérance, sa fragilité.
J’y ai lu à travers ces histoires entrecroisées dans le temps, où certains personnages vivent la vie et l’amour entre passion et abandon, une étude pertinente sur la relation entre les hommes et les femmes, sur leur vie commune ou séparée, leurs passades ou leur amour fou, la jouissance et le dégoût, l’attachement et le mépris, l’envie et la lassitude, la misère et l’espoir, le mensonge et les compromissions. C’est un peu l’image de notre vie à tous, de nos accidents de parcours, de nos deuils, de nos résignations, de nos espoirs, de nos doutes. Cela m’a incité à découvrir une autre facette du talent de cette auteure. Elle évoque une prochaine adaptation cinématographique de ce roman. J’y serai particulièrement attentif.
Premier sang - Amelie Nothomb - Albin Michel.
Prix Renaudot 2021.
Le titre de ce roman peut susciter nombre d’explications mais on tarde un peu à comprendre qu’il évoque, non pas le duel qui doit être interrompu « au premier sang », c’est à dire lorsque l’un des deux adversaires est touché, mais cette désagréable habitude qu’à Patrick, le personnage principal, de s’évanouir « à la vue du sang frais, coulant et vivant ». C’est une sorte de rituel involontaire qui le poursuivra toute sa vie et à l’aune duquel va se dérouler une jeunesse où il va vivre ses amitiés d’adolescent, connaître ses premiers émois amoureux, les illusions et les trahisons qui vont avec.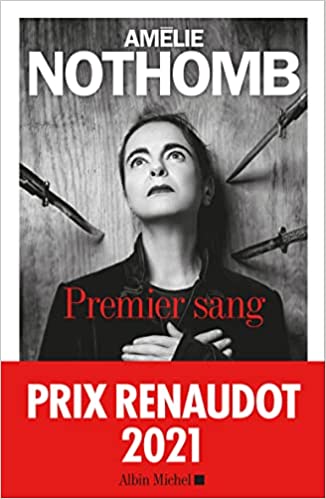
Ce livre est un hommage à son père Patrick Nothomb (1936- 2020) diplomate belge, dont le premier poste en qualité de consul de Belgique à Stanleyville en 1964 débutera une longue carrière de représentant de son pays. Séquestré avec ses compatriotes dans l’ex Congo-belge occupé par les rebelles africains de l’ « armée populaire de libération », il profitera de ses fonctions pour servir de médiateur auprès des insurgés et tenter de sauver des vies humaines et ce malgré son aversion pour le sang qui coule. Cette épreuve à laquelle ne s’attendait pas ce jeune consul a été évoquée par lui dans un livre, « Dans Stanleyville », qui retrace cette période tragique et dont notre auteure s’est inspirée. Il y parle de ce qu’il appellera plus tard le « syndrome de Stockholm » mais je retiens surtout les remarques qu’elle lui prête face au peloton d’exécution. Ces moments qui précèdent une mort certaine ont cette dimension humaine qu’est l’acceptation de son destin sans aucune révolte : admettre que son parcours s’arrête là malgré son jeune âge, qu’on n’y peut rien, qu’on a fait ce qu’on a pu, avec toute sa bonne volonté et toute sa bonne foi mais que c’est fini et qu’on accepte son sort sans regret. Il en réchappera, permettant également à de nombreux autres prisonniers européens d’avoir la vie sauve pendant cette longue prise d’otages. Sa fille choisit cet épisode de sa vie pour imaginer que l’éminence de la mort provoque chez lui une envie d’écrire, comme pour laisser une trace de son passage sur terre.
Je reprends l’habitude de lire Amélie Nothomb, surtout à cette époque de la rentée littéraire où elle choisit de publier son traditionnel roman annuel. Jusque là je le faisais, moins par l’intérêt que suscitaient ses livres que parce que, faisant partie du paysage littéraire, il fallait l’avoir lue pour pouvoir en parler. D’ordinaire j’étais plutôt déçu et je cherchais chaque année vainement à retrouver le plaisir que j’avais eu à la lecture de son premier roman « Stupeurs et tremblements » qui évoque sa première expérience professionnelle et personnelle dans une entreprise japonaise. Ici c’est l’histoire de son père, Patrick Nothomb, ambassadeur, décédé en à 83 ans à qui elle adresse une sorte d’adieu. Ce n’est pas un hommage mélancolique comme on pourrait s’y attendre mais au contraire un témoignage solaire, humoristique même, où, s’effaçant derrière lui, elle lui donne directement la parole. Au départ, il évoque, dans les années 40, sa jeunesse d’orphelin de père entre une mère, veuve définitive et femme du monde, des grands parents maternels aristocrates et des vacances ardemment désirées, à la fois spartiates et rurales, chez un oncle, poète et chef d’une tribu d’un autre âge qui vaut son pesant d’originalité. J’avoue avoir été conquis par le récit, ce qui me fait dire qu’Amélie Nothomb n’est jamais aussi passionnante que lorsqu’elle parle d’elle ou de sa parentèle, c’est à dire qu’elle choisit le registre intimiste.
J’ai apprécié le style fluide et jubilatoire qui est le sien depuis le début et qui a l’avantage de générer une lecture agréable et, comme c’est le cas ici, émouvante.
Hervé GAUTIER – Janvier 2022
La plus secrete memoire des hommes - Mohamed Mbougar Sarr -
Prix Goncourt 2021.
Éditions Philippe Rey/Jimsaan.
Au départ, c’est à dire en 2018, pour Diégan Latyr Faye, jeune auteur sénégalais, talentueux et ambitieux mais inconnu, il y a la rencontre à Paris avec un livre mythique paru en 1938 « Le labyrinthe de l’inhumain »de T.C. Elimane (en réalité de son nom africain Mbin Madag Diouf), un écrivain un peu mystérieux et controversé, connu pour avoir été le « Rimbaud nègre », dont le chef d’œuvre d’abord salué par la critique, déclencha un scandale à cause d’une accusation de plagiat, ce qui fit disparaître son créateur de la scène littéraire. Diegan vit à Paris en tant qu’étudiant, rencontre une foule de gens, des femmes surtout, et d’ailleurs parmi tous ceux qu’il croise, et ils sont nombreux, beaucoup veulent devenir écrivains et plus précisément écrivains de langue française.
Dans la première partie le « Journal estival » est consacrée notamment à différents commentaires sur ce roman ainsi que sur celui écrit par Diégan « L’anatomie du vide » qui n’a pas lui non plus connu un grand succès. J’avoue que je me suis un peu ennuyé à cette lecture malgré l’érudition du texte. En revanche, la partie qui traite de la vraie histoire d’Elimane, ou peut-être aussi de sa légende, racontée par Siga D. , qui est sa cousine, et aussi par d’autres personnes qui l’ont approché ou ont connu certains de ses amis, est bien plus passionnante. Chacun donne sa version mais on apprend ses ascendances, le « secret » de sa conception, le déroulé de son parcours, l’accusation de plagiat dont il a fait l’objet. C’est à mon sens là que commence véritablement le roman. La présence des femmes est dans cette œuvre des plus importantes, soit qu’elles sont sensuelles, amoureuses (elles font beaucoup l’amour) et même parfois porteuses d’une charge érotique certaine, soit qu’elles témoignent de l’itinéraire d’Elimane, mais ce qu’elles en disent épaissit en réalité le mystère autour de lui, suscitant ambiguïtés, interrogations et fantasmes. Il est l’homme d’un seul livre et sans doute quelqu’un dont St Thomas d’Aquin conseillait de se méfier. D’ailleurs la vie de tous ceux, et celles, qui l’ont approché a été bouleversée et Diégan n’y échappe pas qui, fasciné par ce livre, s’est mis dans la tête de le retrouver. Cet écrivain est d’autant plus inquiétant qu’au cours de ses investigations Diégan s’aperçoit que certains de ses lecteurs, dont la plupart étaient des lettrés, des critiques littéraires, souvent des détracteurs, se sont suicidés après avoir lu « Le labyrinthe de l’inhumain » ce qui n’est pas sans susciter des interrogations sur la responsabilité d’un écrivain sur le message qu’il délivre à ses lecteurs. Il faut se souvenir aussi qu’Elimane est l’héritier, de part ses origines, d’une culture africaine différente de la nôtre et empreinte de magie irrationnelle. Que ces suicides inexpliqués, mais qui sont peut-être de simples coïncidences, trouvent un commencement d’élucidation dans le pouvoir des mots et le désir de vengeance de l’auteur, pourquoi pas ? De là à penser que ce roman est maudit, il n’y a peut-être qu’un pas ! Je remarque néanmoins que si, parmi tous ceux qui ont lu ce livre beaucoup se sont suicidés, Diégan et Siga D . eux, sont restés en vie, peut-être pour témoigner de leur passage sur terre par l’écriture parce que c’est ce qui a des chances de survivre à l’auteur.
Cette recherche donne un voyage labyrinthique, à travers les luttes politiques, une véritable errance sur trois continents, l’Afrique, l’Europe, l’Amérique, évoquant le titre même du roman de T.C. Elimane et correspondant de la part de cet écrivain à une fuite, à la recherche de quelque chose ou de quelqu’un, peut-être de lui-même et de son destin? La quête menée par Diégan est frustrante au début puisqu’il ne rencontre que des gens qui ont connu directement ou indirectement Elimane et qu’il n’a jamais à sa disposition que des témoignages parfois contradictoires, c’est à dire qu’il ne le retrouve jamais. Cela donne un portrait assez flou mais dessiné comme on assemble les pièces d’un puzzle. En réalité Mohamed Mbougar Sarr fait de cet auteur un véritable personnage de roman, un homme mythique insaisissable et qui se dérobe sans cesse . En effet, ce texte est dédié à Yambo Ouologuem (1940-2017), un écrivain malien, bien réel celui-là, puisqu’il obtint le Prix Renaudot en 1968 pour « Le devoir de violence » mais qui fut, lui-aussi, accusé de plagiat et oublié de tous. Mohamed Mbougar Sarr s’inspira de sa vie sans pour autant la copier puisqu’il fait naître son héro au cours de la guerre de 1914, au moment où son père, un tirailleur sénégalais, meurt dans les tranchées de la Somme. Il a au moins l’intérêt d’évoquer cet auteur, c’est à dire de le faire revivre. Ce livre s’ouvre également sur une citation du poète chilien Robert Bolaňo qui donne son titre au roman de Mbougar Sarr et surtout qui évoque la vie d’une Œuvre, son parcours dans le temps et sa mort inévitable, comme meurent toutes les choses humaines.
A la fin de ce roman Diégan évoque, à travers l’écrivain congolais Musimbwa anéanti par son expérience parisienne, la mort, celle de l’Afrique, de sa culture, de ses traditions, de ses légendes, de ses mystères, qui a cédé devant la colonisation française en faisant d’Elimane à la fois le produit et l’aboutissement de cette colonisation puisqu’il a réussi à s’exprimer en français par l’écriture et qu’il souhaitait être reconnu comme un authentique écrivain, mais aussi le symbole de sa propre destruction puisqu’il n’a pas été reconnu pour ce qu’il voulait être et qu’on l’a précipité dans l’anonymat, la solitude et l’anéantissement. Finalement tout cela n’a été pour lui qu’un leurre et il estime qu’Elimane a été exclus de ce jeu, non à cause du plagiat mais parce qu’il incarnait cet espoir impossible. Il en tire des leçons pour ce peuple d’Afrique qui courre derrière l’Europe et qui évidemment connaîtra le même sort. Musimbwa ne se voit d’avenir qu’en Afrique et lance à Diégan un défi, celui de découvrir à sa manière le vrai message d’Elimane, d’être s’il le peut, un écrivain-témoin. Il revient chez lui comme le lui conseille son ami, retrouve les traces d’Elimane mort depuis un an et recueille son message. Il sera son témoin par l’écrit parce qu’il comprend enfin le sens de son livre, mais retourne à Paris parce que l’écriture est sa vie, qu’il se doit d’y obéir.
Je note la longueur de certaines phrases, parfois de plusieurs pages qui, même si elles sont fort bien écrites, ne facilitent pas la lecture. Personnellement je les préfère courtes et même si on peut y voir une référence à Marcel Proust et à Mathias Enard, il convient de remarquer que ces trois romanciers ont été couronnés par le prix Goncourt ! Cela n’empêche pas ce roman d’être fascinant tant par l’histoire qu’il déroule sous nos yeux que par le style de son auteur, par ses descriptions, par sa poésie, par son érudition et par l’intérêt qu’il suscite chez son lecteur. J’ai ressenti personnellement une impression de solitude, de déréliction et de désespérance dans ce texte, une sorte de malaise né d’une quête impossible, d’une impuissance, un peu à la manière de ce qu’on peut éprouver quand ce qu’on veut atteindre se révèle définitivement hors de notre portée et le demeurera.
Finalement Diegan achèvera sa quête mais pas exactement de la manière qu’il souhaitait et pas non plus en ayant trouvé ce qu’il recherchait, l’ombre d’Elimane n’ayant cessé de se dérober. Cet ouvrage est aussi une réflexion sur les écrivains, sur les critiques mais surtout sur la littérature, ses fondements, ses motivations, sur l’écriture et son alternative (écrire ou non, et même impossibilité d’écrire, c’est à dire exprimer vraiment ce qu’on veut dire), son importance comme des traces laissées après la mort de son auteur.
Cela dit, que le Jury Goncourt ait couronné un écrivain étranger d’expression française est toujours une excellente chose puisque cela conforte la francophonie qui est, malheureusement, bien en danger. Cela met également en lumière un romancier original et une voix africaine trop absente de notre littérature.
Je n’ai pas toujours été d’accord avec ce prestigieux prix et n’ai pas manqué de la dire dans cette chronique mais ici j‘ai plaisir à saluer ce roman.
Hervé GAUTIER – Décembre 2021
Tuer le fils - Benoit Severac - La manufacture des livres.
Matthieu Fabas, 35 ans,sort juste de quinze ans passés en prison pour avoir tué un homosexuel. Il avait commis ce meurtre pour prouver sa virilité à son père, un « néonazi, motard, fiché S », et ce dernier vient d’être assassiné dans des circonstances étranges, un meurtre apparemment déguisé en suicide. Parmi toutes les pistes explorées par le commandant Cérisol et ses deux adjoints, Nicodem et Grospierres, celle du fils est sérieuse.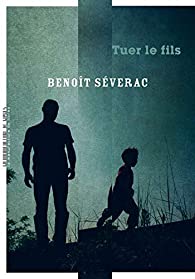
Les relations n’ont jamais été très bonnes entre Matthieu et son père, surtout depuis la mort de sa mère alors qu’il n’avait que 8 ans, la période d’incarcération n’a pas arrangé l’incompréhension paternelle et cette cryptorchidie dont était affublé Matthieu n’a fait qu’aggraver les choses aux yeux de son père. Si Cérisol parvient à apprivoiser sa vie et à accepter l’absence d’enfant liée au handicap de son épouse devenue aveugle, avec des confitures auxquelles il est accroc, Matthieu lui a trouvé pendant son incarcération une consolation inattendue dans l’écriture et son cahier, maintenant entre les mains du commandant, pourrait bien être pour lui une source d’accusations. Un roman autobiographique et inédit, suscité par l’animateur d’un atelier d’écriture en milieu carcéral, a même été écrit par le détenu. On songe à l’effet cathartique et donc résilient de l’écriture.
J’ai apprécié l’analyse psychologique des personnages fondée sur l’observation et l’interaction des relations entre eux. C’est valable non seulement au sein même de l’équipe des policiers, opposant le fils d’émigrés dépressif (Nicodemo), bénéficiaire de l’ascenseur social et celui qui n’est dans la police que par hasard pour conjurer le chômage (Grospierres), mais dont la formation universitaire, l’obstination et la clairvoyance se révéleront déterminantes dans les investigations. Entre Cérisol et Grospierres, s’établira une sorte de relation père-fils particulière, quelque peu mise à mal cependant par la ténacité de ce dernier et l’ego du commandant, le tout au milieu des états d’âme des policiers face à leur fonction de maintient de l’ordre dans une société humaine chancelante, sans oublier la sphère privée de chacun d’eux…Entre Cérisol et son épouse s’établit une sorte d’équilibre, eux dont le mariage résiste grâce à un subtil mélange de sexe, d’acceptation des différences de l’autre et, sans doute, de l’absence d’enfant voulue par elle et qui sont souvent une source de nombreuses dissensions au sein d’un couple. Pour lui la paternité reste pourtant un rêve inaccessible.La relation entre Matthieu et l’animateur est aussi intéressante : Ce qui n’est au départ pour le détenu qu’une manière originale de passer le temps se révèle bien plus importante à travers la démarche d’écriture. En effet, le fait de mettre en perspective les remarques personnelles de Matthieu sur son père dans le cadre de son cahier et le sort qu’il réserve au personnage paternel dans son roman peut se révéler déterminant dans l’enquête. (ou comment l’animation d’un atelier d’écriture peut n’être pas si anodine que cela ?).Le plus intéressant est la relation père-fils difficile, entre la volonté paternelle de façonner sa progéniture à son image, de lui inculquer ses valeurs et celle, non moins grande, du fils de s’affirmer par rapport à elle, de la combattre, entre admiration refoulée, contestation de l’autorité, nécessaire émancipation et volonté d’être reconnu. Ici Matthieu, rejeté par son père, est devenu meurtrier dans le seul but de lui prouver qu’il se trompait à son sujet mais son geste a manqué son but, créant à la fois cette frustration et une prise de conscience de la responsabilité paternelle révélée par l’écriture. Ce polar échappe aux clichés ordinaires du roman policier et notamment dans le titre lui-même puisqu’il est l’exact contraire de la formule œdipienne convenue qui veut qu’un fils s’oppose à son père pour s’affirmer et se construire, c’est à dire le tue virtuellement. Le rôle du père est paradoxalement d’aider son fils dans cette démarche difficile mais nécessaire. Ici, c’est différent, le père et le fils ne s’entendent pas mais Matthieu est devenu meurtrier pour attirer l’attention paternelle, même si pour cela il a enfreint la loi et fait de la prison. Ainsi ses écrits y font-ils de constantes références, comme autant de marques d’admiration, de constats d’échec et de demandes de reconnaissances. Mais les choses sont plus profondes et surtout plus anciennes et se résument à une image obsédante et insupportable pour le père, atteint dans sa virilité même, que lui renvoie son propre fils et qui justifie à ses yeux son attitude de rejet.
Le titre de ce roman peut s’expliquer, non seulement à cause d’une habille mise en abyme (je passe sous silence le clin d’œil malicieux au best-seller « Le roman de l’année ») mais surtout à une subtile relation entre l’animateur ayant perdu toute inspiration et Matthieu dont, sans vergogne, il s’approprie le talent pour relancer sa carrière d’écrivain. Il joue sur les rapports délétères père-fils et les ressentiments qui en découlent, non seulement pour que soit créée par un autre une œuvre d’art (« au nom de la littérature »), mais surtout pour s’en approprier les mérites. J’imagine la suite, Matthieu, condamné à une lourde peine pour un crime qu’il n’a pas commis, sortant enfin de prison et prenant conscience du plagiat, cherchera à se venger ! Ce roman a une dimension personnelle dans la mesure où l’auteur a été animateur d’un atelier d’écriture en milieu carcéral, mais la remarque, sans doute, s’arrête là. Il évoque la révélation d’un talent créatif chez un détenu, la découverte par ce dernier de la force purgative des mots qui est une forme de liberté, entre autobiographie et autofiction, et cela a quelque chose de passionnant et d’authentique. Il y a une analyse subtile de l’écriture, l’indispensable inspiration venue d’ailleurs, la disponibilité de celui qui tient le stylo et fait appel à des souvenirs souvent enfouis, le nécessaire travail sur les mots et leur effet curatif, les illusions de l’écrivain, l’incontournable difficulté qui naît de la volonté de s’exprimer et l’impression qu’on peut ressentir de n’avoir pas pu le faire pleinement.
Le message que je retiens aussi c’est l’importance des mots, leur valeur quand ils s’inscrivent dans ce qui est censé être une fiction dont nous savons qu’elle peut aussi avoir des connotations personnelles. Toute la difficulté est de faire la part des choses entre ces deux notions, ce qui est pour le lecteur un œuvre d’art peut être pour le policier un aveu, un faux témoignage ou un mobile ! Cela peut bouleverser également les rapports hiérarchiques et personnels au sein d’une équipe, où, comme dans la vie, rien n’est jamais acquis.
C’est donc un roman qu’il faut lire moins comme l’évocation d’une enquête policière classique avec ses rebondissements que comme une étude psychologique de personnages et de faits apparemment inattendus et anodins qui éclairent l’intrigue. Non seulement le suspens est adroitement distillé tout au long du roman, ce qui est bien le moins pour un thriller, mais c’est aussi écrit dans le style fort agréable à lire, pas vraiment académique mais pas graveleux non plus, comme cela arrive parfois dans ce genre de littérature. Cela a été pour moi un passionnant moment de lecture.
Benoist Séverac a été lauréat du Prix Cezam régional 2021.
Ce roman est dans notre bibliothèque.
"Hervé Gautier -Novembre 2021"
Betty - Tiffany Mc Daniel - Gallmeister.
Traduit de l’américain par François Happe.
Betty, c’est la narratrice, née en 1954 dans l’Ohio d’une mère blanche et d’un père Cherokee. Elle nous raconte l’histoire de sa famille, de cet homme et de cette femme apparemment faits l’un pour l’autre et de leur parcours dans la vie. C’est aussi un vibrant hommage à son père, travailleur infatigable et attentif à sa maisonnée qui sait lui transmettre la culture indienne, pratiquer la médecine empirique et vivre dans le respect de la nature. Plus que ses autres enfants, Betty sera pour lui « la petite indienne » à qui il va transmettre son savoir auquel elle va ajouter la folie et la naïveté de l’enfance et, dans une sorte de syncrétisme, y intégrer le message du christianisme et de la culpabilité judéo-chrétienne inévitable. Pour elle l’écriture sera, malgré son jeune âge, déjà un exorcisme. Elle écrit des histoires pour redessiner le monde autour d’elle et conjurer les fantômes de son enfance. Cette famille restera à part de la communauté et, compte tenu de ce contexte, la pauvreté, le racisme, l’intolérance, l’exclusion, la marginalité, l’errance font aussi partie du décor, mais aussi, comme en contrepoint, toute la magie de la poésie et de la sagesse indiennes
La figure de ma mère reste douloureuse et marginale par rapport à celle du père. Son domaine à elle c’est la maison, le quotidien et son rôle de protectrice de la famille la libère un peu de son passé obsessionnel. C’est à Betty et à aucun autre de ses nombreux enfants qu’elle confie ce qu’a été son enfance difficile faite d’inceste paternel et de passivité maternelle au point que la petite fille a du mal à comprendre ce qu’ont été ces épreuves si lourdes à porter qui, même longtemps après, se réveillent sans crier gare et l’ont conduite au bord de la mort. Elle les traînera toute sa vie. Pour autant cette famille n’a rien d’idyllique et c’est, sans doute au nom de l’exemple reproduit, qu’un des garçons viole une de ses sœurs. Dans ce microcosme familial le père représente le coté merveilleux, avec ces histoires extraordinaires, sa façon de vivre dans un autre monde et la mère le côté à la fois réel et obsessionnel. Les enfants de ce couple grandissent dans ce contexte aimant et complice, pleins de rituels puérils, avec la peur et l’envie de grandir, de voir le monde à l’extérieur de cette petit ville de Breathed où ils habitent, l’espoir et la crainte du lendemain, du temps qui passe et la mort qui peut frapper à tout moment...Pourtant, ces liens qui les unissaient finissent par se distendre et chacun part dans sa direction. C’est aussi un regard aiguisé porté sur la société de cette Amérique profonde inchangée depuis des générations.
Ce que je retiens avant tout, au-delà de l’hommage, c’est la démarche de mémoire, l’échec à l’oubli qui est une grande constance de l’espèce humaine, pour que la parentèle de l’auteure garde le souvenir de ce couple à la fois ordinaire et exceptionnel. C’est aussi un texte initiatique de passage de l’enfance à l’âge adulte, un livre sur les secrets de famille et ses dénis, les non-dits. Je ne me suis pas ennuyé au long des sept cents pages de ce récit anecdotique découpé en chapitres distillé sous l’égide alternatif de faits divers relatés répétitifs et mystérieux par le journal local, de versets de la Bible et dans l’omniprésence de Dieu et du péché, ce qui réalise une sorte de synthèse religieuse avec les légendes indiennes et du quotidien. J’ai senti une sorte de doute sur Dieu quant à son absence d’action sur La vie des hommes autant que le poids réaffirmé de son double, le diable ce qui met en lumière la dualité traditionnelle de cette religion autant que les fantasmes et les phobies populaires.
J’ai aimé cette saga bien écrite et agréable à lire, un texte poétique et émouvant qui retient l’attention de son lecteur jusqu’à la fin.
"Hervé GAUTIER - Octobre 2021"
L'age du doute - Andrea Camilleri - Fleuve Noir
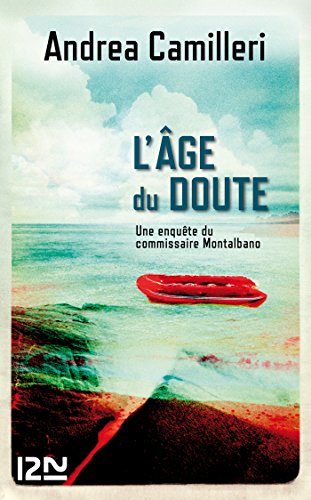
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani
Un yacht de luxe vient d’aborder dans le port de Vigatà avec, à son bord, le cadavre d’un homme défiguré et nu, trouvé en mer sur un canot de sauvetage. Cela promet des ennuis en respectives pour la propriétaire, la Giovannini, une femme autoritaire, carrément nymphomane qui est aussi passagère, le commandant Sperli et son équipage. Ils vont devoir attendre la fin de l’enquête. Les choses se compliquent un peu avec l’arrivée d’un bateau de croisières dont la présence au port paraît assez étrange, la révélation d’informations qui ne le sont pas moins et d’un mort supplémentaire.
Le commissaire Salvo Montalbano est de plus en plus tracassé par son âge (58 ans) et par la retraite qui s’annonce. Il peut d’ailleurs compter sur le médecin-légiste pour le lui rappeler, lequel ne s’en prive d’ailleurs pas. Il a conscience qu’une page s’est tournée dans sa vie sentimentale et que le temps a sur lui fait son œuvredestructrice.Ses amours avec Livia, son éternelle fiancée génoise, sont lointaines et épisodiques et c’est sans doute pour tout cela qu’il a des doutes sur sa capacité de séduction. Elle va d’ailleurs être mise à l’épreuve par la rencontre, dans le cadre de cette enquête, avec LauraBelladona, la séduisante lieutenante de la capitainerie du port. Leurs relations éphémères oscillent entre la volonté de se laisser porter par les événements et d’en retirer le meilleur et celle de bousculer le destin, une sorte de valse entre hésitation et attirance avec la crainte de remettre en cause tous ses propres projets et ce qu’on croit acquit définitivement.Dans ce genre de situation les espoirs les plus fous germent dans les têtes et l’imagination n’a plus de limite. C’est que cette jeune femme bouleverse à ce point notre commissaire qu’elle le met, sans le vouloir vraiment, face à lui-même, avec son âge, ses désillusions, ses folles pensées,ses accès secrets de culpabilité, et malgré tout, son charme naturel continue à agir au point qu’elle même en est ébranlée. C’est une très belle femme, comme son nom l’indique, mais les phases de cette enquête vont la faire douter d’elle-même, de son avenir, sans qu’on sache très bien si elle choisit son destin ou si elle s’abandonne aux circonstances, entre prémonition et renoncement. La fatalité, le hasard ou une quelconque divinitérégleront la tranche de vie de ces deux êtres qui peut-être envisageaient des moments intimes passionnés ou un futur commundifférent, malgré tout ce qui peut raisonnablement les opposer, mais nous savons tous fort bien qu’en amour la raison est souvent mise de côté. Ce genre de doute arrive à tout âge et le nom que porte cette jeune femme est aussi celui d’un poison. C’est donc un roman policier bien construit, sans doute un des meilleurs que j’aie lu sous la plume de Camilleri, plein de rebondissements et de suspense qui tiennent en haleine son lecteur jusqu’à la fin, mais c’est aussi une réflexion sur la vieillesse, sur le pouvoir de séduction qui disparaît avec les années mais qui peut ressurgir sans crier gare, une illustration des paroles d’Aragon : « Rien n’est jamais acquit à l’homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur et quand il croit ouvrir les bras son ombre est celle d’une croix, sa vie est un étrange et douloureux divorce, il n’y a pas d’amour heureux ». J’ai éprouvé ici, ce qui arrive rarement dans un roman policier, même sous la plume de Camilleri, ce supplément d’émotionqui fait que l’intrigue policière, pourtant intense et passionnante, passerait presque au second plan.
Mais restons pour cette enquête, dans le contexte de la séduction, puisque Montalbano charge son adjoint Mimi Augello, de séduire la propriétaire du bateau, mais dans le seul but de faire avancer l’enquête et de favoriser la manifestation de la vérité, évidemment ! Son côté « donnaiolo »(comme disent si joliment nos amis italiens) est bien connu du commissaire mais il y a fort à parier que cette fois il fera du zèle « professionnel »ce qui, accessoirement, suscitera chez son supérieur vieillissant une sorte d’envie.
Entre ses rêves parfois morbides, ses obsessions, ses jalousies, ses fantasmes, Salvo se débat comme il peut avec cette enquête qui finalement le dépasse,et les obsessions administratives du Questeur,entre improbables mensonges et investigations perturbées par sestourments amoureux. C’est pour lui l’occasion de réfléchir sur l’amour, le désir sexuel d’une femme, de regretter les ravages de l’âge et le mirage des impasses ...En tout cas ça lui occasionne des états d’âme dévastateurs au point de se laisser aller à écouter la voix de sa conscience et de discuter avec elle. Ce soliloque serait plutôt le signe d’un vieillissement prématuré. Reste que cette enquête perturbe tellement notre commissaire qu’il y associe l’ombre de la mafia.
L‘âge qui paraît tant tracasser Montalbano n’entame en tout cas pas son appétence pour les pâtes ‘ncasciata, pourla caponata ou le rouget frit, et quand il ne profite pas de la carte alléchante de son ami le restaurateur Enzo, il se goinfre des réalisations culinaires d’Adelina sa femme de ménage, ce qui ne doit arranger ni son poids ni son taux de cholestérol !
Camilleri est, à tort ou à raison, considéré comme le Simenon sicilien. Il y est d’ailleurs fait, dans cet ouvrage, une référence à un de ses personnages. La figure de Montalbano a été popularisée en France par l’adaptation des intrigues policières de Camilleri pour la télévision. Il est incarné avec talent à l’écran par Luca Zingaretti mais je ne retrouve pasexactement, dans son jeu d’acteur, l’image que je me suis faite du commissaire à travers les romans.
" Hervé Gautier - Septembre 2021"
Clair de femme - Romain Gary - Gallimard.
C’est l’histoire d’une rencontre. Lui, Michel, commandant de bord, un peu paumé parce qu’il vient de perdre sa femme, Yannick, d’un cancer, laquelle a choisi de se donner la mort, pour partir en beauté à tous les sens du terme, c’est à dire avant que les ravages de la vieillesse et de la maladie ne soient visibles sur son corps (ne pas vieillir était une préoccupation de Gary). Il veut partir pour Caracas. Elle, Lydia qui vient de perdre sa fille dans un accident de voiture que conduisait son mari. Il n’est plus qu’un survivant dans un service de psychiatrie. C’est un peu le hasard qui les met en présence l’un de l’autre, au sortir d’un taxi, Michel bouscule sans le vouloir Lydia. Ils ont à peu près le même âge, la même peine, la même désespérance , une même envie de mourir, mais aussi de vivre ensemble une sorte d’expérience qui serait d’une nature particulière car basée sur cette volonté d’unir deux vies détruites qui individuellement demandent du secours. Ils feront un petit bout de chemin ensemble mais sans oublier leurs souvenirs propres, sans pouvoir jamais déposer le fardeau que le destin a mis sur leurs épaules , sans omettre qu’ils sont fragiles, qu’il sont mortels.
Il y a aussi le personnage du Señor Galba qui est loin, à mon avis, d’être secondaire, cet artiste de Music-Hall, vieux dresseur de chiens et de singes,fataliste, désabusé, désespéré qui symbolise lui aussi, mais à sa manière, le côté transitoire, dérisoire et pathétique de la vie qu’il combat par un alcoolisme militant. Comme en scène, il aura le dernier mot.
En réalité c’est une longue réflexion sur le couple, les espoirs qu’on met en lui au début et aussi les illusions de durée, de sincérité, de fidélité, toutes choses qui ne peuvent exister qu’idéalement puisque nous ne sommes que des hommes, mortels et imparfaits, seulement usufruitiers de notre propre vie. Nous faisons semblant de croire que cette réunion d’un homme et d’une femme incarne le bonheur, que cette fusion est une nouvelle naissance, une rupture avec le passé, mais c’est oublier que le malheur est une constante de la condition humaine à laquelle nous sommes tous assujettis, que l’amour est une chose consomptible mais peut aussi être dévorante, que la vie est une comédie où chacun s’efforce de jouer un rôle acceptable jusques et y compris en se mentant à lui-même et aussi en mentant aux autres. Michel et Lydia viennent avec leur propre histoire, leurs obsessions, leurs espoirs déçus par cette vie qui n’a pas tenu ses promesses, c‘est à dire des illusions dont, enfants, ils l’ont, comme nous tous, unilatéralement chargée, sans qu’elle soit le moins du monde responsable de leurs fantasmes. C’est à l’aune de ces résultats que nous décidons si elle a ou non été réussie. Michel ne cesse de penser à Yannick et la fait revivre, selon le propre vœux de celle-ci, dans la personne de Lydia qui sera son « Clair de femme », comme un clair de lune éclaire le noir de la nuit. La quarantaine qui est un de leur point commun leur permet d’envisager un avenir dans un nouvel amour, mais ses cheveux déjà blancs malgré la quarantaine et ses rides sont un rappel de la réalité. Chacun d’eux à ses fantômes qui seront ses compagnons intimes et le resteront jusqu’à la fin et peut-être feront-ils ce choix d’un saut dans l’inconnu, ou peut-être pas ? Pour eux chaque jours sera un combat entre Éros et Thanatos, une de ces luttes où chacun apportera sa part d’amour pour l’autre en connaissant le fragilité de cette communion. Lydia est très consciente de l’état d’esprit de Michel et lui propose un temps de réflexion avant de choisir, une sorte de période sabbatique, soit parce qu’elle craint de ne pas être à la hauteur de ses attentes, soit parce que la solitude est aussi une réponse pour chacun parce qu’elle invite à la méditation, soit parce que Michel devra compter sur le temps, beaucoup de temps, pour s’arracher à son passé.
C’est un truisme que de dire qu’il y a toujours un peu de l’écrivain dans ce qu’il écrit, quoiqu’il en dise lui-même et ce même s’il inscrit sa création dans la plus proclamée des fictions. Ici, il y a beaucoup de connotations avec la vie même de Romain Gary, cette permanence de l’amour pour une femme qui perdure malgré toutes celles qui peuvent suivre dans sa propre vie, son impuissance face à l‘adversité, symbolisée ici par la maladie, son attitude face à la mort (Il se suicide comme, avant lui, Jean Seberg qui fut son épouse), son parti-pris d’écrire pour exorciser ses obsessions et peut-être aussi le sentiment d’échec face à cette relative impossibilité...
Romain Gary n’a évidemment rien d’un être du commun, tout chez lui est exceptionnel, sa jeunesse, son parcours, sa culture, ses engagements, sa créativité, son style, son phrasé simple, accessible, poétique, mais néanmoins plein de sens et de sensibilité, d’analyses des sentiments et des choses de la vie qui sont pour nous tous pleines d’espoirs et de contradictions. Il n’a jamais caché l’intérêt qu’il portait à « la femme » (non pas aux femmes), cet être un peu mystérieux et idéalisé par ses soins (et par nous aussi sans doute), compagne complice et néanmoins secrète, proche et étrangère à la fois qui forme avec l’homme choisi quelque chose de durable et d’éphémère, qui porte en lui des espoirs d’immortalité et des craintes d’échecs. Il y a du romantisme chez lui mais ce que je retiens, à titre personnel, c’est à la fois la solitude de l’homme et la difficulté pour l’écrivain de mettre des mots sur ses maux. Je ne suis pas un spécialiste de l’œuvre de Gary, mais il me semble me souvenir que dans la lettre qu’il laissa lors de son suicide figurent ces mots « Je me suis enfin exprimé entièrement ».
Hervé Gautier - Août 2021
Le desert des Tartares - Dino Buzzati - Robert Laffont.
Traduit de l'italien par Michel Arnaud.
Giovanni Drogo est content, il vient d'être promu officier au sortir de l'école militaire… Depuis le temps qu'il attendait cela ! C'est pour lui le commencement de la vrai vie, celle d'un soldat, d'un combattant qui va se couvrir de gloire... Oubliés des chambrées glaciales, les réveils en plein hiver, les corvées...Il est maintenant lieutenant et a reçu sa première affection pour le Fort Bastiani qu'il rejoint après une longue chevauchée. Il a le temps d'imaginer les lieux où il doit rester plusieurs mois mais quand il est enfin arrivé, il constate que l'édifice est plutôt modeste, vieux et surtout situé sur une frontière désertique, défend un col où il ne passe jamais personne, bref dans une contrée désolée, au milieu de nulle part, inquiétante même. Pourtant l'ennemi est toujours présent et menace, c'est à tout le moins ce qui se dit. D'emblée le paysage exerce sur Drogo une véritable fascination et, alors qu'il avait eu le projet de ne rester que quatre mois et d'en partir sous un faux prétexte médical, il choisit d'y rester. Au bout de deux années, il se passe enfin quelque chose, mais rien en tout cas de ce que peut espérer un soldat valeureux qui désire se battre. Il doit se contenter de rêver à des actions héroïques improbables. Il y eut bien quelques occasions où le destin aurait pu être favorable à ses espoirs de gloire, mais finalement ce ne furent que de fausses alertes et il retomba dans sa léthargie coutumière. Au bout de quatre années de présence au fort, Drogo obtient enfin une permission, part pour la ville mais s'y sent maintenant étranger comme il l'est à sa mère et à Maria, son amour de jeunesse. La garnison du fort est réduite mais il reste à son poste et au bout de quinze années, alors qu'il a été promu capitaine, il croit pouvoir enfin se battre puisque l'ennemi se manifeste, mais en vain. Au bout de vingt ans de service au fort, il est commandant et alors qu'il pourrait être relevé il ruse avec les certificats médicaux pour demeurer ici alors qu'il est miné par la maladie. Ce n'est qu'au bout de trente ans de présence que l'ennemi se décide enfin à attaquer mais Drogo, épuisé et malade doit être rapatrié et ne combattra pas sinon contre sa propre mort.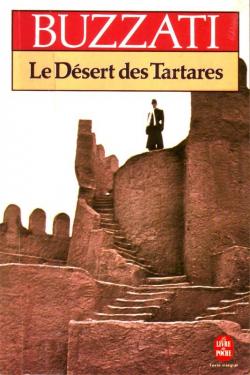
Drogo ne fait pas autre chose qu'attendre une attaque ennemie devenue mythique tant elle tarde. Pire peut-être, il est frustré de ses espoirs de combats et de gloire par la maladie et assiste impuissant à la montée en ligne de jeunes officiers ambitieux qui auront l'opportunité de combattre et de se distinguer. Le plus étonnant sans doute c'est que, malgré l'inconfort et l'austérité de la vie militaire, la routine parfois absurde du règlement et la dureté du quotidien dans cette contrée dépouillée, Drogo choisit de son plein gré d'y demeurer, animé du seul espoirde se battre qui occupe constamment son esprit et ce malgré la peur de cet ennemi invisible. Est-ce le décor ou l'ambiance générale du lieu mais chacun, dans cet univers étrange qui suscite une sorte d’hystérie collective, semble vivre dans une sorte d'expectative. J'y vois à titre personnel une manifestation du destin contraire qui, sous les formes les plus diverses et quoique nous fassions pour réaliser nos rêves, se trouvera constamment en travers de votre route au point qu'au bout du compte, et malgré toute votre bonne volonté, nous finirons nous-mêmes par culpabiliser et par nous dire que nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait. Ces choix que nous faisons, en croyant de parfaite bonne foi qu'ils sont bons pour nous, pour notre vie et notre avenir, se transforment en désastre. Pour nous rassurer, nous finissons par nous dire que soit nous n'y sommes pour rien soit ils étaient finalement une erreur que bien entendu nous ne referions pas, que les événements nous ont été contraires... Complémentairement au thème de l'échec, c'est aussi celui de l’incertitude face au quotidien, celui aussi de l'espoir déçu. Tout cela distille une atmosphère de déréliction qui gagne chacun face à « la ville » qui, exerce, avec les femmes et les plaisirs, une sorte de fascination mais Drogo choisit pourtant de la fuir, étranger qu'il est désormais à sa vie d'avant.Même sa mère etson amour de jeunesse ne lui suffisent plus, seuls le désert et ses espoirs fous d’héroïsme le maintiennent en vie. La fuite du temps est aussi un sujet qui est particulièrement marqué dans ce texte par l'attente interminable de Drogo qui finit par se demander ce qu'il attend réellement. Il finira pas admettre que c'est sa propre mort et, face à cela, il prendra conscience de sa déchéance physique, de l'inutilité de sa propre vie. Cette œuvre, inspirée à l'auteur par son travail routinier de journaliste au « Corriere della serra », parue en 1940, est écrite dans un style somptueux. Elle est émaillée de passages poétiques et a une dimension philosophique étonnamment humaine au point qu'elle a inspiré films et chansons et a rendu Dino Buzzati célèbre dans le monde entier.
En effet, dès lors que nous venons au monde, la seule certitude est que nous le quitterons. Entre ces deux dates, destin, liberté, volonté individuelle, hasard, malchance, fatalité, divinité... , en fonction de nos croyances, orienteront notre quotidien et dessineront les contours de notre vie. Bien souvent, la constatation est négative et nous nous disons que cela n'a pas fonctionné comme nous aurions voulu, que, pour parler avec Aragon « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse ni son cœur ». A l'heure du bilan, il nous appartiendra, et à nous seul, d'apprécier notre parcours et nous pourrons toujours nous dire que les événements n'ont pas été à la hauteur de nos ambitions, que nous n'avons pas été là au bon moment, que nos choix, pourtant faits de bonne foi, se sont révélés contraires...C'est finalement l'image de l'absurde de la vie et de la guerre, de la vanité de l'existence, des espérances et des entreprises humaines qui est ici illustrée.
Au terme de ce passionnant roman Drogo sourit, ce qui est pour le moins énigmatique. Après avoir pris conscience que son parcours sur terre était un fiasco, qu'il l'avait mené en attendant un événement qui n'était pas arrivé, peut-être a-t-il conclu qu'il valait mieux traiter par le mépris cette comédie qu'est la vie. A-t-il regardé cette mort qu'en militaire il voulait héroïque et qui ne l'a pas été, comme une délivrance ? A-t-il choisi, avant de basculer dans le néant, de saluer ainsi ce qui n'est pas autre chose qu'une libération ? J'avoue que j'inclinerais plutôt pour cette dernière solution.
Hervé GAUTIER – Juillet 2021
Le banquet annuel de la confrerie des fossoyeurs Mathias En
Pour rédiger sa thèse d’ethnologie sur la ruralité, David Mazon, étudiant quelque peu désargenté, quitte Paris et sa petite amie pour un village des Deux-Sèvres rebaptisé plaisamment « La pierre St Christophe », à quelque distance du Marais, autant dire au milieu de nulle part, qui plus est en plein hiver(il donne d’ailleurs une carte et les coordonnées GPS pour insister sur ce lieu inconnu, un peu comme le département sur le cadastre national!). Il part donc à la rencontre des habitants pour les questionner en vue de son travail universitaire et son premier contact se passe au café du village où il croise Martial, le maire, qui est aussi le fossoyeur du cimetière, entendez par là entrepreneur de pompes funèbres, quand même !L’édile, ravi que ses administrés soient ainsi l’objet d’un tel intérêt, va surtout lui raconter la chronique locale, les inévitables secrets de famille pourtant connus de tous, les ragots qui vont avec et qui n’ont pas grand chose à voir avec son travail de thésard, lui faire rencontrer des personnages truculents, Max un artiste aux aspirations bizarres, Arnaud, l’idiot à la mémoire désordonnée mais encyclopédique... Pour cela il faut remonter dans le temps et Martial ne s’en prive pas mais David ne se doute pas à quel point cette immersion va bouleverser sa vie. Ainsi va-t-il apprendre la triste histoire de la parentèle de Lucie émaillée de pendaison, d’adultère, de révélation de filiation pas vraiment légitime, de naissance avortée et de la honte qui va avec et surtout la mésaventure de l’instituteur-poète du village, Marcel Gendreau, qui, à l’instar d’un de ses collègues devenu célèbre, voulut se lancer en littérature avec un roman qui s’en inspira mais dont la notoriété locale fut due davantage au scandale qui suivit sa publication qu’au talent de son auteur. Je souhaite au roman de Mathias Enard qui lui rend en quelque sorte hommage, plus de succès que cette éphémère mais pourtant fort bien écrite tentative littéraire de cet enseignant et qui fut également un intéressant document ethnographique rural sur les années 1950.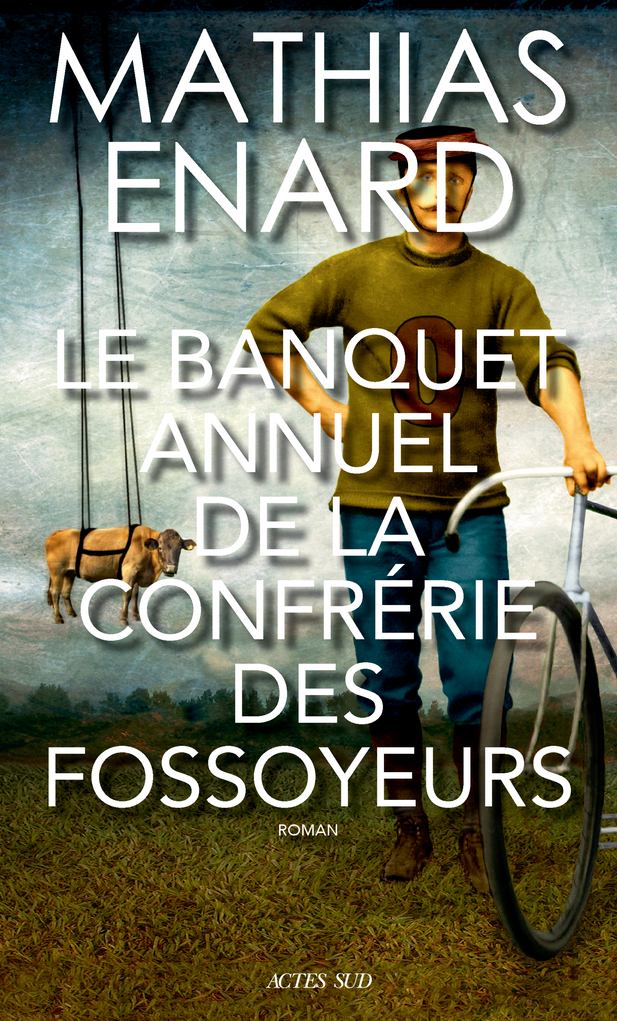
Une thèse c’est du sérieux et pour la mener à bien il faut savoir payer de sa personne ainsi, puisqu’il a commencé par le bistrot, passe-t-il de l’orangina au kir puis à la pratique régulière de l’apéro. Mais cette fréquentation de l’estaminet va aussi nourrir sa réflexion sur la vie du bourg, de ses habitants, ses us et coutumes bienveillants et ce n’est pas le seule transformation que cette immersion dans la France profonde va lui réserver. Ainsi prendra-t-il rapidement conscience de la qualité de vie à la campagne, de l’importance de l’écologie, du chant des oiseaux, de l’animation du marché de ce village qui perd peu à peu perd son âme, ses commerces et ses services publics, s’anglicise, connaît des problèmes liés à la survie des petits agriculteurs, à l’incohérence des décisions politiques … Tout cela n’empêche pas la terre de tourner, les verres de se vider autour d’une belote au café et les pêcheurs de pratiquer leur art parce que le temps continue de s’écouler avec la mort qui rôde et frappe les pauvres humains qui ne sont, là comme ailleurs, que les usufruitiers d’une vie qui peut leur être enlevée à tout moment. Pourtant ici, et c’est là que ça devient intéressant, « la Roue du temps » s’empare des âmes au moment fatal pour les insuffler dans d’autres corps, humains ou animaux, dans le passé ou dans l’avenir et leur prêter un destin original et différent du précédent, un véritable défi au temps, à nos croyances religieuses occidentales et à la logique des choses, parce que ce pays est magique, exceptionnel de part sa géographie au sein du Seuil du Poitou, une zone de passage où s’accroche l’histoire mais aussi s’enracinent les légendes qui ont toujours un fond de vérité. Ici, c’est le domaine de la Fée Mélusine, de Gargantua, de François Villon qui termina ses jours à Saint-Maixent, du Marais tout proche, à la fois apaisant et inquiétant, entre la terre et l’eau, Niort, la ville des dragons, celle des chats aussi, animaux énigmatique qui pour nous sont « de compagnie »mais que les Égyptiens honoraient comme des dieux, qui vivent surtout la nuit quand les hommes dorment, c’est à dire prennent un acompte sur leur dernier sommeil, celui aussi de ces bizarres réincarnations et ces incursions des âmes dans des vies hétéroclites, histoire peut-être de nourrir le concept d’éternité. Mais voilà, l’extraordinaire ne s’arrête pas là, la mort, certes, fait vivre les fossoyeurs qui tiennent cette année-là leur congrès national annuel en l’abbaye de Maillezais sous la responsabilité de Martial. Cela dure deux jours pendant lesquels, au terme d’un accord tacite et irrévocable, la Camarde accepte de ne pas prélever son tribut sur les vivants et, puisque, plus que les autres, cette corporation sait que la mort est la fin de la vie, elle a, depuis longtemps, résolu d’en célébrer les plaisirs avec ripailles et libations que François Rabelais, qui fut aussi prieur de ce saint lieu, n’eût pas reniées.
Ce n’est pas vraiment un récit romanesque traditionnel, c’est, au début, un journal qui relate son arrivée, se poursuit par l’évocation des habitants de ce village et une une escapade dans le département voisin, et, à la fin, reprend sa forme initiale avec des variations entre la première et la troisième personne, comme une sorte d’effet miroir. Le banquet proprement dit s’intègre à ce « plan » et c’est pour lui l’occasion d’évoquer un festin culinaire et un délire verbal qui fleure parfois le corps de garde, qu’il prête à ces quatre-vingt-dix-neuf fossoyeurs aux noms fleuris. Cela donne un roman où se mêle l’actualité au merveilleux le plus improbable. C’est aussi un ouvrage engagé, militant même, servi par une fort belle écriture, à la fois érudite, riche et enjouée, humoristique (j’ai même ri à certains passages), un peu nostalgique, historique aussi, avec même des évocations gentiment érotiques mais aussi un savant travail sur une région que l’auteur connaît bien et qu’il apprécie.
Je suis entré de plain-pied dans ce roman et ça a été un plaisir de le lire, non pas tant parce que, originaire de Niort, il a célébré cette région et cette ville tant décriée par Houllebecq qui n’y a sans doute jamais mis les pieds pour proférer un pareil non-sens mais lui a fait, sans le vouloir, une extraordinaire publicité(il suffit pour cela de gommer un peu le temps et de suivre la délicieuse Rachel dans les rues de cette cité), mais notamment aussi parce que les phrases y sont plus courtes. Dans cette chronique j’ai naguère regretté l’absence, pour certains romans, de ponctuation et des phrases démesurées, ce qui ne facilite pas la lecture. Ici, en contradiction avec ses ouvrages précédents, on sent qu’il se lâche, laisse libre court à son imagination débordante et à sa verve, sans qu’on sache très bien où s’arrête la réalité et où commence la fiction, et c’est plutôt bien ainsi.
Tout cela est bel et bon, mais la thèse de doctorat de David dans tout ça ? L’épilogue est plus classique que ce qu’on vient de lire et ressemble davantage à un « happy end » . A titre personnel, et je suis sans doute de parti-pris, mais j’ai toujours pensé que, loin du concept de réussite et de notoriété, cette région exerce, par la force de son tropisme, une attirance particulière sur les vivants qui un jour, par hasard, y sont passés.
La ville de Niort a donné, entre autre, asile à deux prix Goncourt, Ernest Perrochon en 1920 et Mathias Enard en 2015. De nombreux autres auteurs ont honoré au cours du temps, les Lettres françaises ce qui fait des Deux-Sèvres une terre de culture, d’écrivains, de poètes, mais aussi de peintres, de bâtisseurs, de musiciens, de cinéastes...
"Hervé Gautier - avril 2021"
L'Anomalie Herve Le Tellier Gallimard (Prix Goncourt 2020)
Franchement je ne m’attendais pas à cela quand j’ai ouvert ce roman dont on peut ainsi résumer l’intrigue : Un avion d’Air France assurant la liaison Paris-New York se pose en juin 2021 sur le territoire américain avec ses 200 passagers. L’ennui, c’est que ce même avion, avec ses mêmes passagers s’est déjà posé en mars de la même année, soit une centaine de jours avant à New York. Devant ce mystère, les États-Unis ont pris la décision de retenir l’appareil sur une base militaire en attendant une explication de ce phénomène. C’est déjà assez étrange mais ce n’est que le début. Entre un voyage dans l’espace-temps, un film d’anticipation si on veut le voir ainsi et « une rencontre du troisième type » le lecteur se voit imposer des explications scientifiques incompréhensibles et c’est tout à la foisun roman psychologique aux multiples et étranges personnages face à eux-mêmes, qui sont « dupliqués » et qui se demandent s’ils sont le double ou l’original d’eux-mêmes, une œuvre de science-fiction ou un thriller. En fait c’est une sorte de mosaïque de genres avec tout ce que cela pose comme problèmes religieux, politiques sociologiques, humains...Et pour compliquer encore davantage les choses, ce roman s’inscrit dans un contexte bien actuel avec des noms et « toute ressemblance avec des personnes… » ne ne saurait être une coïncidence. Entre ces personnages, leur « double », leurs préoccupations, leurs amours, leurs espoirs, c’est un jeu de miroirs, un concept de gémellité où ils se retrouvent brusquement avec un frère ou une sœur qu’ils ne connaissaient pas mais qui leur ressemblent tellement qu’ils sont eux-mêmes, des enfants qui se retrouvent avec deux mères ou deux pères, des maris avec deux épouses, des situations entre extraordinaire et invraisemblable où l’ordre des choses est bousculé, sous le regard et le contrôle des psy et des policiers. Le passé ressurgit, où le mensonge qui est le propre de l’espèce humaine n’a plus cours, des vies multipliées, partagées et aussi un peu volées. Avec le décalage dans le temps, lescirconstancesont courtelinesques mais aussi parfois paradoxales et dramatiques. Les gens voient leur double dans le passé, connaissent leur avenir immédiat mais ne peuvent peser sur le cours des choses, des secrets se dévoilent, des certitudes tombent, la mort marque une pause ou un répit, mais pas la souffrance qui avec son cortège de rage, d’horreur et d’impuissance prend ses marques et ouvre le chemin à la Camarde qui dès lors prélèvera un double tribu sur la vie…Une manière sans doute de nous rappeler que nous avons une face cachée, une vie secrète, des espoirs impossibles, un misérable petit tas de secrets comme le disait Malraux...
Au fur et à mesure de cette histoire extraordinaire, les personnages qui nous ont été présentés au début sous forme d’une énumération à la Prévert, sans qu’on sache très bien ce qui allait leur arriver et surtout pourquoi certains avaient soudain affaire à la police, jouent leur rôle ou plus exactement voient leur vie bouleversée sans qu’ils y puissent rien. Ils sont comme des marionnettes dans ce grand théâtre d’ombres qu’est la vie, mais ne le sommes-nous pas tous nous-mêmes au fil de notre quotidien? Grace aux réseaux sociaux la chose prend soudain une ampleur mondiale, les fanatiques religieux se mettent de la partie avec l’incontournable châtiment divin, les philosophes en rajoutent sur le thème de l’existence, du virtuel, de la simulation, de la duplication, on reparle du réchauffement de la planète et de la liberté de pensée, d’informer dans un monde devenu fou où l’instinct grégaire anesthésiant est dominantet où les humoristes tentent de calmer le jeu parce qu’il faut rire de tout et que c’est notre seul arme. Cela amène l’auteur à se poser une question fondamentale sur nous-mêmes, sur notre existence au sens philosophique du terme, le monde qui nous entoure est-il réel et nous-mêmes ne sommes nous pas autre chose qu’une simulation, qu’un banal programme informatique, un peu comme s’il n’y avait pas que les personnages de romans qui sont virtuels.
la Prévert, sans qu’on sache très bien ce qui allait leur arriver et surtout pourquoi certains avaient soudain affaire à la police, jouent leur rôle ou plus exactement voient leur vie bouleversée sans qu’ils y puissent rien. Ils sont comme des marionnettes dans ce grand théâtre d’ombres qu’est la vie, mais ne le sommes-nous pas tous nous-mêmes au fil de notre quotidien? Grace aux réseaux sociaux la chose prend soudain une ampleur mondiale, les fanatiques religieux se mettent de la partie avec l’incontournable châtiment divin, les philosophes en rajoutent sur le thème de l’existence, du virtuel, de la simulation, de la duplication, on reparle du réchauffement de la planète et de la liberté de pensée, d’informer dans un monde devenu fou où l’instinct grégaire anesthésiant est dominantet où les humoristes tentent de calmer le jeu parce qu’il faut rire de tout et que c’est notre seul arme. Cela amène l’auteur à se poser une question fondamentale sur nous-mêmes, sur notre existence au sens philosophique du terme, le monde qui nous entoure est-il réel et nous-mêmes ne sommes nous pas autre chose qu’une simulation, qu’un banal programme informatique, un peu comme s’il n’y avait pas que les personnages de romans qui sont virtuels.
Il y a quand même un cas original dans cette somme d’originalités, celui de Victor Miesel, écrivain ayant écrit un roman intitulé « l’anomalie ». Je me suis dit que ça me rappelait quelque chose et au début j’ai hésité entre un clin d’oeil, une somme de remarques sur la notoriété qui tarde à venir et une mise en abyme. Le premier Victor a pris l’avion de mars puis s’est donné la mort ensuite, ce qui permet selon le processus la duplication à un second Victor mais qui maintenant est seul, de recueillir la notoriété grâce à son livre.
J’ai lu avidement cette histoire bien écrite, érudite et passionnante malgré son côté échevelé mais qui, par bien des côtés m’a rappelé le monde dans lequel nous vivons actuellement. J’ai tenté de ne pas perdre de vue que nous sommes nous-mêmesà la fois dans l’irrationnel, l’anxiété, l’absence de boussole et d’espérance, que nous sommes des êtres souffrants et surtout mortels dans un monde où on marche sur la tête en permanence, mais en me répétant que nous avons tous, dit-on, notre sosie et que nous serions peut-être bien surpris d’en faire la connaissance si d’aventure nous le croisions.
Je ne suis pas spécialiste de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) auquel notre auteur est un adhérent passionné, mais ce roman me paraît s’inscrire dans une tentative de littérature inventive. Que la vie reprenne son cours normal à la fin comme une parenthèse qui se referme, comme si rien ne s’était passé, que les mots eux-mêmes s’évanouissent dans une sorte de calligramme ou dans un tourbillon qui les avale comme un rêve qui se dissipe au matin, me paraît conclure cette histoire un peu folle mais qui nous interroge. Puis j’ai refermé le livre qui restera sans doute dans ma mémoire grâce à sasingularité. Diaghilev disait à Jean Cocteau « Etonne-moi, Jean ». Je ne suis qu’un simple lecteur, habitué aux romans traditionnels, mais devant cette expérience originale en matière d’écriture, j’ai vraiment été étonné.
Hervé GAUTIER - Mars 2021
Glace - Bernard Minier - Pocket
Dans les Pyrénées, en plein hiver, en haut d’une remontée mécanique, on a retrouvé un corps. C’est déjà étonnant, mais le plus étrange c’est que ce cadavre est celui... d’un cheval décapité, dans une mise en scène macabre, détail suffisant pour que le commandant Servaz, par ailleurs en charge d’un autre affaire de meurtre sur la personne d’un SDF, soit désigné pour cette enquête, de concert avec la capitaine de gendarmerie Irène Ziegler. Le cheval, un pur sang, appartient à Eric Lombard, notable voisin et capitaine d’industrie et il ne fait pas de doute que ce fait est lié à cette personne. Il ne fait pas de doute non plus que cet homme, de part sa fortune et sa position, a des appuis en haut lieu ce qui compliquera les choses pour les enquêteurs. Il y a un centre pénitentiaire psychiatrique, l’institut Warnier, à proximité de la scène « de crime » où vient d’arriver Diane Berg, une jeune psychologue suisse. Les investigations révèlent la présence in situ de Julian Hirtman, ex-procureur et tueur redoutable, pensionnaire de l’institut, mais cette information pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses aux enquêteurs et ce d’autant que d’autres meurtres tout aussi mystérieux ont lieu dans la région avec toujours ses traces ADN. Cette suspicion remettrait en cause l’existence même de cet institut unique en son genre et craint par les habitants de cette vallée parce qu’elle réveille une histoire macabre vieille de quinze ans. Il y a des cadavres dans les placards, des archives patiemment constituées et ressuscitées par un juge à la retraite, de vieille histoires qui mettent en lumière toute la turpitude dont est capable l’espèce humaine, un parfum nauséabond de règlement de comptes anciens, les apparences qui sont parfois trompeuses et qui polluent le jugement le plus sensé, des fausses pistes et des vrais indices, une dimension rituelle dans les modus operandi, un rappel de l’adage que la vengeance est un plat qui se mange froid, et au cas particulier plutôt faisandé, qu’il ne faut faire confiance à personne, que l’hypocrisie fait toujours partie du quotidien…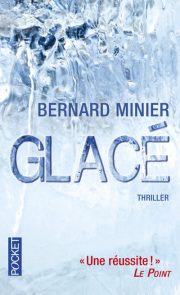
L’institut Warnier où travaille Diane Berg, la nouvelle psychologue, est suffisamment mystérieux pour que cette dernière s’intéresse à ce qui s’y passe, notamment en matière de traitements médicamenteux. Elle mène son enquête personnelle qui, sans qu’elle s’en doute, rejoindra les investigations policières et les éclaireront.
J’ai aimé la personnalité et les remarques teintées d’humour de Servaz, policier de terrain et consciencieux, notamment à propos de la hiérarchie policière calfeutrée dans les bureaux, bien plus occupée par son avancement et par l’entretien de son incompétence que par sa mission de service public. Ces commentaires pertinents sont de portée générale! C’est un flic solitaire, cultivé, sensible à la beauté des femmes, bien loin de cette catégorie de fonctionnaires flagorneurs et arrivistes.
J’ai apprécié que ce texte bien écrit, émaillé de belles descriptions de cet écrin de montagnes en hiver, bien construit, érudit, bien documenté et lu avec gourmandise, soit associé à la musique de Gustav Malher . L’auteur y règle quelques comptes notamment au sujet de la psychiatrie et tient en haleine son lecteur jusqu’à la fin avec force rebondissements où les différents personnages à la personnalité parfois compliquée sont entraînés dans une sorte de maelstrom meurtrier. La littérature policière est un terrain propice à l’exploration des méandres délétères de l’âme humaine et ce roman les analyse avec pertinence et talent.
Publié en 2011 ce roman passionnant est le premier d’une série écrite par Bernard Minier. Il a fait l’objet d’une adaptation télévisée et a été couronné par de nombreux prix. Moi, simple lecteur, je n’ai aucun mérite à me joindre à la cohorte de louanges qui a accompagné la publication de ce thriller et je pense que je vais m’intéresser à l’ œuvre de cet auteur.
Hervé GAUTIER - Février 2021
L'enfer du commissaire Ricciardi - Maurizio de Giovanni
Maurizio de Giovanni - Rivages /noir.
Traduit de l’italien par Odile Rousseau.
Au cours de l’étouffant été napolitain, un célèbre chirurgien, le professeur Tullio Iovine del Castello, est retrouvé écrasé au sol, défenestré depuis le quatrième étage de sa clinique mais il apparaît très vite que, même si cette chaleur rend fou, cette chute n’est ni accidentelle ni un suicide. Le commissaire Luigi Ricciardi est chargé de l’enquête avec son fidèle adjoint le brigadier Maione. Leurs investigations ne tardent pas à révéler des zones d’ombre dans la vie du praticien, de vieilles histoires qui remontent à la surface, des règlements de compte, des menaces proférées, des vengeances non assouvies, une histoire de bijoux bien obscure...
Le commissaire a ce don étrange d’entendre et de voir les derniers moments d’un être qui va mourir. Ces visions sont en réalité un terrible inconvénient qui l’obsède tout au long de ses enquêtes, lui complique les choses au lieu de les lui faciliter et cette affaire ne fait pas exception. Il doit aussi faire avec une hiérarchie aussi tatillonne qu’arriviste surtout dans un contexte politique difficile de la montée du fascisme. Cette situation ne contribue pas à lui faciliter la vie et il faut y ajouter les fantômes avec lesquels il doit vivre, la mort annoncée de Rosa, sa tante, sa presque mère, la fuite inexpliquée d’Enrica, sa jolie voisine dont il est secrètement amoureux. Il ne le sait pas mais la vie pour elle, malgré la beauté du bord de mer où elle habite temporairement, est aussi devenue, malgré les apparences, pleine de questions qui l’obsèdent. Ricciardi est un célibataire solitaire, un scrupuleux policier avant tout, et son environnement féminin que complète Nelide, une solide jeune fille de la campagne, parente de Rosa et qui s’occupe de son intendance, vient de s’enrichir de la présence de Livia, la jeune et flamboyante cantatrice, amie du Duce, veuve d’un ténor mort dans des circonstances que notre commissaire à dû démêler. Elle s’est entichée de lui et de ses étranges yeux verts m ais ce n’est pas d’elle dont il rêve.
Bizarrement au cours de cette enquête, c’est plutôt le brigadier que le commissaire qui mène les investigations. Il le fait d’une manière agressive, en paroles comme en actes, à l’endroit de ceux qu’il soupçonne. Cette attitude est sans doute due à son pessimisme, à son mal-être passager fait de suspicions plus ou moins fondées sur son entourage et d’interrogations sur lui-même et ainsi, pour tenter de calmer la tempête qui gronde sous son crâne et ses états d’âme délétères, il choisit de les exorciser par le travail.
Ainsi la touffeur estivale s’apparente à l’enfer, à moins que ce ne soit l’ambiance du fascisme qui sévit en Italie au cours de ces années mais aussi la mort qui rode, souvent énigmatique, l’enchaînement d’événements mystérieux, les obsessions et les passions qui d’ordinaire entravent la vie de Ricciardi et de ses proches pour qui la vie est aussi une forme de torture, une entrave au bonheur. C’est également un roman sur la condition humaine, ses craintes, ses espoirs, ses fantasmes, ses obsessions, ses occasions manquées... Aux yeux de l’auteur la faim et l’amour sont les deux raisons d’être et de vivre des hommes et les relations humaines sont aussi faites de manipulations, de destructions, d’espoirs déçus, de renoncements, d’hypocrisie et de mort.
Il n’est rien de tel qu’un authentique napolitain comme l’auteur pour évoquer l’âme des habitants de cette ville exubérante, leur cuisine chaleureuse, l’ambiance où, plus qu’ailleurs, le religieux se mêle au profane, où la vie côtoie la mort,les codes et ledécor de cette citéoù tout se sait grâce à un miracle permanent, où le vrai pouvoir, celui du peuple, est maffieux, avec violences et zones de non-droit. C’est un réel dépaysement pour le lecteur et de Giovanni distille le suspense jusqu’à la fin. Son style est fluide, agréable à lire, plein de sensibilité et d’humanité.
Tous les hommes n' habitent pas le monde de la meme facon
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon– Jean-Paul Dubois (Prix Goncourt 2019) – Éditions de l’Olivier.
Une église ensablée au nord du Danemark, un père, pasteur protestant qui vient s’établir par amour dans le sud de la France, perd la foi, et qui, après son divorce, part exercer son désormais hypocrite mais talentueux ministère à l’autre bout du monde où il perdra son âme, une mère qui hérite d’une salle "d' art et d’essai » qu’elle transforme par opportunisme commercial en temple du cinéma porno, refait sa vie et choisit sa mort, le bouleversement sociale et culturel de 1968 et, au milieu de tout cela, Paul Hansen, fils unique de ce couple éclaté qui tente d’exister comme un homme qui se noie.
Comme souvent, ceux qui, comme lui, sont nés sous une mauvaise étoile, sont les oubliés de l’amour, les habitués de la solitude, pensent  trouver la solution dans un métier de hasard ou le mariage, comme on joue au poker, en se disant qu’on a aussi droit au bonheur, que c’est toujours les mêmes qui s’en sortent, mais un tel destin pourri vous lâche rarement en cours de route et le sien, malgré toute sa bonne volonté, s’acharne sur lui.
trouver la solution dans un métier de hasard ou le mariage, comme on joue au poker, en se disant qu’on a aussi droit au bonheur, que c’est toujours les mêmes qui s’en sortent, mais un tel destin pourri vous lâche rarement en cours de route et le sien, malgré toute sa bonne volonté, s’acharne sur lui.
Même sa femme, mi-algonquine mi-irlandaise ne peut inverser pour lui le cours funeste des choses et quand on est comme Paul on attire la malveillance des autres qui justifient ainsi leurs actes malsains dans l’illusion qu’ils ont d’une importance artificielle et se croient autorisés à la faire prévaloir. On suscite ainsi toute la colère du monde, on fait office malgré soi de bouc émissaire et comme si cela ne suffisait pas c’est la mort qui en rajoute une couche en se chargeant de faire le vide autour de lui.
Las, il se retrouve dans une prison québécoise pour une agression vengeresse provoquée par des années de frustrations recuites et d’abnégation silencieuse, une façon de réagir violemment contre l’adversité et ceux qui en sont les complices.
En compagnie de son codétenu, un « Hell Angels »amoureux des motos, attachant, fragile et même protecteur, il évoque comme une sorte d’évasion cathartique son parcours cahoteux, celui de sa famille qui ne l’est pas moins, comme un long chemin de croix.
Le titre ressemble à un truisme mais c’est un roman passionnant et émouvant, bien documenté sur le Québec (et pas seulement), son histoire tourmentée, sa géographie, ses habitants qui sont nos cousins longtemps oubliés.
J’ai goûté avec plaisir ce style qui sert si bien notre belle langue française, j’ai apprécié cet humour subtil parce qu’il faut bien rire de tout et que c’est souvent la seule façon qu’on a d’accepter la fatalité. J’ai aimé les descriptions poétiques, les remarques pertinentes sur l’espèce humaine, son incompréhensible habitude, pour supporter son parcours dans ce monde, de s’en remettre à un dieu pourtant bien absent, son inexplicable foi dans l’avenir surtout quand tout se dérobe, les remarques sur les sociétés reconnues pour leur attractivité, sur les a priori qu’on tisse et qu’on entretient sur ses semblables.
J’y ai aussi lu une sorte de désespérance sournoise mais qui, paradoxalement, vous pousse à vous maintenir quand même en vie, une impossibilité définitive de réaliser ses rêves, le poids du destin qui vous étouffe et vous détruit, quoique vous fassiez, bref une réflexion sur cette condition d’homme quasi ordinaire, mais aussi sur cette nature humaine, capable du pire comme du meilleur mais bien souvent du pire, un exemple à cent lieues de cette réussite obligatoire dans cette société policée dont on ne rebat un peu trop les oreilles.
Le livre refermé on ne peut qu’avoir de l’empathie pour cet homme que le destin et la mesquinerie des hommes accablent. C’est l’image même de notre société.
Hervé Gautier - novembre 2020
Un bel morir - Alvaro Mutis - Grasset.
Traduit de l'espagnol par Eric Beaumartin.
Cette fois Maqroll a décidé de se domicilier temporaire dans l'improbable port de La Plata avec la projet de remonter le fleuve à la rencontre de ceux qui auparavant avaient partagé avec lui quelques entreprises mirifiques. Pour cela il choisit une chambre bizarrement située en surplomb des eaux boueuses assez loin de l'estuaire (c'est un peu l'image de sa propre vie), dans une auberge tenue par une femme aveugle.
Il rencontre un ingénieur belge qui doit réaliser un tronçon ferroviaire au sommet de la cordelière et l'engage pour convoyer du matériel. Il ne tarde cependant pas à s'apercevoir que cette histoire de ligne de chemin de fer devait bien cacher quelque chose d'illégal dans un endroit où les autorités avaient depuis longtemps cesser d'être présentes. Cela paraît bizarre pour cet homme qui est avant tout un marin qui a bourlingué sur toutes les mers du globe mais c'est comme cela et de cette aventure improbable il ne sortira pas indemne. 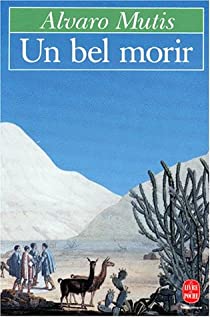
Elle met encore une fois en évidence sa naïveté ordinaire qui le pousse dans des aventures incroyables face à la cupidité d'autrui mais qui nourrit largement son expérience en matière de connaissance des bassesses dont l'espèce humaine est coutumière.
Maqroll El Gaviero (le gabier), est un personnage de fiction dont Mutis (1923-2013), à partir de 1985, a décliné la vie à travers sept romans au point qu'on peut dire qu'il est l'alter ego de l'auteur. Mais l'est-il en réalité ?
Il y a quelques années, je me suis demandé en quoi Mutis et Maqroll pouvaient être considérés comme des personnages hétéronymes comme ont pu l'être Pessoa et Alvaro de Campos ou Ricardo Reis. C'est toujours un sujet délicat qui amène à réfléchir sur le rôle de l'écriture pour l'auteur lui-même, une manière de rendre compte d'une certaine réalité ou l'occasion de se créer, à travers l'imaginaire, un univers idéal qui compense fictivement un quotidien plus morne.
Maqroll est un marin en perpétuelle errance, un homme au passeport constellé de visas périmés, un solitaire, plus que marginal au regard de la loi, mais un être cultivé, érudit, épicurien, polyglotte, fidèle en amitié cependant, n'hésitant pas à traverser les océans pour répondre à la sollicitation d'un ami (« Le rendez-vous de Bergen ») sans qu'on sache très bien comment la lettre a pu lui parvenir.
Il pratique avec modération la fréquentation des tavernes et les passades amoureuses mais que quelques femmes ne parviennent pas à oublier, lui non plus d'ailleurs. Elles ont nom Antonea, Flor Estévez ou Iliona... Le Gabier semble exercer sur les femmes en général une séduction naturelle et l'oubli, cette faculté étonnement humaine, ne parvient pas à entamer la trace qu'il laisse dans la mémoire des gens qu'il croise. Ici c'est Amparo Maria qui succombe à son charme et qui rejoint ainsi ses femmes mythiques.
Il n'a pas de véritable projet d'avenir mais, sans qu'il y puisse rien, il a l'art de se mettre, sur terre comme sur mer, dans des situations inextricables, à participer à des affaires douteuses dont il se sort au dernier moment mais où il laisse toujours le peu d'argent qui lui reste. Le temps a fait sur lui et sur ses facultés des ravages ordinaires et il se sent vieux mais se rappelle opportunément ce que furent ses bonnes années, tumultueuses et amoureuses et cela sans doute le maintient en vie, même si les regrets l'accompagnent. Ce n'est d’ailleurs pas la première fois que l'auteur aborde ce thème à travers son héros.
Ce n'est pas première fois non plus que Maqroll côtoie la mort. Dans un précédent roman il l'avait déjà approchée dans les miasmes d'un marigot mais s'en était tiré in extremis. Ici, elle s'invite à nouveau en frappant autour de lui à occasion de cette indéfectible habitude qu'ont les hommes, depuis la nuit des temps, de se battre et de s’entre-tuer.
Dans ce roman tout l'art de l'auteur est d'entretenir chez son lecteur un suspens qui pourrait bien se conclure pour Maqroll par un fin tragique. C'est un thème d'autant plus prégnant dans l’œuvre de Mutis que Maqroll n'a jamais eu d'enfant (du moins à sa connaissance) et donc n'a pas assuré sa descendance, mais cela a-t-il de l'importance ?
Ce roman a été publié en 1989 dans son édition originale, soit bien avant le décès de Mutis. De plus ce n'est pas son dernier roman où apparaît Maqroll. Dans un appendice à ce récit, Mutis ne laisse pourtant aucun doute sur la disparition de Maqroll et la citation de Pétraque, « Un bel morir tutta la vita onora », qui sert d'exergue à ce roman, vient conclure cette vie aventureuse et tourmentée. C'est en effet une prérogative d'auteur de disposer purement et simplement de l'existence, même fictive, de son personnage.
Comme toujours dans les romans de Mutis, j'ai retrouvé ces descriptions poétiques, ce qui nous rappelle qu'il était avant tout un poète, et ici le lecteur circule avec Maqroll dans la douce fragrance des caféiers autant que dans le danger des sentiers de montagne pleins de brouillard glacé, près des précipices et des torrents… Comme l'a dit fort justement Bernard Clavel « Mutis est un enchanteur ».
J'ai apprécié aussi ces évocations subtilement humoristiques, le phrasé délicat, cette délicieuse façon d'exprimer les états d'âme du Gabier et cette nostalgie qui lui colle à la peau comme son ombre. Ma lecture a été passionnée et Mutis a ce talent de transformer une histoire qui aurait pu être une banale aventure en un récit passionnant. Il reste pour moi un génial conteur qui entraîne son lecteur de la première à la dernière page sans que l'ennui ne s'insinue dans sa lecture.
Depuis de nombreuses années cette chronique s'est fait l'écho de l’œuvre de Mutis à travers les tribulations de Maqroll mais cette modeste évocation n'a pas vocation à tout résumer. Alvaro Mutis reste cependant pour moi un auteur majeur dont Octavio Paz a pu dire « (qu'il est) un poète dont la mission consiste à convoquer les vieux pouvoirs et faire revivre la liturgie verbale, dire la parole de vie » Maqroll, loin d'être une sorte de mythe, reste malgré tout un personnage assurément humain et attachant.
© Hervé GAUTIER – Juin 2020.
L arrache-coeur - Boris Vian - Editions Jacques Pauvert.
C’est le dernier roman de Boris Vian (1920-1959) publié en 1953. On ne devient pas écrivain par hasard et sa propre biographie, ses obsessions, ses remords, ses fantasmes, nourrissent l’œuvre de celui qui tient la plume, même s’il cache tout cela sous une fiction rocambolesque et poétique et s’il compte sur l’effet cathartique de l’écriture pour s’en libérer.
C’est vrai que cette histoire a quelque chose d’inattendu, avec sa « foire aux vieux » où les anciens sont vendus à l’encan, ce Jacquemort au nom peu engageant, sorti on ne sait d’où et qui veut « psychiatrer » tout le monde et spécialement les bonnes, mais à sa manière seulement, ce vieil homme, 
La Gloïre dont la tâche essentielle est de repêcher avec les dents dans la rivière rouge tout ce qui y surnage, ou, pour dire autrement, se charger de la honte du village, et à sa mort, ce sera le psychiatre qui prendra sa place, ces triplés, les « trumeaux" au nom bizarre, pas vraiment frères puisque l’un deux, « Citroën », est différent, isolé par rapport aux jumeaux,
Noël et Joël, ces relations conjugales surprenantes entre les parents Angèle et Clémentine, ces animaux qui parlent comme dans une fable, ce mélange volontaire entre sexualité et amour, la honte, la lâcheté que chacun porte avec soi et dont on prend conscience…
A cette époque Boris est fatigué, malade, désabusé. Il a déjà dit, dans une sorte de prémonition, qu’il n’atteindrait pas quarante ans et sent l’échéance se rapprocher. J’ai toujours été fasciné par ceux qui ont dit connaître avec précision la date de leur mort, quand la plupart d’entre nous vivons comme si cette échéance n’existait pas. Il a donc logiquement vécu intensément une vie parisienne nocturne, grillant la chandelle par les deux bouts, gaspillant dans sa trompette un souffle qui de plus en plus lui manquait.
Victime très jeune d’un rhumatisme articulaire aiguë, il était de santé fragile et c’est une crise cardiaque qui l’emportera. Il entraîne son lecteur dans un univers parallèle où le temps a une autre valeur et les mois des noms inattendus, le régale de jeux de mots, de néologismes aussi délicieux qu’improbables, de noms rares, s’amuse à lui faire perdre ses repères traditionnels et ses références littéraires notamment dans les descriptions insolites et colorées, ou l’entraîne dans des raisonnements ou la logique se fait illogique, comme si tout ce qui fait notre monde ordinaire et quotidien se dérobait.
Dès lors le décor si particulier de Boris se met en place, la fuite du temps vue à travers le personnage du psychiatre, le rôle un peu marginal du curé ce qui indique peut-être une préparation à comparaître devant un éventuel dieu en se conciliant son représentant, la volonté d’Angel de partir dans le bateau(avec des pieds!) qu’il fabrique, la rivière rouge, couleur du sang et symbole de vie, l’arrogance dont fait preuve au fur et à mesure du récit le personnage de Jacquemort qui oscille entre besogner les bonnes et psychanalyser le maximum de gens et qui s’installe et s’incruste, une manière peut-être de dire adieu à cette vie,
Clémentine qui ressemble de plus en plus à un mère hyper-protectrice et abusive qui fait fuir son mari parce qu’il n’aime pas les enfants, son image à lui peut-être ? J’en viens au titre de ce roman.
Avec « L’automne à Pékin » Boris nous a entraînés dans une histoire absurde qui ne se passe ni en automne ni à Pékin. Ici il me semble que ce dernier roman fait référence au cœur qui fut pour lui toujours un problème et qu’on lui arrache, comme on lui arrache la vie !
J’ai retrouvé dans cette relecture toute la poésie et la musique de Boris Vian que j’aime tant, ce dépaysement qu’on ne comprend pas mais qu’on s’approprie très vite parce que, sans doute, il correspond à quelque chose qu’on porte inconsciemment en soi mais qu’on aurait pas su soi-même exprimer.
Vian est un homme de lettres longtemps boudé par les manuels scolaires, dont on ne faisait connaissance qu’au hasard de la rencontre d’un amateur conquis par cet univers si particulier tissé dans ses romans et qui ne laissait personne indifférent. On aimait ou on détestait mais on avait un avis.
Et puis c’est un écrivain qui a longtemps connu le « purgatoire » parce qu’il dérangeait ou qu’on ne le comprenait pas puis, par un miracle inattendu, il revenait sur le devant de la scène, y restait quelque temps puis retombait dans l’oubli pour revenir plus tard, quand on ne l’attendait plus.
Si Verlaine l‘avait connu, il aurait sûrement mis au nombre de ses « poètes maudits »ce « satrape de 2° classe » du collège de pataphysique, cet écrivain génial qui aimait tant bousculer tout sur son passage pour marquer son passage sur terre.
Hervé Gautier - Mai 2020
Les attentifs - Marc Mauguin - Robert Laffont.
C’est sans doute très personnel mais je partage depuis longtemps avec l’auteur l’intuition que les toiles d’Edward Hopper, parce qu’elles suggèrent l’attente, invitent à l’écriture parce qu’elles portent en elles quelque chose d’inexprimé qui vous transporte ailleurs, dans un autre univers et vous incitent à le partager, un peu comme si les formes, les couleurs et les êtres suscitaient le prolongement de l’histoire.
Les personnages de ses tableaux ont dans les yeux quelque chose de mélancolique qui trahit l’état de leur âme et on peut y lire, pour peu qu’on y soit attentif, les aspects délétères de la condition humaine, le désamour, la trahison, l’incompréhension, l’abandon, le désespoir, le vide, le mal de vivre, les fantômes et les remords que chacun d’entre nous porte comme une croix.
Je les sens abandonnés, victimes des autres et spécialement de leurs proches qui les connaissent mieux que personne, savent comment les blesser efficacement et qui ne s’en privent pas. Ils le font par vengeance, par méchanceté, par intérêt, par plaisir ou simplement pour se prouver qu’ils existent.
Ils sont victimes de leur destin et l’acceptent parce qu’ils ne peuvent faire autrement et ce fatalisme engendre la solitude, le désarroi, une sorte de néant qui fait que, comme le dit Pessoa, ils ne sont rien, mais portent en eux « tous les rêves du monde », à jamais trahis et impossibles.
Ils se raccrochent à n’importe quoi mais tout se dérobe devant eux et les mots qu’ils pourraient prononcer ou écrire pour se libérer restent en eux parce qu’ils n’ont pas réussi, malgré leur bonne foi et leur volonté de bien faire, à trouver leur place dans ce monde, et savent pas qu’ils ne la trouveront jamais mais auront à subir au contraire critiques et lazzis.
Cette « saudade », comme disent les Portugais, les rend un peu mythomanes, parfois trop confiants et ils s’imaginent, à titre de compensation pour ce que la vie ne leur donnera jamais, des situations où ils ont le meilleur rôle, se tricotant des fragments d’une vie dont ils ne verront jamais l’ombre d’une réalisation et ils finissent même par y croire malgré les douleurs, les rides ou le fard.
Ils font même semblant d’être heureux dans cette solitude faite de frustrations ou dans une vie de couple qui lentement se désagrège au fil du temps, se transforme en mensonges, en trahisons et en adultères, dans une société au vernis suranné où ils voudraient oublier le quotidien avec ses désillusions, sa recherche du plaisir de l’instant et de l’inconnu, la légèreté de l’être, le temps qui passe et l’écume des jours, mais la routine s’impose à eux avec ses usages, son hypocrisie et c’est le vide qui s’installe et avec lui le souvenir des mauvais moments, les regrets, le silence pesant et désespéré, avant-coureur d’une mort considérée comme la fin d’un parcours ou peut-être désirée comme une délivrance.
Cette condition humaine qui parfois est une comédie se mue petit à petit en drame intime et silencieux.
Nombres de ces nouvelles ont pour cadre le Cap Cod, inséparable de Hopper. J’en imagine les dunes battues par le vent, le bruit du ressac, le cris des mouettes et ce paysage se marie aux personnages de ses peintures, d’autres ont pour cadre New-York, cette ville mythique qui fait aussi partie de l’univers créatif du peintre.
L’écriture de Marc Mauguin épouse parfaitement l’ambiance que Hopper entend instiller sous son pinceau. L’auteur choisit un tableau, se l’approprie en le décrivant ou en l’évoquant et retrace autour des personnages et du décor une autre histoire qui témoigne de la communion qui existe entre eux et de la force créatrice qu’il porte.
Ces êtres fictifs, il les fait même se croiser, se rencontrer, se connaître, s’oublier, fuir vers un autre quotidien pour découvrir du nouveau ou du mystère, se retrouver malgré le temps et la distance, comme cela arrive parfois dans la vraie vie.
La nuit, le jour et toutes les autres nuits - Michel Audiard
Je suis comme la plupart des Français, fan des dialogues de Michel Audiard (1920-1985), de sa verve faubourienne , de ses saillies d'anthologie, des ses aphorismes définitifs que l'on grave dans sa mémoire et qui témoignent de son amour des bonnes choses de la vie et des mots, de son attachement à ses copains, à ses artistes fétiches, de son appétit de l'instant. Il a certes gardé un peu de sa gouaille, on ne reconnaîtrait plus le dialoguiste des "Tontons flingueurs"sans cela et il se laisserait même aller, à l'invite de la musique de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli, à quelque chose qui pourrait bien ressembler à des "Mémoires". 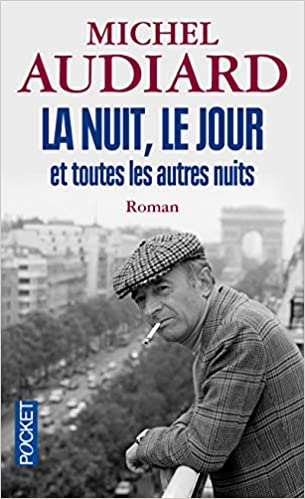
Sous sa plume de noctambule parisien pendant l’Occupation, on croise des figures emblématiques et hautes en couleurs, des demi-mondaines qui ont su se partager entre les occupants et les Alliés, des prostituées mais aussi des pauvres filles pour qui la Libération a été synonyme d'opprobre et sur qui les résistants de la dernière heure et ceux qui ont su tourner leur veste au bon moment se sont acharnés, un beau panel de l'espèce humaine.
Puis il emprunte la douce pente du souvenir, celui de l'enfance de ses espoirs fous en l'avenir et ses égarements, celui du succès du cinéma et de l'écriture, convoque les femmes, leurs mensonges et leur fantasmes, les hommes aussi et leurs envies, leurs traîtrises, leurs compromissions... L'époque troublée de la guerre était favorable à ce genre d'éclosions! Ainsi revisite-t-il, à l'aune de sa souvenance blottie au fond des jours et des nuits, des fantômes qui peuplent encore ses pensées malgré l'effacement du temps. Il conte avec humour ses amours furtifs autant que ses rencontres amicales et durables avec une certaine nostalgie, évoque ceux qui ne sont plus là pour lui donner la réplique.
Qu'on ne s'y trompe pas, derrière le parolier génial et irrévérent, il y a un Audiard inattendu, un écrivain authentique et cultivé chez qui Louis-Ferdinand Céline a laissé son empreinte indélébile. Comme lui, il promène sur le monde un regard désabusé que ces années de vie lui ont inspiré, compte ses morts et exprime sans fioriture et dans son style si particulier, sa déception de l'espèce humaine.
Il a 57 ans quand il écrit ce livre, après une vie qu'on peut assurément supposer bien vécue mais j'y vois aussi une sorte d'indifférence au présent, la fatigue, le désenchantement, même s'il ne réussit pas à ce départir de ce style décidément inimitable. C'est perceptible, à mon avis dans un paragraphe du début de ce livre qui peut passer inaperçu et dont il reprendra plusieurs fois l'idée au détour d'une phrase. Il y évoque, avec une grande économie de mots, la mort de son fils quelques mois auparavant, dans un accident de voiture.
Du coup on oublie le Audiard traditionnel, avec son clope, sa casquette et ses bons mots qui soudain ne pèsent rien face à la mort, au regard de cet instant qui vous oblige, inversant le cours normal des choses, à aller à l'enterrement de votre enfant, à reconsidérer votre approche des choses et des vaines croyances religieuses. Pour autant, dans le contexte très particulier de ce deuil impossible à faire, je m'interroge sur le réel effet cathartique de l'écriture.
Dès lors il m'apparaît que le titre prend tout son sens, la nuit, le jour pour évoquer la vie et le temps qui passent et qui ne laissent sur lui que le frêle sceau de leur ombre, et toutes les autres nuits, dans l'insomnie, la solitude et les cauchemars, pour pleurer ce fils disparu. C'est bien la solitude que je retiens de ce livre improprement appelé “roman”, la nostalgie du passé autant que l'impuissance à retenir le temps, à retricoter les événements à l'envers.
C'est étonnant et assez inattendu de la part d'un homme qu'on imagine volontiers autrement parce qu'on croit le connaître à l'aune de l'image qu'il donne mais, qui porte en lui, comme nous tous, la marque de "l'humaine condition", comme l'a si bien dit Montaigne.
Hervé Gautier- Février 2020
La Mere Lapipe dans son bistrot - Pierrick Bourgault
La Mère Lapipe dans son bistrot - Pierrick Bourgault - Éditeur "Les ateliers Henry Dougier" .
Qu'on se comprenne bien, il n'est pas question ici d'un café à la mode que viennent hanter les intellectuels où l'on consomme des boissons hors de prix, ou d'un établissement que la loi nomme pompeusement "débit de boissons", mais simplement d'un "Café du coin"(avec une majuscule), nom commercial qui n'a rien d'original mais qui a au moins l'avantage de le situer dans la géographie locale, un troquet où des hommes et des femmes (eh oui!) refont le monde sans tabou devant un ballon de rouge au comptoir. On peut même “y apporter son panier” comme on disait dans le temps, les tarifs y sont concurrentiels et les tournées généreuses.
 La patronne, la mère Jeannine, la mémoire du quartier, surnommée amicalement "la mère Lapipe, (mais ne nous égarons pas), à cause de son addiction à la bouffarde dont le tabac lui éraille la voix, préside au cérémonial quotidien de cet estaminet. Son vocabulaire louvoie entre de délicieux néologismes poétiques et la gouaille de forains et n'aurait pas déplu à Michel Audiard. Cette arrière-grand-mère de 77 ans qui certes est officiellement en retraite mais maintient son commerce pour le plaisir, celui de ses clients et, en ce qui la concerne, comme un dérivatif personnel, est un de ces personnages insolites que les touristes de passage au Mans viennent parfois photographier.
La patronne, la mère Jeannine, la mémoire du quartier, surnommée amicalement "la mère Lapipe, (mais ne nous égarons pas), à cause de son addiction à la bouffarde dont le tabac lui éraille la voix, préside au cérémonial quotidien de cet estaminet. Son vocabulaire louvoie entre de délicieux néologismes poétiques et la gouaille de forains et n'aurait pas déplu à Michel Audiard. Cette arrière-grand-mère de 77 ans qui certes est officiellement en retraite mais maintient son commerce pour le plaisir, celui de ses clients et, en ce qui la concerne, comme un dérivatif personnel, est un de ces personnages insolites que les touristes de passage au Mans viennent parfois photographier.
Ici on y va de son commentaire sur la cuisine, sur le temps qu'il fait et le temps qui passe, ce qui donne lieu à des phrases d'anthologie version "brèves de comptoir"où se conjuguent bon sens et mauvaise foi, le tout sous le regard autoritaire de Jeannine qui garde la main sur la clientèle et sur l'autorisation d'entrer... et tant pis pour le chiffre d'affaires! La liberté de parole s'y pratique sans tabou, à condition toutefois de s'y adonner avec humanité et de ne pas fanfaronner sur sa réussite sociale ni sur sa richesse et ça peut même dégénérer en propos graveleux.
Toutes les générations, toutes les couches sociales y sont admises et parfois l'esprit critique est vif à propos des faits de société ou des petits détails de la vie, on y disserte des smartphones comme des “Gilets jaunes”, on y tape le carton ou on y garde les enfants et quand le dernier client a du vague à l'âme, le zinc de ce microcosme se transforme en cabinet de psy parce qu'ici c’est un poste-frontière entre deux mondes et il s'y passe toujours quelque chose, on parle, on se confie, un vrai club privé, ouvert même la nuit et qui ne dit pas son nom, l'exact contraire de notre société qui chaque jour un peu plus se déshumanise car on y boit certes, mais jamais seul!
On n'y applique pas vraiment la législation anti-tabac et le lieu baigne toujours dans dans le nuage bleu de l'herbe à Nicot, mais seulement de cette herbe là! Il y a de la tendresse chez Jeannine autant que du franc-parler et même si les réseaux sociaux sont muets sur son adresse, il est toujours possible de la trouver en demandant. Les écrans de tout poil y sont bannis mais les infos, les ragots aussi, sont fournis par les clients qui sont aussi des amis. Si on respecte les règles non écrites de ce café on y est très vite accepté et reconnu et le lieu conserve comme des reliques les photos de clients vivants ou morts et les cartes postales de leurs vacances.
L'auteur, qui est aussi photographe et journaliste, porte témoignage de ce genre d'endroit qu'on redécouvre actuellement comme un lieu convivial, exprime une sorte de plaidoirie pour le maintient de ces établissements que la législation a longtemps voulu supprimer au nom de la lutte antialcoolique.
Il le fait avec humour et nostalgie mais aussi empathie, en conservant les clichés et le langage populaire qui ont cours entre ces murs, en évoquant Jeanne, dernière représentante d'un petit commerce qui lentement disparaît, tué par la modernité autant que par les tracasseries administratives et la nécessaire rentabilité, et contre quoi le poids des mots ne pourra rien.
Leur disparition désertifie le centre des villes et des villages, témoigne de l'évolution d'une société qui détruit ses fondements traditionnels et même la nécessaire cohésion sociale.
Cette démarche littéraire et personnelle de Pierrick Bourgault, qui a passé son enfance dans la café de son grand-père, correspond bien à l'esprit de cette collection ("une vie, une voix") qui souhaite rendre compte de la société contemporaine et des vies ordinaires. Elle a déjà retenu l'attention de cette chronique et j'y serai particulièrement attentif.
Hervé Gautier - Janvier 2020
Ne d'aucune femme - Franck Bouysse La manufacture de livre
Le titre d'abord est surprenant, paradoxale même, mais ce roman est à la fois bouleversant et passionnant à cause du mystère qui entoure cette histoire un peu compliquée, à laquelle on a du mal à croire tant elle est sordide et hors de notre temps, encombrée de cadavres à la mort parfois atroce, mais qui pourtant me paraît plausible compte tenu du contexte, simplement parce qu'elle met en scène des êtres humains dans tout ce qu'ils ont de maléfique, c'est à dire bien souvent l'ordinaire de l'espèce humaine qu'on cache sous des apparences hypocrites du secret et du mensonge. 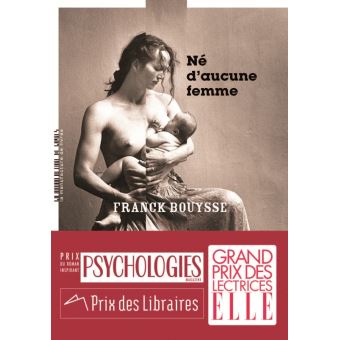
Tout se déroule sous l'égide de Gabriel, ce vieux curé de campagne qui se transforme en enquêteur volontaire et déterminé à cause d'une révélation de confessionnal et qui réussit à obtenir la vérité sur une énigmatique histoire de disparition d'un enfant, de séquestration arbitraire d'une femme, grâce à quelques pages manuscrites de cahiers dissimulés sous la robe d'un cadavre qu'il doit bénir et d'une mystérieuse tache de naissance.
Au delà de de l’écheveau obscur de ce récit, de ses personnages parfois inhumains, il y a ce contexte de pauvreté qui projette le lecteur dans l'univers de Maupassant, quand des parents vendent leur enfant, surtout leur fille, et ne supportent plus le remords et parfois la folie qui accompagnent leur choix.
C'est aussi cette attitude des hommes qui, parce qu'ils ont de l'argent ou du pouvoir, se croient autorisés à tout, depuis le mépris et la trahison de leurs semblables, jusqu'à leur élimination physique. On n'échappe pas non plus à l'obsession de la transmission de la vie comme une obligation humaine et son pendant, la mort comme un rendez-vous qui nous est donné sans que nous en connaissions ni la date ni les circonstances, en même temps que le premier souffle de notre vie.
Ce que j'ai retenu c'est la force du destin qui s'impose à chacun, ces êtres concentrés dans un même lieu géographique qui se croisent et s'ignorent au cours du temps, du désespoir face à l'impuissance, à la lâcheté, à la complicité malsaine, à la misère, à l'injustice et à la souffrance dont la mort est la seule échappatoire, la seule délivrance.
J'ai aussi été interpellé par le personnage de Rose et par sa démarche personnelle au regard de l'écriture, même si j'ai eu un peu de mal à admettre qu'une jeune fille sans grande instruction se mette ainsi spontanément à confier sa propre histoire à la feuille blanche, mais après tout pourquoi pas, c'est ce qui la rattache à la vie parce que ses mots sont avant tout des cris ("écrire ou plutôt écrier" dit-elle) face à son quotidien d'esclave, son amour impossible avec Edmond, l'enfermement dans sa propre condition et la mort qui, à chaque page transpire avec sa certitude d'impunité.
Grâce à l'écriture et à l'imagination, Rose se laisse aller au fantasme autour de cette histoire d'amour avorté, sort de sa claustration de quatorze années grâce aux mots, même si elle finit par douter de leur véritable force. Malgré nous, ils finissent par s'enraciner dans notre esprit au point de se transformer en passions d'autant plus nocives qu'elles ne verront jamais le jour. Je m'interroge toujours sur l'effet cathartique de l'écriture.
C'est un avis personnel, mais il me paraît étonnant pour un auteur de pouvoir écrire une telle histoire en la puisant dans sa seule imagination. Il doit bien y avoir quelque part, malgré le brouillage des pistes et la cruauté du récit, une approche très personnelle de cette histoire.
La réflexion sur la vie aussi m'a interpellé en ce qu'elle est différente du message forcément religieux porté par le curé. C'est celle du néant de l'avant-naissance puis à nouveau de celui de l'après-mort, avec cette parenthèse douloureuse et incompréhensible, un véritable cadeau empoisonné qu'est la vie, à la fois l'image du choix des autres qui nous est imposé et la mission parfois impossible d'en tirer bénéfice, avec l'aide de Dieu, si toutefois on y croit ou si on la chance de le rencontrer et l'interdiction morale du suicide.
J'ai découvert, un peu par hasard, l’œuvre de Franck Bouysse, notamment à travers “Grossir le ciel”. J'ai retrouvé avec plaisir le style juste, précis, respectueux des mots, de leur musique, de leur charge émotionnelle et poétique et des personnages jusque dans leur façon différente de s'exprimer et d'exister.
C'est un roman que j'ai lu sans désemparer tant il est captivant et émouvant. Ce fut là aussi un bon moment de lecture.
Hervé Gautier - Janvier 2020
Livre(s) de l'inquietude - Fernando Pessoa.
Traduit du portugais par Marie-Hélène Piwnik.
 Nous connaissions déjà "Le livre de l'intranquillité "(paru en 1990) de Fernando Pessoa mais que l'auteur avait attribué lui-même à Bernardo Soares, un hétéronyme, c'est à dire un des nombreux doubles de lui-même puisqu’il n'a que très rarement signé ses œuvres de son propre nom et qu'il n'a pratiquement pas connu la notoriété de son vivant. Voici cet ouvrage qui inclut les œuvres inédites du Baron de Teive et de Vicente Guedes à celles de Bernardo Soares, chacun de ces “auteurs” vivant en quelque sorte sa propre vie et écrivant dans son propre style. Ces textes ont été réunis par Térésa Rita Lopez, universitaire portugaise spécialiste de l’œuvre de Pessoa.
Nous connaissions déjà "Le livre de l'intranquillité "(paru en 1990) de Fernando Pessoa mais que l'auteur avait attribué lui-même à Bernardo Soares, un hétéronyme, c'est à dire un des nombreux doubles de lui-même puisqu’il n'a que très rarement signé ses œuvres de son propre nom et qu'il n'a pratiquement pas connu la notoriété de son vivant. Voici cet ouvrage qui inclut les œuvres inédites du Baron de Teive et de Vicente Guedes à celles de Bernardo Soares, chacun de ces “auteurs” vivant en quelque sorte sa propre vie et écrivant dans son propre style. Ces textes ont été réunis par Térésa Rita Lopez, universitaire portugaise spécialiste de l’œuvre de Pessoa.
C'est le résultat d'un travail difficile puisque l’œuvre de l'écrivain lisboète était non seulement composée de feuilles éparses mais aussi parce que l'édition française de 1990 limitait le texte au seul Bernardo Soares ("Livro do desassossego" por Bernardo Soares). C'est un triptyque, un soliloque à trois voix, une sorte de miroir qui nous renvoie une image virtuelle de Pessoa, caché de l'autre côté de la glace, une façon bien personnelle de se faire l'écho de ce qu'il est, de ce qu'il voit et de ce qu'il ressent. Dans cette version, d'ailleurs un peu différente du"Livre de l'intranquillité" on retrouve cette impression de l'impossibilité de trouver la quiétude dans ce monde, une sorte de trouble permanent, un désagrément, un mal de vivre.
Toute sa vie Pessoa s'est ingénié à brouiller les pistes puisqu'il n'a presque jamais publié de son vivant, laissant le soin à ses contemporains, après sa mort, d'explorer la multitude de textes déposés (27000) par ses soins dans une malle sous forme de feuilles séparées et attribuées à de nombreux auteurs, comme autant de petits cailloux destinés à un jeu de piste. C'est une manière pour lui d'explorer son “moi” multiple et complexe autant que de demander à son lecteur éventuel de ne pas chercher à le comprendre.
Vicente Guedes est un être décadent et désargenté, une sorte d'intellectuel de la pensée, un modeste employé de commerce, un penseur impénitent qui aime à analyser ses rêves dans un style recherché mais parfois un peu trop intellectuel, le baron de Teive est un aristocrate stoïcien que le suicide fascine et pour qui l'action est un paradoxe et qui s'exprime dans un style austère, quant à Bernardo Soares, aide-comptable employé de bureau comme lui, c'est un éternel promeneur solitaire, arpentant les rues de Lisbonne ou regardant de sa fenêtre les gens passer dans la rue et qui en parle avec une certaine ironie à laquelle il mêle des remarques personnelles désabusées sur sa vie au quotidien; j'avoue de cet hétéronyme à ma préférence à cause de sa vision des choses de l'existence et la manière qu'il a de l'exprimer.
Je ne suis pas un spécialiste, mais à chaque fois que je lis Pessoa, il me semble que pour lui l'écriture, et cette forme particulière qui consiste à prêter son talent à un autre en s’effaçant derrière lui et en s'excusant presque d'exister, est pour lui une sorte d'antidote à sa vie de subalterne anonyme. Par le rêve jusques et y compris s'il ne mène nulle part ou n'enfante que des chimères et surtout par l’écriture, les mots qu'il trace sur le papier, il se réfugie dans un monde imaginaire, tisse autour de lui et pour lui seul, un univers différent, habite même un autre corps et un autre destin, ce qui l'aide (peut-être) à supporter cette succession de jours qu'il passe pour gagner sa vie dans un sombre bureau.
C'est sans doute aussi une forme exprimée personnellement de cette “saudade” qui fait tellement partie de l'esprit lusitanien et que le poète Luis de Camões a défini comme "Un bonheur hors du monde", l'expression d'un manque de quelque chose autant qu'un espoir d'autre chose qui par ailleurs peut-être assez indéfini, une sorte de référence à un passé révolu qu'on voudrait bien voir revivre... C'est étonnant de voir cet homme discret qui, après sa mort sera considéré comme un des plus grands écrivains portugais, confier à des feuilles volantes, c'est à dire un support bien fragile, le cheminement de sa pensée complexe, vivre simplement en ne recherchant pas la notoriété et la consécration comme c'est souvent le cas chez les membres de l'espèce humaine et spécialement chez ceux qui font œuvre de création.
Ce sont donc trois facettes judicieusement révélées de Pessoa lui-même, une autobiographie en trois temps, un journal intime en trois moments à la fois complémentaires et cohérents, où la solitude et l’inaptitude à vivre se lisent à chaque ligne.
©Hervé Gautier.
novembre 2019
Mamie Luger Benoit Philippon-Editions Equinox-Les ArEnes
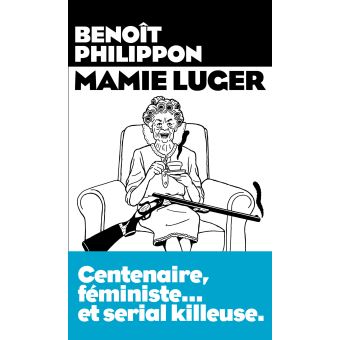 Imaginez un peu Berthe, une vieille de 102 ans, ridée et édentée, avec sonotone et arthrite, genre Ma Dalton ou Calamity Jane, qui vient, dès potron-minet, de tirer sur son notaire de voisin à la 22 long rifle et qui a fait face, arme à la main, aux forces de l'ordre au fin fond du Cantal. Au commissariat, devant l'inspecteur Ventura qu'elle s'évertue a appeler Lino alors qu'il se prénomme André, elle ne s'en laisse pas conter et entreprend même d'enrichir le vocabulaire du susdit, mais pas vraiment dans la langue châtiée de Jean d'Ormesson !
Imaginez un peu Berthe, une vieille de 102 ans, ridée et édentée, avec sonotone et arthrite, genre Ma Dalton ou Calamity Jane, qui vient, dès potron-minet, de tirer sur son notaire de voisin à la 22 long rifle et qui a fait face, arme à la main, aux forces de l'ordre au fin fond du Cantal. Au commissariat, devant l'inspecteur Ventura qu'elle s'évertue a appeler Lino alors qu'il se prénomme André, elle ne s'en laisse pas conter et entreprend même d'enrichir le vocabulaire du susdit, mais pas vraiment dans la langue châtiée de Jean d'Ormesson !
Non seulement elle a envoyé son voisin à l’hôpital mais elle a aussi couvert la fuite d'assassins qui maintenant sont en cavale. Rapidement son interrogatoire, accessoirement un peu surréaliste et pas mal folklorique dans le cadre d'une procédure policière, glisse vers la biographie mouvementée de sa famille et de la sienne propre et on s'aperçoit que plus elle parle, plus elle aggrave son cas. Sa vie n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille et si elle a été une belle femme fort avenante, elle en a bien profité avec les hommes. Pour l'heure, elle boit sec, a la détente chatouilleuse, l'homicide facile et la langue bien pendue, quant à son surnom de « Mamie Luger » , il lui vient d'une mésaventure de la 2° guerre qui a mal tourné surtout pour un soldat allemand. Berthe a beau être une tueuse en série, il passe entre l'inspecteur et elle une sorte de courant de sympathie bien incompatible avec une garde à vue réglementaire.
Il faut dire que ses aveux qui ressemblent plutôt à une confession ont été des plus précis, justifiant autant la longévité exceptionnelle de Berthe que son surnom. Elle a même tendance à confondre instruction judiciaire et divan du psychanalyste et c'est sans doute cette incursion dans le passé, qui bien souvent donne le vertige, à moins que ça ne soit sa volonté de se décharger avant de mourir d'un poids trop lourd à porter pendant trop longtemps, qui provoquent chez elle un malaise. C'est plutôt dommage parce que, dans le même temps, une perquisition se déroule chez elle et ce que trouvent les policiers est plutôt époustouflant. Le suspense est donc au rendez-vous et le lecteur découvre les faits, au rythme des nombreux analepses de ce roman. Et puis cette volonté de tout avouer, ce qui la conduira à une lourde condamnation, n'est-elle pas aussi une envie de tout simplement en finir ?
C'est qu'elle sait ce qu'elle veut, Berthe et quand elle a décidé de trucider un homme, il ne perd rien pour attendre et elle met toujours ses projets à exécution, surtout ceux-là ! Si elle a commis ces assassinats presque naturellement, c'est avec la bonne conscience de celle qui agit pour son bien. Elle n'était pas vraiment préparée à cette épreuve policière puisque, dans le cadre de cette procédure où l'on peut parfaitement garder le silence, elle est à la fois prolixe de détails et convaincante au point que Ventura lui donnerait presque raison d'avoir perpétrer cette hécatombe d'hommes et l'ambiance de ce bureau d’interrogatoire n'a vraiment rien d'agressif. Heureusement il y a l'enquête qui se rappelle à lui et le maintient dans le rôle de gardien de la loi.
On le sent quand même un peu partagé entre la volonté de révéler la vérité dans cette affaire et la compréhension qu'il éprouve pour cette vielle femme finalement pas si antipathique que cela, son empathie le disputant à son envie de connaître la fin de cette histoire. Son attitude envers elle et les dialogues quelque peu emprunts de familiarités qu'ils échangent, détonnent un peu sur l'ambiance qu'on s'attend à rencontrer dans un tel contexte.
Elle devait bien avoir un problème avec les hommes pour les traiter ainsi ou bien, après avoir ainsi satisfait son désir de vengeance, s'attachait-elle à faire prévaloir hypocritement les apparences trompeuses, donnant d'elle l'image d'une vieille dame bien tranquille. C'est un paradoxe, elle ne peut se passer des hommes mais s'en lasse vite, prenant conscience, mais un peu tard, qu'elle a fait une erreur, funeste cependant, surtout pour ses éphémères partenaires. C'est sans doute sa manière à elle de rétablir l'égalité des sexes !
Quand j'ai ouvert ce livre, je m'attendais, à cause sans doute de sa couverture ou de son titre, à un polar classique. Or ce n'en est pas un, nonobstant le nombre des victimes de Berthe. Je lui ai trouvé un côté attachant, émouvant, sensuel parfois, tant les choses qui y sont dites le sont non seulement avec une écriture fluide et plaisante à lire, bien éloignée de celle employée traditionnellement dans ce genre romanesque, mais aussi parce que cela parle de la vie ordinaire avec ses joies, ses peines, ses projets avortés, ses remords, mais aussi du racisme, de l'intolérance, de l'amour impossible, du destin implacable, autant de thèmes devant lesquels l'humour, pourtant bien présent au fil des pages, devient soudain dérisoire.
Oui, pour tout cela, j'ai bien aimé ce roman.
©Hervé GAUTIER.
décembre 2019
Serotonine Michel Houellebecq (Flammarion)
Florent-Claude Labrouste est un presque quinquagénaire déprimé, légèrement obsédé sexuel, porté sur la bouteille et de son propre aveu un « loser », un décadent, un raté ! Il n'a pas vraiment la volonté de réagir sauf à prendre un médicament, le Captorix, censé libérer rapidement dans son corps la sérotonine qu'on peut assimiler à l'hormone du bonheur, sauf qu'il entraîne pour lui une forme d'impuissance sexuelle et de perte de libido ce qui ne l'arrange pas du tout. Il a perdu bêtement l'amour de Camille, une femme avec qui il aurait bien aimé se marier, la recherche dans toutes celles qu'il croisent et vit avec une Japonaise avec qui il s'ennuie. 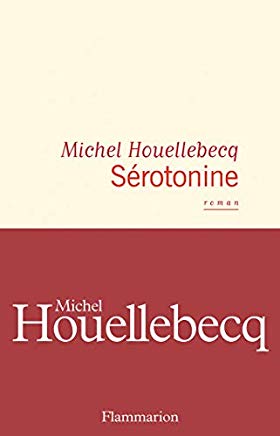
De plus, ni cette compagne très temporaire qui n'est pas vraiment fidèle, ni son travail sans intérêt et qu'il abandonne, ni même son médicament, ne parviennent à le guérir de sa déréliction, de ses obsessions et à lui donner des raisons de vivre pleinement. Aussi bien, réfractaire au suicide, choisit-il de partir, c'est à dire fuir une société qui ne lui convient pas, et de se fuir aussi lui-même, ce qui est à ses yeux l'unique solution.
A travers son seul ami Aymeric, éleveur de vaches normandes, il constate la décrépitude de la paysannerie face à l'industrialisation au productivisme, ce qui n'améliore pas sa vision de la société qu'il rapproche forcément de la sienne propre. La prise de son médicament ne guérit pas sa dépression chronique qu'il soignerait volontiers par une activité sexuelle débridée, mais cela lui est devenu impossible et il ne peut que ressasser ses souvenirs ! C'est un peu comme s'il tournait en rond sans jamais pouvoir trouver une sortie.
Alors il poursuit dans chacune des femmes qu'il séduit l'impossible rencontre avec Camille, pour lui définitivement disparue, une copulation animale sans retenue avec une inconnue et ne conçoit une femme que dans son lit. Il y a cette attente désespérée de la sensualité à travers la figure féminine. Cette demande de nature sexuelle peut passer pour une obsession dévastatrice mais cela fait aussi partie de la vie d'un homme et j'ai eu le sentiment que, pour lui, le sexe est plus une antidote à sa solitude qu'une exploration renouvelée des mystérieux couloirs du plaisir et à chaque fois qu'il rencontre une femme, sa première idée est de coucher avec elle.
A sa situation pour le moins délétère, il oppose la figure de Camille qu'il espère retrouver et l'amour fou et exclusif de ses parents, unis jusque dans la mort, et ce souvenir l'obsède. Les aphorismes qu'il choisi d'asséner à son lecteur au sujet de l'amour ont au moins l'avantage de le porter à réfléchir et d'ouvrir le débat.
C'est bien connu, Houellebecq est à la fois cynique, désabusé, grossier, mais je dois bien avouer que le constat qu'il fait d'une société en pleine déliquescence et vouée aux dérives de la productivité est inquiétant. C'est le roman des « espérances déçues », face aux affirmations lénifiantes et abusives qui prétendent que la vie est belle et j'ai personnellement beaucoup de mal à donner tort à notre auteur dans son appréciation des choses et si nous regardons autour de nous, force est bien de constater qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir.
Il nous dépeint une société très actuelle, déshumanisée, où chacun vit en ignorant l'autre, et cette attitude délétère affecte même le couple qui pourrait passer comme l'ultime recours. On devient misanthrope pour moins que cela ! J'ai ressenti une atmosphère de fin de vie dans ce roman, un peu comme si la désespérance était telle pour cet homme qu'il valait mieux, tout bien réfléchi, quitter ce monde même si ce départ s'accompagne de regrets, Camille n'était plus pour lui qu'un fantôme inaccessible et que sa vie n'avait été finalement qu'un cheminement laborieux et inutile. Je n'ai cependant pas compris cet ultime référence à Dieu comme maître de notre destin individuel.
Il y a en effet un autre personnage, peut-être plus en retrait mais non moins important qu'est Aymeric. Lui aussi c'est un idéaliste qui a cru à son rêve parce qu'il était partagé par son épouse. Mais celle-ci, déçue, est partie avec un autre homme se tricoter un avenir différent parce qu'Aymeric s'est fait trop d'illusions et n'a rien vu venir, aveuglé qu'il était par ses certitudes définitives, sur l'amour notamment. Il tente de se guérir de cet échec par l'alcool et la drogue mais ce sera une impasse pour cet homme désespéré qui songe sans doute à la mort comme une solution potentielle.
Dans « La carte et le territoire » le thème de la mort est abordé sous la forme d'un crime énigmatique. Ici Aymeric me paraît avoir choisi une forme de suicide lent et progressif qui sied bien à son état dépressif mais quand il décide de conclure dans un geste définitif on ne sait pas vraiment s'il faut l'imputer à sa situation personnelle ou pour la cause qu'il prétend défendre.
Si Florent-Claude partage son état d'esprit, il m'a semblé que, lui, au contraire a choisi d'attendre la mort qui est inéluctable comme nous le savons, mais dans une sorte de fatalisme, avec cependant une lueur d'espoir (qui peut prendre les traits de Camille), un peu comme s'il avait choisi de survivre malgré tout, au cas où pour lui les choses changeraient enfin ou peut-être comme s'il s'imposait de rester en vie pour expier cette perte coupable de l'être aimé !
Son style, à l'humour parfois grinçant, est sans doute fort éloigné de celui qu'on attend d'un écrivain traditionnel couronné par le prix Goncourt, mais c'est son style et je crois que nous avons déjà connu cela au cours de notre histoire littéraire. La littérature s'enrichit aussi de cette manière et évolue à travers ces auteurs qui, pour certains, y ont laissé leur nom.
D’ailleurs, même s'il est un peu mono-thématique à tendance obsessionnelle, nonobstant quelques longueurs et des détails parfois techniques bien inutiles (je me suis demandé si l'accumulation de détails apparemment anodins ne cachait pas un mal-être profond), je ne me suis pas du tout ennuyé à la lecture de ce roman et je l'ai même lu avec attention et passion.
J'ai déjà eu l'occasion de commenter les œuvres de Houellebec dans cette chronique et je n'ai pas toujours été ému par ses romans. Ici, malgré le style que je ne goûte pas toujours, je suis bien obligé d'admettre qu'il porte sur notre monde un regard, certes désabusé mais plein de bon sens. On ne demande pas forcément à un auteur de créer, grâce à son imagination un monde différent, qui nous éloigne un temps de notre quotidien, et, refuser de voir dans le miroir d'un livre l'image peu flatteuse de notre société, n'est guère raisonnable.
Après tout un écrivain se doit aussi d'être reflet de son époque, que son œuvre se nourrisse de son expérience est plutôt une bonne chose et cela tisse son originalité et son authenticité. Qu'il ait choisi de puiser dans son état dépressif pour parler du déclin et de la désespérance de l'homme occidental, dans un décor banal et morne, me paraît être une photographie assez bonne de notre société.
La référence à Thomas Mann, à la fin, me paraît significative. Le fait qu'il le fasse dans un langage simple et pourquoi pas cru, rend son témoignage accessible à tous ses lecteurs. Il me semble d'ailleurs que la tristesse qui ressort de tout cela est soulignée par une succession de séquences, comme juxtaposées (épisode de l'Allemand pédophile, manifestations paysannes vouées à l'échec, séances de tir, désintérêt constant et croissant pour l'actualité quotidienne, variation sur la chatte des femmes…) et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. L'auteur est toujours aussi labyrinthique dans sa démarche d’écriture, mais j'ai souvent goûté chez les autres écrivains ce rythme de création pour ne pas l'apprécier chez lui. Il ne peut pas non plus se dispenser d'aphorismes définitifs souvent pertinents, et après tout cela aussi fait son charme.
Je passerai sur la polémique initiée en quelques mots par l'auteur au sujet de la ville de Niort qu'il dénigre au début de son roman. Cette cité, qu'on a toujours eu du mal à situer sur le cadastre national, a, peut-être grâce à lui, connu un afflux de personnes qui ont pu vérifier que son appréciation négative ne correspond heureusement à rien.
©Hervé Gautier. Juin 2019
L'euphorie des places de marché Christophe Carlier
On peut compter sur les économistes, en situation de crise, pour rajouter tous les jours une couche de sinistrose, et nous promettre des dégringolades de la part des agences de notation, d'immanquables récessions et d'incontournables kraks boursiers. Pourtant cela ne fait ni chaud ni froid à Norbert Langlois, trente ans, rompu aux lois du marchés et qui souhaite faire de Buronex dont il est le nouveau directeur, une entreprise en pointe dans ce contexte morose. 
Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme on dit, s'il n'y avait Agathe, une plantureuse rousse entre deux âges, secrétaire de direction dans cette entreprise, qui, avec vingt ans d'expérience, maîtrise parfaitement… l'art de ne rien faire ! Cette inactivité lui permet notamment de ne pas risquer l'erreur professionnelle, apanage de ceux qui travaillent, ce qui la conduirait tout droit à l'agence pour l'emploi. Elle était là à la création de cette entreprise qui, après plusieurs patrons et pas mal de restructurations, a échu à Langlois, un manager aux dents longues qui entend la développer à l'international.
Autant dire que l'incontournable Agathe qui a toujours « fait partie des meubles », a survécu jusqu'à aujourd'hui à tous ces changements de sorte que ce quasi droit d’aînesse la met, croit-elle, dans une position favorable pour « développer » son inertie alors que le patron ne rêve que de s'en débarrasser. Si elle passe son temps à se faire les ongles, et ainsi menace gravement la productivité de la maison, lui se les ronge à imaginer une manière de lui faire prendre définitivement la porte.
Il fait ainsi appel à son imagination débordante pour la pousser à la faute tout en redoutant son aplomb, son à propos et surtout sa mauvaise foi devant lesquels un licenciement classique n'a aucune chance d'aboutir. Il va même, dans son empressement à s'en séparer jusqu'à envisager un crime mafieux ! Mais ça fait un peu désordre.
Tout ce quotidien qu'on a du mal à qualifier de laborieux, vu du côté d'Agathe, est sans incidence sur l’embellie de la bourse qui maintenant s'installe dans ce paysage où cette secrétaire continue de faire ce qu'elle peut… pour ne rien faire ! Il ne faut cependant pas croire qu'elle n'a pas, comme on dit, « la culture d'entreprise » et sait fort bien payer de sa personne quand la nécessité s'en fait sentir, surtout quand son intérêt personnel est en jeu.
Bref, à la Burotex, tout va pour le mieux, surtout pour Agathe qui continue à vivre dans le monde du travail à sa manière sans se soucier des variations de la bourse et du stress qui ailleurs et dans un contexte ordinaire plombe la vie des salariés. Elle jette sur la société qui l'entoure un regard aussi indifférent que celui qui gouverne son quotidien d'employé.
Quant à Langlois, la présence de Ludivine, une stagiaire, taillable et corvéable comme il se doit, gomme à la fois ses variations de tension artérielle, ses états d'âme et les absences d'Agathe !
Cette aimable fiction, au titre un peu trompeur, qui n'a pas grand chose à voir avec le monde du travail de la vraie vie, même si parfois certaines remarques et situations peuvent se révéler pertinentes, nous rappelle que l'économie n'est pas une science exacte et varie au rythme aléatoire et instable de la politique et des rumeurs, que la virtualité s'installe de jour en jour davantage dans notre quotidien et que les relations entre les humains n'ont guère changé depuis le commencement des temps.
Et puis, nous qui avons travaillé, nous avons tous, un jour ou l'autre, croisé une Agathe que nous avons détestée pour ses impérities.
J'ai rencontré l’œuvre de Christophe Carlier un peu par hasard. J'apprécie autant son humour que son style délié et ce court roman, pertinent et impertinent a été, somme toute, un bon moment de lecture même si la description qu'en fait l'auteur n'est pas exactement semblable à ce qu'il est en réalité.
On peut bien rire de cela aussi, après tout. Je crois qu'en cas de sinistrose ce serait même conseillé !
© Hervé GAUTIER – Avril 2019.
La vérité sur l'affaire Harry Quebert Joël Dicker
C'est bien d'être un écrivain à succès dont le premier roman a bien marché, d'habiter New-York et d'être reconnu dans la rue, bref, d'avoir du succès. C'est ce qui est arrivé au jeune Marcus Goldman et bien entendu son éditeur attend le suivant, sauf que, cela fait un an que notre ami n'a rien écrit, pire, il ne se sent plus capable d'aligner des mots, on appelle ça la crise de la page blanche et ça n'arrive pas qu'aux autres.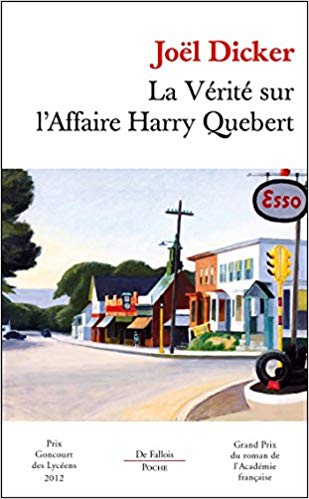
Il y a donc urgence et il se tourne vers son ami, Harry Quebert, 68 ans, grand romancier américain et ancien professeur d'université dont il a été l'étudiant, qui vit à Aurora, une ville imaginaire que l’auteur situe dans le New Hampshire. Au même moment, Quebert, 34 ans au moment des faits, est poursuivi et incarcéré pour le meurtre d'une jeune fille, Nola Kellergan, 15 ans à l'époque, fille de pasteur, avec qui il avait une liaison secrète et qui a disparu trente trois ans plus tôt sans qu'on ait retrouvé son corps, ainsi d'ailleurs que de l’assassinat de Deborah Cooper, la femme qui avait donné l'alarme.
A l'époque il avait été soupçonné, mais faute de preuves n'avait pas été inquiété, l'enquête s'était égarée entre témoignages contradictoires et accusations gratuites et l'affaire avait été classée. La découverte récente des restes de Nola, enterrés dans son jardin, accompagnés du manuscrit d'un roman à succès de Harry et d'une mention manuscrite, a rouvert cette enquête en pleine élection présidentielle de 2008, et tout l'accuse.
Avec de nombreux analepses, le lecteur voyage dans le temps, entre 1975 et 2008 et mesure combien Harry était amoureux fou de Nola. Bien entendu Goldman n'est pas policier et même si on le lui déconseille fortement, il va tout faire, en compagnie d'un ancien flic qui partage son avis, pour démontrer l'innocence de son ami.
Malgré les intimidations, Marcus enquête et ses investigations révéleront des secrets sordides de cette petite ville apparemment tranquille, la présence d'un autre homme auprès de Nola et de circonstances troublantes qui ont entouré son décès. D'un autre côté, l'éditeur de Marcus, le talonne et le menace même d'un procès s'il n'écrit rien. Il est toujours à l'affût d'un succès et donc d'une bonne affaire financière et lui suggère de raconter cette histoire et ainsi de relancer sa carrière. Tel est le point de départ de ce roman qui ne doit rien à la plume et à l'inspiration de Marcus qui n'en sera que le scribe. C'est un véritable thriller à l'américaine, mais aussi une sorte de mise en abyme qui nous fait participer directement à l'écriture du roman.
C'est donc un authentique polar avec tout le suspense qui va avec, Dicker tenant son lecteur en haleine jusqu'à la fin, démontant chaque accusation, apportant un éclairage nouveau, et ce pas seulement à cause de la longueur de ce livre (656 pages), ce qui pour moi est rarement un encouragement à la lecture.
L'auteur en profite pour parler de l'écriture et des écrivains, mais aussi pour régler ses comptes avec les éditeurs en évoquant les conditions de travail qu'ils imposent à leurs auteurs, avec le plagiat, la justice, la politique, les médias qui déforment tout pour faire un scoop et vendre du papier, l'hypocrisie et le mensonge qui, sous toutes ses formes est inhérent à la condition humaine, spécialement dans les villes américaines puritaines de la côte est.
Entre les secrets de la famille rigoriste de Nola, son père démissionnaire et sa mère abusive, l'amour fou d'Harry pour cette jeune fille mystérieuse, cet homme un peu trop romantique, victime d'une sorte de démon de midi, qui tente d'écrire pour elle un livre sur l'amour impossible et une adolescente qui veut avant tout se faire épouser malgré la différence d'âge et le scandale, qui cultive les apparences nécessairement trompeuses pour parvenir à ses fins, sa duplicité qui va jusqu'à la manipulation, la perversité et la séduction d'autres hommes, son suicide manqué, les jalousies que cet amour suscite, ce roman se tisse par petites touches.
Trente trois années ont passé mais les passions, les haines et la volonté de cacher la vérité sont intactes et pour nos deux enquêteurs se profile de plus en plus le syndrome du crime parfait.
Les investigations de Marcus et de son compère mettent en évidence des zones d'ombre, des contradictions et des insuffisances dans l'enquête originale et provoquent les aveux longtemps cachés de ceux qui l'ont menée, la révélation de faits nouveaux, de relations inattendues et parfois difficiles entre les habitants de cette petite ville, la mise en cause de nouvelles personnes, la révélation de la duplicité de cette jeune fille dont la véritable personnalité est bien éloignée de l'image qu'elle a voulu en donner, le mensonge longtemps entretenu, le poids des remords, l'ambition démesurée...
L'épilogue à la fois inattendu et émouvant qui parle d'un homme poursuivi par un malheureux destin...
J'ai abordé ce roman sur les conseils d'une lectrice et aussi à cause de sa couverture reproduisant une toile d' Edward Hopper qui est un de mes peintres préférés et qui s'inspira aussi de ces paysages. Je l'ai lu avec plaisir, certes comme un policier bien écrit, mais aussi et peut-être surtout comme une étude de l'espèce humaine, ses passions, ses comportements sordides, sa désespérance.
Ce roman a reçu le Prix Goncourt des Lycéens et le Grand Prix du Roman de l'Académie Française 2012
©Hervé Gautier - Avril 2019.
La vie automatique Christian Oster (Éditions de l'Olivier)
A quoi ça tient quand même hasard, un fait qui arrive et qu'on laisse se dérouler sans réagir parce que, inconsciemment on l'attendait depuis longtemps.
C'est un peu ce qui arrive à Jean Enguerrand, acteur de troisième zone qui, parce qu'il a hérité d'un cageot de courgettes par erreur, qu'il a voulu les cuisiner et les a oubliées sur le feu, voit sa maison brûler et en profite pour disparaître et entamer une nouvelle vie. On a l'impression qu'il est soulagé par cet événement alors que, pour le commun des mortels, ça devrait être un drame. Il prend le train pour Paris bien décidé à s'effacer de ce monde, un peu comme si sa propre vie lui était devenue complètement indifférente , comme si cet événement était pour lui l'occasion d'oublier définitivement quelque chose, de tourner la page ! 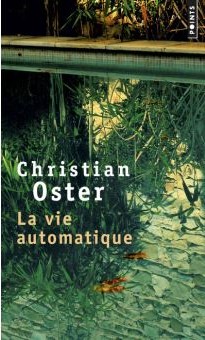
De cela nous ne saurons rien et il gardera son secret. Il a conscience de n'être rien et cela ne le dérange pas. Sa vie est une sorte de vide, il ne souhaite même pas réagir devant cet état de chose qui fait partie de sa vie mais qui, maintenant, à cause de l'incendie de sa maison, se révèle dans toute son évidence. Il logera simplement à l'hôtel ! Dans son métier, il croise des gens, sûrement semblables à lui mais c'est la même indifférence à leur égard. Pourtant dans cette société qui est la nôtre, il convient de se mettre en valeur, de se « vendre », de réussir, faute de quoi il ne manque pas de gens pour jeter l'anathème sur vous, vous culpabiliser ou simplement vous détruire.
Ainsi détonne-t-il sur ses contemporains, mais peu lui chaut parce que, il le sait, son nom ne sera jamais en haut de l'affiche, tout juste au générique de films de série B. Il fait quand son métier de comédien, se lance même dans le théâtre, mais le fait d'une manière détachée, comme pour gagner simplement sa vie. Pourtant son errance l'amène par hasard chez France, une ancienne actrice qui a eu son heure de gloire mais qui veut, elle aussi, tout oublier. Ils se sont peut-être croisés sur les plateaux dans une autre vie, mais Jean a toujours été voué aux rôles secondaires. Il squatte cependant chez elle parce qu'elle l'y invite mais ils ne deviendront cependant pas amants comme on pourrait s'y attendre! Puis ce sera Charles, le fils de France qu'il suivra dans ses dérives psychiatriques.
Assez bizarrement Jean se donne pour mission, un peu à la demande de France, de le surveiller et sans doute aussi de le soutenir, s'attache à lui comme une ombre au point qu'on peut se demander si, par une sorte de transfert, il ne souhaite pas le sauver, l'insérer dans une société dans laquelle lui, Jean, ne veut plus entrer, un peu comme si cette rencontre avait déclenché chez lui une sorte de regain d'intérêt pour la vie de l'autre, Cette posture se justifie à la fin par le geste de Charles qu'il analyse en une invitation à contourner ce monde.
Il y a entre Jean et France une communauté de vue, mais apparente seulement. France souhaite revenir au théâtre et le fait avec talent mais Jean au contraire veut le fuir comme il veut fuir tout ce qui est autour de lui, C'est un personnage assez insaisissable, qui peut paraître un peu extravagant, pas tellement désagréable cependant, qui jette sur l'existence un regard désabusé et même désespéré parce qu'il ne se sent même plus concerné par sa propre vie.
Alors, « une vie automatique », comme si un mécanisme déroulait son ressort dans le vide, une sorte d'inaptitude à vivre normalement comme le commun des mortels. Mais Jean ne se laissera pas aller à un geste létal et attendra la mort avec fatalisme voire curiosité parce que simplement elle la conclusion normale de cette vie
C'est écrit simplement, sans doute à l'image de ce Jean de plus en plus détaché de tout. Ce style est un peu déconcertant quand même. Je ne suis pas fan des héros qui crèvent l'écran et, même si cette fiction est quelque peu étonnante et décalée, j'y suis entré quand même. Ce Jean m'a rappelé le personnage de Pessoa, le grand écrivain portugais qui a vécu une vie en pointillés dans le quartier populaire de Lisbonne comme simple employé de bureau ou peut-être celui du capitaine Drogo du « Désert des tartares » de Dino Buzzati qui attend quelque chose qui ne viendra jamais.
Avaient-ils résolu d'attendre que la vie qu'ils avaient imaginée pour eux tienne ses promesses, oubliant que dans ce domaine leur imagination n'engendre que des fantasmes toujours déçus.
Jean. aussi a eu conscience de n'être rien, une sorte d'anti-héro solitaire et marginal mais en réalité qui me plaît bien. Il ne m'est pas antipathique du tout, bien au contraire et vouloir vivre en dehors de cette société de plus en plus contestée, de cette vie qui n'est finalement qu'une agitation vaine et dérisoire, ne me paraît pas absurde le moins du monde.
©Hervé GAUTIER – Février 2019
(Traduit de l'allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac)
C'est un recueil de trois nouvelles.
La première, qui lui donne son titre, évoque une sorte de folie meurtrière chez les Maltais (Amok) et ceux qui en sont victimes portent aussi ce nom. C'est ce qui est arrivé à ce médecin européen de la jungle qui a refusé par orgueil de venir en aide à une femme blanche de la bonne société et qui le regrette au point de la poursuivre frénétiquement, en vain. Il y a dans leur attitude respective de l'attachement amoureux chez le médecin ainsi qu'une volonté de se racheter et de l’orgueil hautain et destructeur chez cette femme, une sorte de stupidité paralysante et suicidaire pour les deux. 
La deuxième, « Lettre d'une inconnue », est la lettre d'une jeune femme qui va se donner la mort et qu'elle destine à un écrivain connu et riche séducteur qui fut son amant d'un soir et à qui elle révèle la mort de son enfant ainsi qu'un secret qu'il ne pouvait connaître.
La troisième, « La ruelle au clair de lune », se passe dans un port argentin et son quartier chaud avec ses bars et ses bordels. Même si on trouve de la poésie aux ruelles sombres, elles abritent toujours une faune interlope, des habitués et des putes. L'homme que rencontre le narrateur est un être abandonné par son épouse tombée dans la prostitution et qui l'humilie.
Il y a dans ces nouvelles à la fois une crainte et un désir de la mort face à l'impuissance ou à l'inutilité désormais évidente de la vie. Dans ces situations la vie n'est pas belle comme on nous en rebat un peu trop les oreilles, mais au contraire est une épreuve constante qui justifie ou peut justifier l'atteinte à sa propre existence ou à celle de l'autre qui la pourrit. A cela s'ajoute le culte du secret, le respect de la parole, celle qu'on donne à un autre et qu'on se donne à soi-même, la volonté que personne ne sache la vérité sur un drame devenu une chose à cacher, mais que le hasard contribue à révéler...
Nous assistons au déroulement d'événements qui annihilent la liberté individuelle comme si le destin implacable se manifestait soudain dans le quotidien et bouleversait définitivement les choses au point que les personnages, lassés peut-être de vouloir agir, mais désespérés par le cours que prennent les circonstances, s'en remettent au hasard pour finalement s'autodétruire posant cet acte comme le seul qui vaille dans cette vie dont ils veulent enfin se libérer. Dois-je rappeler que Stefan Zweig lui-même devait sans doute voir ainsi les choses puisqu'il s'est suicidé.
Monologue dans un cas, lettre d'amour anonyme et témoignage quasi solitaire dans les autres, nous avons là une confession qui précède la mort et la sanction qu'on s'inflige est avant tout une délivrance de cette vie désormais insupportable. Au-delà de l'absence de noms qui est un artifice parfois inutile, l'anonymat est important dans ces textes où les personnages principaux racontent leur histoire. Il donne sa tonalité de l'ensemble du recueil, un peu comme si, indépendamment de chaque contexte, tout cela ressortait de la condition humaine, appartenait à chacun d'entre nous simplement parce que, s'agissant de l'amour que nous avons tous un jour ou l'autre ressenti, cela ne peut pas ne pas nous parler.
Dans ces trois nouvelles, l'amour est associé à la mort, c'est encore une fois Éros qui danse avec Thanatos dans une sarabande infernale. Il y a le personnage principal, celui qui parle et qui ressent les choses. Il est humilié par celui ou celle pour qui il éprouve de l'amour et qui le décevra forcément parce qu'il ou elle le méprise ou l'ignore. C'est souvent l'image de la condition humaine quand l'amour n'est pas partagé et qu'on met en scène des personnages orgueilleux et qui se considèrent comme supérieurs aux autres, se croient tout permis et ne peuvent donc frayer qu'avec leurs semblables en jetant sur le reste du monde un regard condescendant. Il y a de la folie dans tout cela, celle du médecin devenu « Amok », celle de la femme inconnue qui n'a plus rien au monde, celle de ce pauvre homme qui veut croire que sa femme reviendra à lui alors qu'il finira par la tuer dans un geste désespéré.
Ces nouvelles sont une analyse de l'espèce humaine et notamment tout ce qui concerne la fierté. Le médecin commence par refuser son assistance à la femme parce que celle-ci ne veut pas le supplier de lui venir en aide. L'homme de la dernière nouvelle attend de son épouse qu'elle le remercie pour l'avoir sortie de la pauvreté et c'est aussi une certaine forme d'orgueil, conjugué il est vrai avec un amour fou, qui fait que la femme de la deuxième nouvelle refuse le mariage avec des hommes fortunés pour ne vivre qu'avec son enfant et le souvenir idéalisé de son seul amant.
Il y a aussi cette incroyable légèreté de ceux qui se croient autorisés à infliger à leurs semblables toutes les vilenies avec cette volonté d'humilier l'autre, surtout quand il s'agit de son conjoint. L'homme de la troisième nouvelle qui prend plaisir à rabaisser son épouse en lui refusant de l'argent est lui-même mortifié par elle quand il veut la reprendre.
J'ai, comme à chaque fois que je lis une œuvre de Stefan Zweig, apprécié à la fois le style fluide et agréable à lire de l'auteur autant que la finesse de l'analyse des sentiments et de la condition humaine.
© Hervé Gautier – Janvier 2019
Elsa mon amour - Simonetta Greggio (Flammarion)
Elsa Morante (1912-1985), écrivain (et non pas écrivaine) de grand talent, de nos jours injustement oubliée, a été l'épouse, à partir de 1941 et durant toute sa vie d'Alberto Moravia (1907-1990) également écrivain et ce malgré leur séparation et ses nombreuses maîtresses. Elle l'a suivi dans son exil provoqué en 1943 et 1944 par le fascisme. Ce roman est l'histoire de la vie d'Elsa, mais pas vraiment une biographie au sens habituel malgré les nombreux biographèmes égrenés dans ce livre, mais plutôt un récit où le rêve, l'illusion, prennent un peu, l'espace d'un instant, la place du réel, en modifie les apparences. 
Cela donne un récit acerbe et un peu désabusé et Simonetta Greggio précise elle-même qu'il s'agit d'une fiction où elle se glisse dans la peau d'une Elsa qui prend la parole en refaisant le chemin à l'envers. Elle n'échappe pas à la règle commune à chacun d'entre nous qui, parce que notre vie ne ressemble pas à ce dont nous avions rêvé, à ce que nous avons cru qu'elle nous réservait au point de l'ériger en promesses, se laisse aller à son désarroi et la repeint en couleurs vives, mais ce badigeon s'écaille au fils du temps. Nous avons beau rejouer cette comédie en faisant semblant d'y croire, de nous réfugier dans la beauté, la perfection ou l'imaginaire, nous dire que tout peut arriver, au bout du compte il nous reste les regrets, les remords, la culpabilité peut-être de n'avoir pas fait ce qu'il fallait ou nous incriminons la malchance...
Ainsi, sous la plume de l'auteure de « La douceur des hommes », Elsa Morante fait, dans un texte rédigé à la première personne, directement au lecteur la confidence de sa vie, de son parcours, jusqu'aux détails les plus intimes. Avant de rencontrer Moravia, elle avait connu des ruptures avec sa famille, des années de galère financière, n'était qu'un écrivain en devenir, avec pour soutien des amours de passage et surtout cette envie d'écrire qui sera sa passion toute sa vie, qui sera sans doute comme un exorcisme à ses illusions, à ses peines, à son absence de bonheur et d'amour.
Quand elle croise Moravia, ils sont à peu près du même âge et lui est déjà couronné par la succès de ses romans. En outre ce qui les rapproche est sans doute leur demi-judéité commune et sûrement aussi le désir (« Nous avons cela en commun, Moravia et moi. Nous ne lambinons pas avec le désir ». Ce fut peut-être de sa part à elle, un amour sincère mais elle nos confie qu'Alberto était à la fois « passionnel et infidèle, indéchiffrable » à la fois amoureux fou de ses conquêtes de passage et homosexuel non assumé. Elle qui n'avait pas connu le bonheur avec ses parents n'aura pas non plus un mariage heureux mais, malgré leur séparation, refusera le divorce, par principe (elle était l'épouse d'Alberto Moravia et le restera) ou pour des raisons religieuses. Ainsi l'histoire de cette longue liaison (49 ans), consacrée par le mariage ne fut pas un long chemin tranquille avec au début la fuite à cause des rafles de juifs, la peur d'être dénoncé et d'être déporté et plus tard, la paix revenue, un quotidien houleux où elle a été malheureuse de trop vouloir être aimée et d'avoir gauchement tout fait pour être détestée. La symbolique de la pluie, l'univers énigmatique des chats accompagnent cette ambiance un peu délétère tissée par l'indifférence de son mari devenu aussi un rival, l'abandon, la fuite ou la mort de ses amants successifs.
Nous ne sommes qu’usufruitiers de cette vie qui nous est confiée avec la mission non écrite et quelque peu hasardeuse d'en faire quelque chose. La sienne Elsa l'a dédiée à l'écriture, à l'amour par passion, à la patience, à la souffrance aussi, sans pour autant l'avoir voulue,mais qui est, elle aussi, un élan vers les mots. C'est avec ces mêmes mots qu'elle parle des maîtresses de son mari, de son inconstance mais aussi de la période noire de Mussolini qui endeuilla l'Italie. Elle ne résiste pas non plus à nous confier des anecdotes sur ses contemporains plus ou moins liés au fascisme, à la mafia, à la culture, peut-être pour tromper son ennui et surtout sa solitude. Elle les meublera en tombant à son tour amoureuse d'autres hommes, parfois des homosexuels mais reviendra toujours vers Moravia et surtout vers l'écriture. Elle devint un écrivain majeur de la littérature italienne..
Il y a des détails biographiques très précis, des citations qui témoignent d'un travail de documentation très poussé, des envolées poétiques émouvantes et même envoûtantes, le tout ressemblant à un tableau composé par petites touches d'où la personnalité et la sensibilité de Simonetta Greggio ne sont sans doute pas absentes. Parfois j'ai même eu l'impression que, derrière Elsa qui est censée s'exprimer à la première personne, c'est carrément elle qui parle au cours de ce bel hommage.
J'apprécie depuis longtemps l'écriture de Simonetta Greggio, sa sensibilité littéraire, ses choix et la qualité de ses romans, mais aussi sans doute parce que elle, Italienne, choisit d'écrire directement en français, ce que je prends comme un hommage à notre si belle langue.
© Hervé Gautier – Novembre 2018
Les chasseurs dans la neige J-Yves Laurichesse (HDougier)
Tout commence par un coup de cœur d'enfance de Jean-Yves Laurichesse pour un tableau, « Les chasseurs dans la neige » et pour son auteur, le peintre flamand Pieter Bruegel (1525-1569) , dit l'Ancien, par opposition à ses deux fils qui ont, eux aussi, suivi la voie de la peinture. Puis, bien des années plus tard, quand la vie s'est installée, il retrouve intacte cette fascination qui non seulement ne s'est pas altérée, s'est même affermie avec le temps et peut-être a donné pour soi-même l'envie de laisser une trace de son passage sur terre. 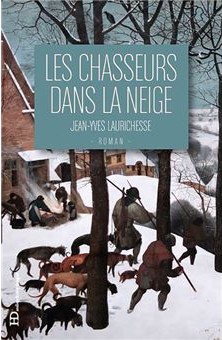
Naturellement il veut en savoir plus sur l’œuvre et sur l'auteur, sur sa vie et ses passions, alors, comme une sorte de témoin qui se joue du temps, il pénètre dans le tableau ou plus exactement se projette à l'époque de sa conception, inventant les phases et les circonstances de sa création, les rencontres que le peintre aurait pu faire. Il y a ce que la toile représente, une scène figée dans la neige, mais surtout ce que le spectateur ordinaire ne peut voir, et, par l'extraordinaire puissance de l'imagination humaine, Bruegel, par le truchement de Laurichesse, révèle sa présence virtuelle qui peu à peu devient bien réelle.
C'est un homme de quarante ans, un peintre venu de Brussel en cette année 1565 pour croquer une fête de village flamand en hiver, une commande d'un riche client d'Anvers sur le thème des mois de l'année. Dans ce village, il a parlé et même dansé avec Maeke, puis a disparu, laissant à la jeune fille un souvenir ému. Plus tard il est revenu pour affiner ses croquis, noter des détails qui, dans sa toile à venir prendront une grande importance. Il se dit que peindre ainsi des scènes authentiques est bien mieux que d'évoquer des événements historiques ou bibliques comme il l'a déjà fait et préfère la compagnie de gens simples à celle des bourgeois riches, et peut-être aussi celle de Maeke, cette jeune brodeuse réservée et travailleuse de ce village perdu.
Même si ses tableaux sont célèbres dans le monde entier, on sait peu de choses de la vie de Bruegel. C'est sans doute pour cela que Jean-Yves Laurichesse lui prête une parcelle d'existence parmi ces gens qu'il découvre. Les relations qu'il a avec Maeke sont empreintes de respect, de retenue, d'admiration réciproque. La jeune fille apparaît comme une sorte d'inspiratrice, un prétexte à la création de cette œuvre où pourtant elle ne figure pas.
C'est une révélation réciproque puisque, à l'occasion de ce tableau, la jeune fille prend soudain conscience de la beauté des lieux représentés par le peintre ; ils faisaient à ce point partie de son quotidien qu'elle ne les appréciait même plus. Il évoque Pieter, malgré des apparences bourgeoises, comme un homme bienveillant et bon, attentif à ces paysans qu'il ne connaît pas et aussi à l'avenir de la jeune fille,
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien voulu croire à cette tranche de vie, vue à travers ce tableau qui s'est lentement composé dans sa tête avant de prendre forme sur la toile. J'ai, bien sûr, cru aux difficultés de composition, aux failles de la mémoire, à l'impossibilité toujours possible de faire partager, à travers les formes et les couleurs, l'émotion intime du créateur qui prend sans doute plaisir à imaginer, à propos d'un petit détail d'une toile, les interrogations du spectateur quelques siècles plus tard. J'ai aimé aussi cette phase de doute qui étreint l'artiste avant qu'il décrète son œuvre terminée au point que cela nécessite un œil extérieur, et avec lui la crainte de la critique ou de l'indifférence.
C'est aussi une évocation peu flatteuse de la nature humaine, capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, avec son cortège d'hypocrisies, de médisances, de bassesses, et cette jeune fille pure en fait l'expérience bien malgré elle. Cela peut paraître un roman mièvre dans son déroulement et dans son épilogue, quand une certaine forme de littérature nous a habitués à la violence et aux excès, mais il n'en est rien et je suis entré de plain-pied dans cette fiction.
J'ai rencontré l'œuvre de Jean-Yves Laurichesse par hasard et des bons moments de lecture aux accents poétiques que cette rencontre a suscités. Je me suis laissé entraîné dans cette démarche créatrice à l'occasion de ce roman, parce que, il y a de cela bien longtemps, un pareil émerveillement à propos d'un autre peintre, s'était emparé de moi et j'ai apprécié cette manière qu'a notre auteur d'inviter son lecteur à partager son émotion ; il le fait avec de courts chapitres à l'écriture fluide comme les touches d'un pinceau posé sur la toile et l'ambiance qui en résulte est paisible comme l'est ce paysage d'hiver. La poésie que j'ai tant appréciée lors de mes lectures précédentes était également au rendez-vous.
© Hervé Gautier – Septembre 2018
Dora Bruder Patrick Modiano (Gallimard)
Tout commence par un entrefilet paru dans un numéro de Paris-Soir le 31 décembre 1941, retrouvé par hasard par l'auteur en décembre 1988. Il s'agit de la disparition d'une jeune fille parisienne de 15 ans, Dora Bruder. L'auteur décide donc d'enquêter sur cette jeune fille qui n'a aucune parenté avec lui. Il réunit donc tous les éléments de la vie de cette jeune fille, une juive que ses parents n'ont pas déclarée en tant que telle, qui ne porte donc pas l'étoile jaune et qui est scolarisée dans une institution catholique de Paris. En recherchant sa trace, il retrouve nombre de documents d'archive administratifs et policiers la concernant pour la période 1941-1942.
Les origines personnelles de Modiano ainsi que son travail sur la mémoire motivent sans doute ses recherches et il ne peut s'empêcher de faire allusion à des passages de sa propre existence et de celle de son père et ainsi de s'identifier à Dora. Bien que la période et les circonstances soient différentes, que les lieux aient changé, il met en perspective, dans une sorte de va et vient, les quelques bribes connues de la biographie de la jeune fille avec sa propre vie. Ainsi inscrit-il son parcours dans différentes rues et quartiers de Paris qu'il parcourt à pied et qui lui sont familiers. Dora fit de nombreuses fugues dont nous ne savons ni les raisons ni la durée puis réintégra le domicile de ses parents et ces différentes escapades lui rappelèrent celle qu'il fit lui-même pour échapper au pensionnat. Il s'agit donc d'un récit biographique où il mêle des éléments autobiographiques, deux adolescences tourmentées, torturées.
D'elle on ne sait que peu de choses, un caractère rebelle et indépendant, des absences, des adresses d'hôtels minables, une existence dure et ponctuée de rituels religieux dans une institution catholique qui, par charité, recevait des juives pour qu'elles échappent à la mort. De même on sait peu de choses de ses parents d'origine étrangère qui ne furent guère aidés par un pays dont on dit qu'il protège les droits de l'homme et que le père de Dora servit comme soldat dans la légion étrangère, ce qui ne lui valut cependant pas la nationalité française. Ses investigations, qui font apparaître cependant de nombreuses zones d'ombre, des interrogations non élucidées, des hypothèses dont les différents romans de Modiano sont coutumiers, révèlent que Dora a été incarcérée à la prison des Tourelles, puis à Drancy pour finalement être internée à Auschwitz en septembre 1942. A des périodes différentes, son père et sa mère périront comme elle dans ce camp.
Ce récit n'est pas un roman mais un travail de mémoire, une enquête où, sans délaisser sa traditionnelle et douce musique des mots, l'auteur s'approprie par moments un style plus administratif et neutre. Il met d'ailleurs de côté son imagination pour n'être finalement que le chroniqueur de cette histoire. Cette sobriété est sans doute destinée à appuyer sur les silences qui peuplent la vie de Dora. Modiano n'a guère été aidé dans ses recherches puisque les archives qui retraçaient la collaboration de la police et de la gendarmerie françaises avec l'occupant allemand ont été brûlées, sans doute pour faire disparaître cette page sombre et honteuse de notre histoire. Les traces qui subsistent sont ténues, des lettres désespérées de gens qui s'inquiètent de la disparition d'un proche ou sollicitent une libération. Encore nous épargne-t-il toutes les missives sordides qui dénonçaient un voisin ou un proche pour des motifs inavouables et qui faisaient elles aussi partie de cette période autant qu'elles révélaient la vraie nature de l'espèce humaine.
L'auteur confesse d'ailleurs qu'il était tellement obsédé par la disparition de Dora qu'il fit précéder le présent ouvrage qu'il lui dédie par un autre roman, « Voyage de noces » (La Feuille Volante n° 1126) où les ressemblances entre les deux œuvres sont patentes. Il avoue lui-même « En décembre 1988, après avoir lu l'avis de recherche de Dora Bruder dans « Paris-Soir »… , je n'ai jamais cessé d'y penser durant des mois et des mois...Il me semblait que je ne parviendraisjamais à retrouver la moindre trace de Dora Bruder. Alors, le manque que j'éprouvais m'a poussé à l'écriture d'un roman « Voyages de Noces », un moyen comme un autre pour continuer à concentrer mon attention sur Dora Bruder ». Pourtant la jeune fille est bizarrement absente de ce récit, comme étrangère à sa courte vie et cet effet est sans doute destiné à souligner le peu de traces qu'elle a laissées, tout comme d'ailleurs tous ceux et celles qui disparurent à cette époque pour la seule raison qu'ils étaient juifs. D'ailleurs, certains de leurs noms apparaissent furtivement dans ce récit. Pour autant ce livre qui désormais fait partie de la bibliographie de l'auteur nobélisé a suscité une telle émotion que le XVIII° arrondissement de Paris, et donc la mémoire collective, conservent le souvenir de cette jeune fille depuis juin 2015, sous la forme de la « Promenade Dora Bruder ».
On voit ainsi que Modiano qui est toujours l'explorateur de ses propres souvenirs, mêle ici la nostalgie à l'horreur et se montre hanté par la Shoa autant que par l'oubli qui accompagne la disparition des légions d'anonymes fauchés par la guerre et la déportation et qui ne laissent pas de traces de leur passage sur terre, tant il est vrai qu'un mort ne l'est jamais autant que lorsque les vivants ne pensent plus à lui , l'amnésie faisant partie de notre condition.
Cette petite annonce imprimée sur un journal du soir a donc un prolongement, des années après, dans un document qui vient enrichir la littérature française.
Personnellement j'y vois la force extraordinaire de l'écriture qui, paradoxalement s'inscrit d'abord sur un fragile support de papier pour ensuite nourrir notre mémoire commune Ainsi on ne peut pas ne pas penser au journal d'Anne Franck dont ce livre est en quelque sorte l'écho.
© Hervé GAUTIER – Juillet 2018
Un homme - Philip Roth (Gallimard)
L'histoire commence dans un petit cimetière juif un peu délabré où un homme va être enterré. Cette petite cérémonie réunit sa fille, née d'un second mariage qui l'adore et qui prononce quelques mots sur sa tombe, mais aussi deux fils, nés d'une première union houleuse, qui le méprisent parce qu'il a abandonné leur mère, son frère aîné, une infirmière qui s'était occupé de lui avant son décès et quelques collègues... Cet enterrement n'a cependant rien d'exceptionnel, juste quelques poignées de terre jetées sur le cercueil, quelques paroles puisées dans le chagrin et le souvenir mais aussi des marques d'indifférence, de soulagement, de rancœur même...
Par une classique analepse, l'auteur va retracer la vie de cet homme, dont nous ne connaîtrons pas le nom. Enfant de santé fragile, il avait été l'objet des soins attentifs de ses parents. Il est devenu un homme torturé par des affections cardio-vasculaires mais il envie et même déteste ce frère aîné, à cause de sa bonne santé... Il ne reprit pas la profession de son père, bijoutier juif, mais devint un publicitaire célèbre puis s'est mis à la peinture pendant ces années de retraite. Ses trois mariages se soldèrent par autant de divorces entrecoupés de quelques liaisons amoureuses...
C'est une vie banale qui nous est ainsi livrée par le narrateur comme s'il nous prenait à témoin, celle d'un homme ordinaire, pleine de poncifs, de désillusions, de frustrations, avec son lot de joies, d'épreuves, d'amours et de rêves brisés, d'erreurs, de prises de conscience que les choses changent, que le temps perdu ne se rattrape pas... Lui qui fut un amant ardent, il connaît maintenant la perte du désir, l'impossibilité de séduire..., Roth reprend devant nous, à l'occasion de cette histoire, tous les truismes habituels loin des préoccupations intellectuelles et philosophiques, avec la hantise ordinaire à tout humain, celle de la vieillesse, de la solitude, de la mort. Cet homme n'attend rien d'un hypothétique autre monde ou d'une vie éternelle, les choses s'arrêtent avec celle-ci, et tant pis si toute cette agitation n'a servi à rien et ne débouche que sur le néant.
Sa vie n'aura donc été qu'un vaste gâchis qu'il a lui-même tressé, remettant en cause ce qu'il avait pourtant patiemment construit. Dans notre société, il est sûrement une sorte de parangon, lui dont la réussite professionnelle a été avérée, dont la vie familiale a été un savant mélange d'adultères, de mensonges, d'hypocrisies et de complicités malsaines et même coupables, d'humiliations imposées aux siens, comme si son existence ne se résumait qu'à une recherche effrénée de la jouissance sexuelle, du plaisir animal à tout prix, dût-il lui sacrifier la stabilité de sa famille, sa respectabilité, la vie et l'amour de ses enfants... Après tout, il doit être comme un homme, cet être qui est en permanence habité par la folie de tout détruire autour de lui pour un peu de ce plaisir quêté dans une rencontre avec une inconnue!
Face à ces renoncements successifs, il lui reste la peinture que pratique comme une sorte d'exorcisme ce Don Juan insatiable, toujours à la recherche de femmes qui lui procureront du plaisir, mais qui, à présent, ne peut plus que les suivre du regard en fantasmant sur leur corps, en espérant qu'elles lui feront l'aumône d'une étreinte. Quant au maniement du pinceau, cet exercice artistique devient lassant et il n'en retire plus rien...
C'est un récit un peu mélancolique, un rien désabusé, un peu tragique aussi si on estime que vivre de la naissance à la mort en acceptant de n'être plus ce qu'on a été, est aussi participer à une sorte de tragédie. C'est assurément dramatique aussi d'accepter sans peur la réalité de la mort, cet inévitable saut dans le néant, parce que, quand on a goûté à la vie, on ne peut la quitter sans regret ni terreur.
Le titre anglais (evryman : n'importe quel homme) résume assez bien le but de l'auteur; il s'agit de la vie de chacun d'entre nous qui est esquissée ici. Ce n'est donc pas exactement une fiction, mais la copie plus ou moins conforme dans sa diversité du parcours de chacun d'entre nous sur cette terre.
Le style est dépouillé et atteint son but, celui de nous donner à voir « cet homme » sans nom, (et cela doit aussi valoir pour les femmes ?), un véritable quidam, un être ordinaire dont on nous raconte la vie également ordinaire, celui de nous faire partager, avec cet art consommé du conteur, son passage sur terre plein de fougue mais finalement aussi plein de désillusions et de bassesses.
Une véritable image de la condition humaine !
Hervé GAUTIER -Juin 2018
W ou le souvenir d'enfance Georges Perec (Denoël-1975)
D'emblée, ce récit a quelque chose de déconcertant. Il se présente sous la forme de deux textes, l'un autobiographique et l'autre fictif. L'effet recherché est sans doute celui du miroir né de l’alternance ou d'un enchevêtrement complémentaire entre les deux, un peu comme si ce qui n'était pas dit dans l'un (ou que l'auteur ne pouvait écrire de sa propre biographie) l'était dans l'autre, avec cependant une certaine pudeur et aussi une certaine volonté d'expliquer les choses comme l'indique l'exergue de Raymond Queneau [« Cette brume insensée où s'agitent des ombres, comment pourrais-je l'éclaircir ? »].
Assez bizarrement, quand il débute l'autobiographie, Perec écrit « Je n'ai pas de souvenirs d'enfance ». Il va pourtant, à travers les réminiscences nées de quelques photos jaunies et quelques bribes de mémoire, nous décrire ce qu'elle a été. Il naît le 7 mars 1936 à Paris et ses parents sont des juifs polonais immigrés (Peretz) dont le père, qu'il n'a pratiquement pas connu, meurt sous l'uniforme au début de la guerre en 1940. Pour le sauver, sa mère l'envoie avec la Croix-Rouge à Villars de Lans en zone libre où il est baptisé de son nom francisé (Perec). Il est ballotté de familles en établissements et de cela il ne garde que peu de souvenirs. Il ne reverra plus sa mère puisqu’elle meurt à Auschwitz. Le thème de la disparition de ses proches hantera donc ce récit et avec lui la douleur de leur absence. « W » est une histoire de son enfance « la vie exclusivement préoccupée par le sport sur un îlot de la Terre de Feu »,une sorte de société qui vit selon les valeurs olympiques. Quand il évoque son enfance, brisée par l'absence de ses parents, cette dernière est symbolisée par la lettre « E » à qui est dédié ce livre [on se souvient que Perec a écrit aussi un autre roman, « La disparition », d'où cette lettre est complètement absente et qui apparaît deux fois dans son nom pourtant court. Cette disparition de ses parents est ressentie par lui comme une suprême injustice.
La fiction est présentée sous forme d'enquête policière (le W apparaît sous la forme d'un nom de la ville où le narrateur, Gaspard Winckler, se rend au début, et qui est aussi le nom d'un autre homme qui a disparu) et qui se poursuit par une autre histoire qui se déroule dans une île, « W » (située au bout du monde). Ce territoire comporte quatre villages, sorte de phalanstères organisés, hiérarchisés qui abritent une société pratiquant les valeurs olympiques du sport, une sorte d'idéal avec des rituels compliqués, très codifiés et parfois même inattendus voire surréalistes pour les « Athlètes », autant dire une certaine notion du bonheur inexistante dans son enfance, peut-être aussi un modèle éducatif dont l'absence de ses parents l'a privé. Je note que dans cette collectivité, peut-être utopique, il semble exister des liens internes assez forts que Perec n'a pas connus dans son enfance, tiraillé qu'il a été entre différents membres de sa parentèle.
Petit à petit, l'auteur pourtant dévoile ces ombres comme on soulève une couverture qui recouvre quelque chose. Il le fait comme à son habitude, à coup de références personnelles (Bartleby, Moby Dick de Herman Melville, la fuite, la vengeance, le bien et le mal) et d'un détail à mes yeux significatif. W est « le » souvenir d'enfance alors qu'on pourrait s'attendre à voir ce nom au pluriel. Perec se livre à une démonstration un peu forcée à partir de cette lettre qui, manipulée physiquement devient un X, symbole de l'inconnu mathématique et judiciaire, signe aussi de l'ablation, mais également une croix de Saint André, symbole de mort. Si on la double, c'est le signe qui apparaît sur la casquette de Charlie Chaplin dans le film « le dictateur », si on en prolonge les segments, elle devient une « croix gammée » et, redessiné, ce « W » originel se transforme en une étoile de David. Cette lettre est donc omniprésente et devient la marque indélébile de cette enfance assassinée. D'ailleurs tout au long de l'autobiographie, Perec fait allusion aux Allemands, à la guerre, à la peur d'être lui aussi l'objet d'un emprisonnement et d'une déportation. Il fait une discrète allusion aux camps qu'il découvre mais seulement à la fin du récit, note un parallèle étonnant entre les camps de concentration et la vie sur l'île W et remarque enfin que la dictature de Pinochet a installé des camps de déportation dans les îles de la Terre de Feu. Il avait d'ailleurs, au cours du récit consacré à la vie sur W, insisté sur la cruauté et l'humiliation voire l'inhumanité de certaines scènes.
Ces digressions ne sont pas destinées à égarer le lecteur mais bien au contraire à lui tenir la main dans ce récit volontairement labyrinthique. Il y a quelque chose de révélateur dans cette technique où s'entremêlent la fiction et la réalité, la construction et la déconstruction, la mémoire et l'imaginaire. Personnellement j'y vois une tentative de traduire une douleur ressentie par l'écrivain qu'il tente d'exprimer sans pour autant pouvoir y parvenir laissant son lecteur face au « non-dit ». Cela me rappelle les derniers mots écrits de Romain Gary avant son suicide « Je me suis enfin exprimé complètement ».
Ce livre n'est pas un roman au sens classique, il veut nous livrer un message bien plus important que ce qu'une fiction ordinaire est censée exprimer, à la fois texte intime et pathétique, acte volontaire pour que l'oubli qui fait tant partie de notre vie ne recouvre pas trop vite celle des autres que nous avons aimés et qui nous ont quittés [« J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps auprès de leurs corps ; j'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture ; l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie »] . C'est ici son rôle rendu à l'écriture comme acte de la mémoire mais aussi l'occasion unique pour celui qui tient le stylo de construire, à travers les souvenirs intimes de son enfance rien d'autre que sa propre vie ; autant dire une véritable thérapie ! Léon-Paul Fargue exprime cela quelque part avec une grande économie de mots : « On ne guérit jamais de son enfance ».
J'avoue que cette lecture m'a laissé à la fois dubitatif et surtout bouleversé, comme si Perec, une nouvelle fois et au-delà des mots, m'invitait à comprendre autre chose qu'une simple histoire. Je suis peut-être passé à côté du message mais j'ai éprouvé le besoin de formaliser ici, et sans aucune prétention, mon sentiment de simple lecteur.
©Hervé GAUTIER – Mai 2018
L'ordre du jour - Eric Vuillard (Actes sud) Prix Goncourt 2
Nous sommes le 20 février 1933 et Allemagne nazie s'apprêtent à recevoir l'hommage, sous forme de millions de deutschemarks, des industriels allemands, Krupp, Opel, Siemens, Bayer... vingt quatre capitaines d'industries qui plus tard puiseront dans les camps de concentration la main- d’œuvre nécessaire à leur essor. L'argent est le nerf de la guerre, comme on le sait et la guerre, les nazis ne demandent qu'à la faire, elle assurera la fortune de ces généreux donateurs !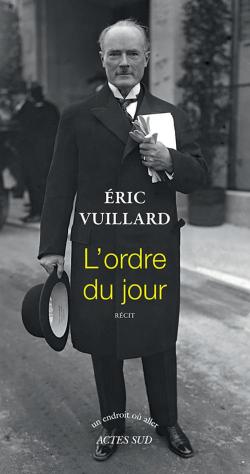
Dans ce court récit, Eric Vuillard se fait l'historien de cette période qui va de 1933 à 1938 au terme de laquelle sera enfin réalisé le rêve d'Hitler, d'unifier sous son autorité les pays de langue allemande, l'Allemagne et l'Autriche et tant pis si, pour en arriver là, on bouscule un peu le droit, la diplomatie, le respect des frontières et même les gouvernants puisque le chancelier autrichien Schuschnigg est remplacé manu militari par le nazi Seyss-Inquart. Pourquoi se gênerait-il, le caporal autrichien devenu chancelier d'Allemagne, puisque la France et l'Angleterre semblent se désintéresser de tout cela ? D'ailleurs, plus tard, lors d'un dîner au 10 Downing Street, l'ambassadeur Ribbentrop qui allait devenir ministre du Reich, amusa Churchill, Chamberlain et Lord Catogan avec ses exploits sportifs pour mieux masquer cette information et retarder la réponse britannique à l'invasion de l'Autriche. C'était le début d'un processus qui se terminerait en septembre 1938 par les accords de Munich, l'annexion des Sudètes tchécoslovaques et la Deuxième Guerre Mondiale. Le plus étonnant sans doute fut que les Autrichiens accueillirent les envahisseurs nazis dans la liesse, à grands renforts de saluts fascistes et à leur tête Hitler, même si tout ne s'est pas aussi bien passé que prévu. Après tout, le dictateur était un enfant du pays qui revenait chez lui ! Quant à l'allégresse qui a accompagné cette entrée du Führer, il ne faut tout de même pas exagérer, on avait avant bien préparé le terrain et l'ombre des SA s'étendait déjà depuis quelques temps sur le pays, quant à l'appui des panzers prévu pour accompagner ce qui est une véritable prise de pouvoir, c'est plutôt à une panne mécanique générale à laquelle on a assisté. On nous a montré des films de propagande des images sélectionnées comme toujours pour faire illusion, mais quand même !
L'auteur nous donne des détails par forcément retenus par l'Histoire, insiste sur le bluff qui a présidé à tout cela et l'incroyable crédulité du monde qui, à ce moment-là, a plié devant l'ahurissant culot d'Hitler, un peu comme si le conflit qui s'annonçait devenait inévitable. Il l'évoque d'ailleurs à propos « Les plus grandes catastrophes s'annoncent souvent à petits pas ». Cela rappelle l'invasion de la Rhénanie, pourtant démilitarisée par Hitler en mars 1936, un véritable coup de poker qui, s'il avait été contré par la France comme cela eût été logique aurait sans doute changé le cours de l'histoire. Devant l'apathie générale, le Führer avait décidé d'agir parce que c'était pour lui le moment favorable à ses visées destructrices, une occasion de plus de bafouer le traité de Versailles et de s'imposer face aux atermoiements franco-britanniques. Cela a si bien fonctionné que Daladier et Chamberlain ont été acclamés à leur retour de Munich comme les sauveurs de la paix !
Hitler n'a cessé de délivrer un discours pacifique alors qu'il préparait et développait la guerre, n'a cessé d'affirmer aux Allemands eux-mêmes l'état impeccable de l'armée alors qu'il n'en était rien, a délivré contre les Juifs un discours de haine et de mort. Cela a si bien fonctionné que l'Église catholique s'en est mêlée, les curés appelant en chaire à voter pour le parti nazi lors du référendum en faveur de l'Anschluss, parant les églises de drapeaux à croix gammées. Le résultat fut sans appel, un véritable score digne d'une république bananière... et des suicides massifs de Juifs. Cela annonçait sans doute la connivence et le silence assourdissant du pape Pie XII face à la Shoah, un peuple toujours considéré à l'époque comme déicide.
J'ai rencontré l’œuvre d'Eric Vuillard par hasard et même si le thème traité rappelle un moment peu glorieux de l'histoire de l'humanité, c'est écrit avec conviction et talent et cela procède aussi du devoir de mémoire.
© Hervé GAUTIER – Mai 2018
Les chaussures italiennes Henning Mankell (ed. Seuil)
Traduit du suédois par Anna Gibson.
En prenant ce roman sur les rayonnages d'une bibliothèque, je pensais entrer encore une fois dans l'atmosphère du roman policier dont Mankel est le créateur. J'ai toujours apprécié l'ambiance créée par lui, le personnage de Kurt Wallander, policier humain et désabusé, le dépaysement de ces ouvrages... Cette chronique s'en est souvent fait l'écho. Rien à voir cependant avec une enquête policière cette fois, mais je n'ai pas regretté.
En deux mots, cette histoire évoque un chirurgien suédois de soixante-six ans, Fredrik, venu s'exiler sur une île de la Baltique parce que culpabilisé par une erreur médicale, une amputation inutile, faite par erreur douze ans plus tôt et qui a mis fin à une carrière qui aurait été brillante. Il y vit seul, dans une vielle maison de pêcheur qui a appartenu à ses grands-parents, en compagnie de deux vieux animaux, une chienne et une chatte et… une fourmilière envahissante ! Son activité se résume à faire des trous dans la glace pour s'y baigner et à tenir le journal d'une vie qui a tourné court et qui finit par être une chronique de la météo du jour et de simples annotations brèves, presque incompréhensibles. Il n'a pour tout contact avec le monde extérieur que la visite de Jason, un facteur hypocondriaque et curieux qui le prend pour son médecin traitant. Autant dire qu'il attend la mort. Tout au long de ce récit Fredrik écrira et recevra des lettres, seul vrai moyen qu'il a choisi, même à l'époque du téléphone portable, pour correspondre avec ses semblables.
Malgré son retrait du monde, vient à lui Harriet, une femme qu'il a jadis aimée puis abandonnée, mais qui ne l'a jamais oublié. Elle est vieille et malade d'un cancer et ils vont faire ensemble un dernier voyage, parce qu'elle exige qu'il tienne une vielle promesse. Son obéissance servile ressemble un peu à un chemin de Canossa et est à la mesure du remords qu'il éprouve et du pardon qu'il espère. Lui qui n'a jamais eu d'enfant, apprend qu'il est le père de Louise, une femme maintenant adulte, pour qui il ne peut avoir les sentiments que l'on ressent face à un enfant, et qui est la fille d'Harriet. Ce fait va bouleverser sa vie et ses projets. Ce n'est cependant pas la seule femme qui va débouler dans sa vie et la bouleverser mais la coïncidence n'est pour rien dans la rencontre qu'il fait d'Agnès, la femme qu'il avait amputée par erreur d'un bras et aussi ruiné sa carrière de nageuse de haut niveau. D'elle aussi il attend un pardon.
Il y a beaucoup de décès (humains et animaux) tout au long de cette histoire, la camarde qui rôde autour de lui parce que la mort est la seule chose qui en ce monde est certaine, mais aussi de solitude, d'abandon de regrets et de remords. La mort, il nous est simplement possible d'y faire échec avec des rituels et la permanence de la mémoire, encore est-elle limitée à la durée de notre propre vie. Pourtant, à son âge et dans son état d'isolement Fredrik pensait qu'il était enfin en règle avec sa vie et qu'il pouvait oublier toutes ses trahisons, comme si le temps était capable de tout abolir, de tout réguler, mais ce sont des femmes qui vont se charger de rafraîchir sa mémoire et surtout de raviver sa culpabilité.
Il est donc question de pardon qu'il obtiendra peut-être avant de mourir à son tour. Ce ne sera pas simple, à l'aune sans doute de ses mensonges et de ses oublis. Il sera accordé, simplement parce qu'il le demande, avec sincérité et repentance, par celles à qui il a porté préjudice. Nous faisons en effet du mal par action mais aussi par omission, sans pour autant le vouloir effectivement. Tout cela prendra du temps et la ronde des saisons, avec son alternance de canicule et de glace, est là pour souligner ce long cheminement, avec le temps fort des solstices. Il pourra mourir sereinement, assuré de s'être racheté.
Je ne m'attendais pas à ce genre de roman mais je l'ai trouvé tout à la fois passionnant et émouvant, fort bien écrit et agréable à lire.
© Hervé GAUTIER – Avril 2018
Les belles endormies Yasunari Kawabata (A Michel)
Traduit du japonais par René Sieffert – Illustrations et photos Frédéric Clément.
L'immeuble dans lequel pénètre le vieil Eguchi est une sorte d'auberge où tout est silencieux sauf le bruit des vagues qu'on entend dans le lointain. Les règles qui la gouverne sont étranges et pour éviter des dérives, il convient de ne pas y déroger. De vieux messieurs y viennent pour dormir aux côtés de jeunes filles nues, elles-mêmes endormies grâce à la drogue de sorte qu'elles restent inconscientes toute la nuit, ne seront réveillées qu'après le départ de leur client et ne sauront donc jamais avec qui elles ont passé la nuit. Il ne s'agit pour autant pas d'un vulgaire lupanar puisque le vieillard doit impérativement dormir auprès de la jeune fille en la respectant.
Eguchi viendra plusieurs fois dans cette maison, se risquera même à enfreindre légèrement les règles non écrites au risque de se voir refuser l'accès à cet établissement, envoûté et tenté qu'il est par la beauté de corps de la jeune fille mais, n'étant plus capable « de se comporter en homme », il devra se contenter de la regarder, de l'effleurer toute en respectant son sommeil. C'est une situation un peu ambiguë que celle-ci puisque la jeune fille reste provocante par sa nudité, sa virginité, l'odeur de sa peau, elle bouge voire parle un peu à l'invite d'Eguchi et l'interdit qui s'impose à lui lors de ces séances nocturnes réveille ses regrets de jeunesse et accentue son actuelle décrépitude. Pour autant la règle de cette maison veut qu'il s'endorme à son tour et qu'il se réveille avant la jeune fille et parte.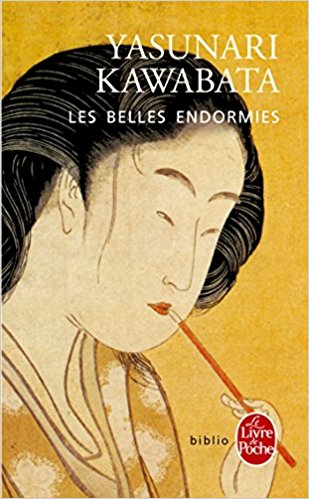
Les partenaires qui sont dévolues à Eguchi sont de très jeunes filles d'une beauté sensuelle mais lui-même n'est plus capable « de se comporter en homme » en face d'une femme, aussi les effleure-t-il des yeux et des doigts en ayant soin de respecter leur sommeil.
Pourtant, les sensations visuelles et olfactives qu'il ressent réveillent chez lui des souvenirs amoureux qu'il croyait définitivement enfuis de sa mémoire, mais aussi un sentiment de honte et de gêne. Il avait croisé beaucoup de femmes dans sa vie, qu'elles aient été conquêtes d'un soir ou prostituées mais il gardait d'elles l'image indélébile de leur beauté, de leur sensualité qui se réveillaient à cette occasion, avant de sombrer lui aussi dans un sommeil artificiel chargé de songes et parfois de fantômes. Ses nuits ont cependant été chastes ainsi qu'il convient dans cette maison mais ses souvenirs autant que ses séances nocturnes lui donnent l'intuition de la solitude d'autant plus grande qu'il ressent, comme chacun de ces hommes âgés qui se retrouvent ici, l'impossibilité de rendre à une femme le plaisir qu'elle donne dans l'étreinte.
Pire peut-être cette impression de déréliction est exacerbée par le fait qu'ils ressentent du désir pour une jeune et jolie fille qui doit rester assoupie et qu'ils doivent dormir à ses côtés sans pouvoir assouvir leur libido et ce d'autant plus qu'ils ont dû être jadis des amants fougueux. Ils sont le plus souvent veufs ou célibataires, c'est à dire à cause de leur âge délaissés par les femmes et abandonnés à eux-mêmes. Ainsi Eguchi a la certitude que pour lui une page est définitivement tournée, qu'il arrive au terme de quelque chose et qu'il se pourrait bien qu'il dorme ici « d'un sommeil de mort ».
Cela l’obsède au point de devenir un tourment, sans doute parce que le sommeil est effectivement l'antichambre de la mort et que, dans son cas comme dans celui de ses autres confrères, le trépas qui est l'inévitable issue de sa vie, peut être rendu plus doux par l'ultime partage d'une nuit, même chaste, aux côtés d'un femme sensuelle. Ainsi la pulsion qu'il ressent se transforme-t-elle en dégoût d'une vie finissante, en ce mal-être que prête la fuite du temps, en une réflexion amère sur la vieillesse, en une indignation face à la camarde qui frappe au hasard.
C'est un texte intensément érotique, tout en retenue où l'auteur souligne à l'envi les traits fins d'un visage, la blancheur d'une peau, l'odeur fascinante d'un corps nu, la pulpe des lèvres, la fluidité d'une chevelure, la rondeur d'un sein, le galbe d'une hanche, la finesse d'une attache, mais à travers l'incontestable charge sensuelle et poétique du texte, j' ai surtout lu une ode au corps des femmes, un hymne à leur beauté. C'est un texte somptueux illustré de photos et dessins non moins évocateurs de Frédéric Clément.
J'ai rencontré Kawabata par hasard et la première impression m'avait surpris. Je dois dire que j'ai été conquis par cette deuxième approche.
© Hervé GAUTIER – Mars 2018
Giboulées de soleil - Lenka Hornnakova-Civade (Alma Éditeur)
Ce roman est partagé en trois livres, consacrés à trois femmes, Magdalena, Libuše, et Eva, qui se transmettent de mère en fille l'art de la broderie mais surtout le fait d'être nées de père inconnu, que leur géniteur soit un fils de patron, un soldat ou un ivrogne violent. Elles sont toutes des enfants de l'amour mais surtout des bâtardes et se transmettent cet absence de père comme une charge, une interrogation, un peu comme si un destin briseur de rêves la leur imposait. Elles l'acceptent comme une fatalité mais avec détermination cependant et chacune d'elle souhaite ardemment que son enfant puisse exercer son choix et qu'on ne lui impose pas celui des autres. 
Pourtant tout commence avec Marie, la mère de Magdalena, à Vienne où elle était l'assistante et la maîtresse d'un gynécologue juif qui l'abandonne alors qu'il fuit avec sa famille face aux premières menaces nazies. Marie s'était réfugiée à la campagne avec sa fille, comme serveuse dans une auberge et accoucheuse à l'occasion.
Puis naît Magdalena qui rêvait d'épouser Josef mais doit se contenter d'un boiteux violent dont aucune femme ne veut parce qu'une bâtarde ne peut pas choisir.
Libuše rêvait de Paris comme d'une destination lointaine et inaccessible. Eva enfin, très originale et exubérante, pertinente et impertinente, curieuse de tout et avide de liberté. C'est grâce à elle que les mensonges, les secrets et les non-dits de cette famille éclatent enfin. C'est avec elle aussi que s’interrompt cette malédiction.
Ces quatre femmes auront bien sûr des frères et des sœurs, seront mariées, mais pas avec le père de leur première fille. Ce mariage arrangé fera d'elles des victimes et le bonheur sera absent de cette union mais elles garderont le secret d'un amour impossible. La broderie, legs commun, sera pour elles une forme de liberté, d'évasion, de voyages impossibles, surtout pour Libuše. Leurs vies personnelles d'errance croiseront la grande histoire, celle de la Tchécoslovaquie bousculée par les événements politiques depuis l'empire austro-hongrois jusqu'à l'instauration et la fin du communisme, dont l'utopie, les mensonges et les erreurs sont omniprésents dans ce roman, en passant par l'occupation nazie. Seule Eva, l'arrière petite-fille de Marie connaîtra Paris, symbole de lumière et de liberté, réalisant ainsi le rêve de toute cette lignée de femmes. Parmi ces quatre récits, celui consacré à Eva est le plus pétillant, le plus ensoleillé.
Dans « l’autoportrait » qui suit ce roman, l’auteure confie qu'il y a un peu d'elle-même dans ce livre et il est difficile de ne pas voir son empreinte dans le personnage de cette dernière jeune fille.
C'est donc un roman personnel et émouvant, chargé de symboles aussi, celui de ces femmes fortes, déterminées mais pas résignées, dans une société marquée par la violence, la compromission et l'hypocrisie. L'auteure s'attache son lecteur par son style poétique, spontané, parfois puéril mais toujours fluide et agréable à lire. Elle est de nationalité tchèque mais a écrit ce premier roman directement en français ce qui est sa manière de se l'approprier pour exprimer, selon elle, plus facilement son message et la subtilité des sentiments.
Ce n'est pas si fréquent qu'un auteur exerce ce choix, j'y vois un hommage à la France où elle vit et à notre belle langue au point qu'elle considère que le texte ainsi écrit est l'édition originale de référence qu'elle traduit elle-même en tchèque.
Ce roman a été classé en 3ème position, par les lecteurs de notre association qui ont participé au Prix Cezam 2017.
© Hervé GAUTIER – Février 2018
Les étoiles s'éteignent à l'aube Richard Wagamese (Zoé)
Nous sommes à l'ouest du Canada, dans une nature sauvage. Franklin Starlight, tout juste âgé de seize ans, part avec sa jument à la rencontre de son père, Eldon, quelque part dans un endroit sordide, des retrouvailles au crépuscule de sa vie. 
Franklin a été élevé par un vieil homme qui lui a tout appris de cette vie sauvage, de cette vie patiente de chasseur, un étranger à qui Eldon l'a confié alors qu'il était enfant. Il n'a que rarement rencontré son père et n'a jamais connu sa mère. Rongé par l'alcool son père va bientôt mourir et veut que son fils l'enterre dans la montagne, comme un guerrier qu'il n'est cependant pas, c'est à dire d'une façon honorable ce qui, dans la tradition indienne lui permettra de connaître la paix dans l'au-delà.
Après bien des hésitations, Franklin qui ne sait rien de sa famille interroge son père qui lui révèle des secrets.
Eldon profite de ses derniers moments pour dire à son fils ce qu'il lui cachait depuis longtemps. Franklin presse le vieil homme de questions, notamment sur sa mère, ne le ménageant pas, discutant ses décisions d'alors, le jugeant gravement, un peu comme s'il voulait régler des comptes avec lui. En fait ce dernier voyage en compagnie d'un père qu'il ne connaît pratiquement pas a des accents de parcours initiatique pour le garçon. Il a une attitude contrastée avec le vieil homme, veillant à ce qu'il ne manque de rien mais aussi cherchant à en savoir un peu plus sur cet homme qui lui aussi veut se confier, lui dire ce qu'a été sa vie, son parcours vers l'alcool, ses regrets, ses remords, ses trahisons, ses douleurs intimes, ses obsessions. Cela prend des accents de confession ultime, une quête de pardon.
Les dialogues sont économes en mots, les descriptions empreintes de réalisme, de simplicité et de poésie. Elles imprègnent le lecteur parce que la nature est le véritable personnage de ce roman. Elle est tour à tour foisonnante, luxuriante, nourricière mais aussi hostile et dangereuse et Franklin a appris du vieil homme à en vivre et aussi à y survivre.
Au-delà de l'histoire, distillée avec de nombreux analepses, l'intrigue est bien construite et tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin sans que l'ennui ne s'insinue dans sa lecture. C'est un roman poignant et émouvant, riche en évocations qui révèlent ce que fut la vie d'Eldon, une succession d'échecs mais aussi de trahisons, comme s'il était marqué par un destin funeste dont il ne pouvait pas se défaire, avec au bout, la déchéance de l'alcool, la solitude, la peur de ne pas pouvoir effectuer ce dernier devoir.
Un des thèmes soulevés par ce récit est aussi le métissage, les deux hommes appartiennent à la tribu indienne ojibwé mais ce que je retiens c'est la quête du pardon et les hésitations d'Eldon pour en arriver là, l'amour pour une femme et l'impossible bonheur avec elle, le silence et le secret entretenus pendant toutes ces années autour de la naissance de Franklin.
Il y a autour de ce roman une sorte de mystère à l'image des peintures rupestres que le jeune homme croise en emmenant son père pour son dernier voyage, mystère de l'origine du garçon, de son abandon par son père, de la volonté de ce dernier de s'autodétruire face à sa mauvaise étoile, puis de retrouver in extremis son enfant et lui confier le soin de sa sépulture.
© Hervé GAUTIER – Février 2018
Traduit de l’anglais par Christine Raget.
Ce roman a été classé en 2ème position par les jurés de notre association qui ont participé au Prix Cezam 2017.
La symphonie du hasard (1) Douglas Kennedy Belfond
Traduit de l'américain par Chloé Royer.
Quand j'ai reçu cet ouvrage de la part de Babelio et des éditions Belfond que je remercie, je me suis dit que le titre ne pouvait que me parler. J'ai en effet toujours affirmé que le hasard gouverne nos vies bien plus souvent que nous ne voulons bien l'admettre. Il nous fait naître dans un milieu donné, il provoque la rencontre de gens qui favorisent ou non notre avenir, il s'invite dans notre quotidien et la mort interrompt notre vie au moment et dans des circonstances qui bien souvent nous échappent. Ici, c'est une famille américaine des années 70, les Burns, qui sert de fil conducteur à cette saga. Les voies de la génétiques sont comme celles du Seigneur, impénétrables. Ainsi, une même ascendance a-t-elle engendré trois enfants différents, Peter, sérieux et puritain, Alice, éditrice new-yorkaise, et Adam, ex-jeune loup de Wall Street, qui lui est actuellement en prison. Est-ce l'univers carcéral ou les révélations divines toujours miraculeusement présentes dans les prisons américaines, lors des visites hebdomadaires d'Alice, Adam va faire à sa sœur des révélations familiales qui vont accréditer cette affirmation « chaque famille est une société secrète ». Du coup Alice va y aller de ses confidences et c'est son parcours à elle que le lecteur va suivre, sur son enfance, sur son adolescence, sur le début de son cursus universitaire, le tout sur fond de puritanisme vieillissant, de guerre du Viet-Nam, de coup d'état au Chili, de scandale du Watergate, de charme discret des vieilles provinces du nord-est. On n'échappe pas au portrait de ses parents, un couple bancal, mal assorti et agressif («Ma mère et mon père me paraissaient terriblement seuls. Surtout lorsqu'ils étaient ensemble. ») qui pratique volontiers le mensonge et l’hypocrisie, bien digne de ses racines juives du côté de sa mère et catholiques irlandaises du côté paternel, en fait une famille toxique qu'elle va fuir. Elle est très attachée à son père, réactionnaire et un peu alcoolique qui peine à voir grandir cette fille cadette qui de plus en plus lui échappe surtout quand elle choisit, malgré sa situation transitoire d'étudiante, une vie de couple apparemment heureuse, peut-être parce que la sienne ne l'est pas.
Le plus étonnant sans doute c'est que dans ce premier livre où il est question d'Alice, une jeune fille de 17 ans, Douglas Kennedy se glisse avec beaucoup de facilité… dans la peau de ce personnage, lui qui a 60 ans, même si ce n'est pas vraiment la première fois qu'il choisit quelqu'un du sexe féminin comme héro. L'auteur renoue avec le thème du hasard autant qu'avec celui des rapports entre hommes et femmes, du bonheur conjugal impossible, des états d'âme et des difficultés qu'il suppose, dans un contexte de mensonges, de trahisons, de secrets, d'alcool, de drogue, sans oublier la culpabilité judéo-chrétienne, un autre de ses thèmes favoris. Cette famille est à l’image de l'Amérique et de sa volonté de réussite, en même temps qu'elle existe dans un contexte religieux du rachat perpétuel de ses fautes. En réalité, on apprend beaucoup dans ce roman sur les années 70 et d'autres thèmes comme l'anti-sémitisme, l'homophobie, le racisme sont aussi abordés. C'est parfois un peu long et détaillé et on perd le fil de cette fiction mais si nos références sociales et culturelles françaises sont différentes, nous appartenons tous à l'espèce humaine qui montre des caractéristiques communes qui ici sont bien analysées.
Peut-être ai-je tort mais il se peut que ces sujets soient aussi des préoccupations personnelles de l'auteur, ce qui en fait de cette trilogie un roman largement autobiographique. C'est sans doute par dérision qu'il déclare, paraphrasant Flaubert, qu'Alice, c'est lui ! Il y a certes la différence de sexe et d'âge mais le parcours de cette jeune femme ressemble étrangement à celui de l'auteur. Il y a sa famille qui devait sans doute ressembler à celle d'Alice mais aussi le personnage de son père qui fut un agent de la CIA et joua un rôle dans le coup d’État de Pinochet au Chili. Le fait d'insérer cet épisode dans ce roman en dit assez long sur la gêne qui peut être la sienne et peut-être aussi une certaine forme de culpabilité. Il y en a un, un peu secondaire il est vrai, qu'est celui de ce professeur de l'université où étudie Alice qui veut écrire un livre mais ne parvient pas à s'y mettre. Est-ce la révélation d'une difficulté réelle, d'une paresse, d'une volonté affichée de procrastination ou l'aveu de ses propres limites ? Cette prise de conscience de son inutilité personnelle, cette perte de l'estime de soi qui débouchent sur la mort volontaire du Pr Hancock, sont-elles révélatrice d'une sorte de malaise personnel ? Pourtant Douglas Kennedy a toujours été un auteur prolifique ?
Comme toujours, j'ai apprécié l'analyse psychologique des personnages, le déroulement des faits, la qualité du style, direct et efficace, ce dont cette chronique s'est souvent fait l'écho. Il y a des longueurs certes, mais, bizarrement peut-être et malgré ces 360 pages, je ne me suis pas ennuyé, ce fut un réel bon moment de lecture et ce premier tome augure bien de la suite.
© Hervé GAUTIER – Janvier 2018
La disparue de Saint-Maur - JChristophe Portes (City éd.)
Nous sommes en novembre 1791 et la Révolution redouble, surtout après la fuite manquée du roi à Varennes et la menace que fait peser l'armée des émigrés massée à la frontière allemande.. Plus que jamais la Nation est en danger. Cela n'empêche pas la vie de continuer et à Saint-Maur une jeune aristocrate, Anne-Louise, fille du baron Ferrières, un noble désargenté, a disparu. Fugue, meurtre, ou suicide… Le jeune lieutenant de gendarmerie, Victor Dauterive est chargé par sa hiérarchie d'enquêter mais ses investigations se révèlent difficiles malgré des aides parfois inattendues dont certaines ne manquent ni de courage ni d’imagination. Ce qu'il découvrira sera bien éloigné de ce qu'on peut légitimement attendre de gens qui se consacrent en principe à la prière. La société est secouée par des luttes de pouvoir et La Fayette, à qui Victor doit tout, revient à Paris dans l'espoir de conquérir la Mairie et charge l'officier d'enquêter discrètement sur un des candidats à ce poste. Telle est l’intrigue de ce roman historique où l'auteur, une nouvelle fois, mêle fiction, réalité, rencontres de personnages historiques et ambiance d'époque (les notes de bas de pages avec leurs références sont un repère intéressant pour qui souhaite s'immerger dans l'action).
Le paradoxe de ces deux affaires, qui apparemment n'ont rien à voir l'une avec l'autre, est que l'officier mène alternativement ses investigations d'une manière officielle et officieuse, La Fayette, dont le rôle dans le déroulement de la Révolution est controversé, n'est en effet plus au pouvoir, ce qui complique sa tâche surtout dans le contexte politique agité de la capitale, l'ombre de Robespierre, de la guerre qui menace et celle de la Terreur qui s'annonce. Les temps changent et avec eux les hommes qui donnent libre court à leurs ambitions entre louvoiements, palinodies, trahisons, violences. Au milieu de tout cela notre gendarme doute et vacille quelque peu, torturé par des difficultés familiales, se demandant qui il sert en réalité et s'il n'est pas simplement manipulé comme un vulgaire pion, dans une ambiance de complots où chacun espionne l'autre. Malgré son jeune âge, on le transforme en espion sans l'y avoir préparé. Dans cette mission périlleuse, il croise des agents doubles parfois improbables, des nostalgiques de l'Ancien régime désireux de détruire la République qu'il a décidé de servir, des arrivistes sans scrupules, ce qui se transforme en une traque de conspirateurs, sur fond d'agents anglais, de rumeurs de guerre, de ventes de biens nationaux, d'opportunistes, d'omniprésence policière...Il connaît la torture, la mort qui rode, les rebondissements inattendus, les luttes d’influence de factions politiques opposées où chacun avance masqué de peur du lendemain, les hommes politiques corrompus, la délation, la jalousie, les secrets de famille inavouables, tout un panel d'humiliés qui profitent de cette pagaille pour se venger des vexations subies sous les aristocrates, bref tout un tableau peu reluisant de l'espèce humaine qui ne se révèle jamais autant qu'en des temps troublés et ce d'autant plus qu'on s'éloigne de l'esprit des Lumières et des idéaux humanistes de la Révolution.
Tous ces rebondissements ont pour cadre ce Paris du XVIII° siècle dont une carte permet au lecteur de s'y retrouver. Décidément l'année 1791 passionne Jean-Christophe Portes puisque ses deux précédents ouvrages [ « L'affaire du corps sans tête » - « L'affaire de l'homme à l'escarpin », se déroulaient déjà au cours de cette année. Ici, il en choisit le dernier mois, décidément très froid, pour plonger son lecteur dans une France au bord du chaos mais toujours dans les pas de Victor Dauterive. Cela donne un roman policier historique bien écrit et bien documenté, plein de suspense, dépaysant et passionnant jusqu'à la fin.
© Hervé GAUTIER – Décembre 2017
Dulmaa Hubert François (Éd. Thierry Marchaisse)
Dulmaa, c'est le nom de la mère d’Élisa, disparue depuis de nombreuses années, sans aucune explication pour retourner dans son pays natal, la Mongolie.
Elle a ainsi abandonné sa fille, encore enfant et son mari français qui vient de mourir en faisant promettre à Élisa de retrouver cette mère mystérieuse qui vivrait actuellement une retraite monastique sous la direction spirituelle d'un lama. Elle part donc seule pour ce pays inconnu, seule, pas tout à fait cependant, puisqu’elle est accompagnée de sa tante, mais surtout de son très mystérieux grand-père, d'un chien vieux mais bougrement protecteur et d'un cheval.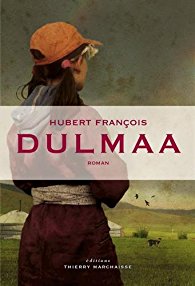
Quand elle arrive en Mongolie, elle est d'emblée confrontée à une culture qui n'est pas la sienne, où la mère est l'égal de Bouddha et à qui on ne demande évidemment pas de compte, où il est normal de séparer les enfants de leurs parents, où on n'aborde pas les problèmes de la même manière qu'en occident…
A travers la steppe, elle est accompagnée des carnets de son père qui avait vu ce pays comme une image d’Épinal, une sorte de fiction fantasmée de « grands espaces » et « d'esprit des steppes » mais qui était revenu bien vite à une réalité plus terre à terre.
Nous avons en occident une vision idyllique de ces contrées que nous avons un peu de mal à situer sur une carte. Au gré de la mode, nous adoptons l'image de la yourte et de l'hospitalité traditionnelle et oublions volontiers le quotidien pas forcément aussi agréable que cette carte postale. La dureté du climat, l'absence de confort, les lois du nomadisme, la tradition du mariage et la condition de la femme, la réalité du chamanisme, la présence des ordures dans le paysage urbain, la façon particulière d'affronter les problèmes..., font de la mixité des cultures un concept intéressant pour les intellectuels mais qui transforme la quête d’Élisa en un chemin de croix long, parfois douloureux et tragique, bien loin de ce qu'elle avait imaginé. De plus ce voyage réveille de vieilles querelles familiales. Pour autant ce parcours que l'on peut supposer initiatique, ce retour sur soi-même et sur son passé familial, où l'impossible le dispute à l'irréel, se transforme en une odyssée épique et quelque peu surréaliste où Élisa semble protégée en permanence malgré la mort, les souffrances, par un improbable dieu. Il y a certes la nostalgie de l'enfance, les espoirs déçus, le gâchis de la vie, les épreuves endurées et l’imagination dévastatrice dont l'espèce humaine est capable !
Ce roman a obtenu le prix national et Poitou-Charentes CEZAM 2017
© Hervé GAUTIER – Novembre 2016
La complainte du paresseux Sam Savage (Actes Sud)
Histoire principalement tragique d'Andrew Whittaker, réunissant l’ensemble irrémédiablement définitif de ses œuvres complètes
Traduit de l'américain par Céline Leroy
Ce roman s'ouvre sur une citation de Fernando Pessoa, ce qui, pour moi, ne pouvait être qu'un bon présage.
Andrew Whittaker est un geignard impénitent et tout lui est bon pour râler et se plaindre dans les lettres qu'il envoie à l'entour. Ce sont les travaux dispendieux et les loyers de son petit patrimoine immobilier qui ne rentrent pas, les invectives qu'il envoie à la banque où il ne peut s'empêcher de raconter sa vie dans les plus petits détails et quand il s'adresse à un correspondant, les termes de ses courriers oscillent entre la mythomanie, les rodomontades et les menaces. Il n'omet jamais de parler de sa revue poétique moribonde, « Mousse », dont il se baptise pompeusement « rédacteur en chef » alors qu'il est seul à la rédiger (et sans doute à la lire) et dont il tente d'assurer la survie en multipliant vainement les appels de fonds et en sollicitant de vieux amis auteurs qui ont réussi mieux que lui dans le métier des Lettres, mais en leur précisant qu'ils ne seront pas payés pour leur prestation, ce qui n'est évidemment pas de nature à les motiver. 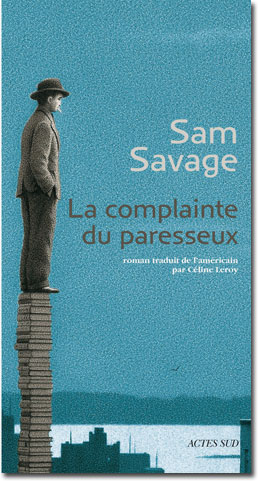
Cette revue est d'ailleurs l'objet de railleries de la part de la concurrence et de l'ignorance des médias ! Pour faire illusion, il lui arrive même de se cacher derrière l'identité d'un lecteur inventé et d'écrire à la presse locale pour vanter les qualités littéraires de « Mousse » et la personnalité hors du commun de son directeur, c'est à dire lui-même ! Il se prétend découvreur de talents, mais abuse de sa sacro-sainte « ligne éditoriale » pour refuser tous les manuscrits qu'on lui envoie, ce qui est une manière peu élégante de la part d'une revue miséreuse qui n'a pas les moyens de ses ambitions littéraires. Cela ne l'empêche pas de faire des allusions appuyées à des manifestations culturelles organisées par ses soins et couronnées par une remise de prix minable, et qui n'aura évidemment jamais lieu ! Et quand il s'invite aux démonstrations culturelles organisées par d'autres, c'est simplement pour y faire scandale !
Quant à la gent féminine, il lui arrive bien plus souvent qu'à son tour de s'adresser à elle, mais avec une goujaterie consommée ! Il déplore aussi sa solitude, sa chère épouse, Julie, s'est envolée, et le souvenir d'une éphémère passade avec une autre femme ne suffit pas à l'apaiser. Puis c'est sa voiture qui va rendre l'âme, sa ligne téléphonique qui est coupée et sa mère qui perd la tête et finalement meurt, quand il ne se répand pas dans des épîtres pleines d'acrimonies pour dénoncer le sort qui est fait à sa revue dont il précise abusivement qu'elle a une « résonance nationale » dans cette Amérique profonde des années 1970.
Bref il croit que tout le monde lui en veut et il est devenu complètement paranoïaque, misanthrope, désespéré et écrit tout cela dans des missives pathétiques, des brouillons de romans, des listes de courses, le tout étalé sur quatre mois de sa triste vie. Pour corser le tout il prétend commencer à sentir les effets du vieillissement, alors qu'il n'a que 43 ans !
Ses lettres successives sont un long monologue où, quand il n'est pas cynique, il ne parle que de lui, illustrant à sa manière le solipsisme qui est souvent le propre de l'écrivain, parce qu'il est aussi un écrivain, mais un écrivain raté, comme en attestent les nombreux passages de romans qui ne paraîtront jamais parce qu'ils ne s'inscriront pas dans une intrigue, ne seront jamais suivis de développements et d'épilogues. Quant au monologue qui est la conséquence de son isolement prolongé et sans doute définitif, l'écriture, qui est l'essence même du soliloque, n'est là que comme un pis-aller où le surréalisme comique le dispute au sérieux le plus consommé au point qu'on se demande s'il ne croit pas lui-même à sa propre comédie. Pourtant, il ne reçoit apparemment pas de réponse puisque cet ouvrage n'en fait pas état, ses correspondants devant depuis longtemps être lassés de ses incessantes jérémiades, ce qui aggrave son état de déréliction.
En fait, j'ai découvert une sorte d'ours, malheureux, malchanceux et que menace la folie peut-être parce qu'il a passé sa vie à rêver à quelque chose qui ne se réalisera jamais, ou il veut à toute force se jouer à lui-même une bouffonnerie où il a une importance qu'il n'aura jamais. Cet Andrew est vieux avant l'âge mais je dois admettre qu'il incarne tous ceux, et ils sont nombreux, qui voulaient vivre de leur talent mais qui n'ont pas connu le succès. En se dessinant de cette manière, à petites touches, il évoque lui-même le paresseux auquel il dit ressembler ; cet animal placide et solitaire, qui porte le nom de « aïe », lui correspond bien, lui qui passe son temps à se plaindre ! Et la comparaison ne s'arrête pas là.
Le style est débridé, parfois humoristique voire caustique, parfois ironique mais étonnamment vivant et je ne me suis pas ennuyé au cours de cette lecture. A l'instar de Rabelais qui voulait qu'on brisât l'os pour en goûter la substantifique moelle, j'ai choisi de dépasser cette dimension caricaturale pour rencontrer un personnage torturé qui attend la mort comme une délivrance parce que sa vie n'a été qu'une succession d'échecs. En attendant cette échéance, il farde ses accès de révolte sous le rire (ou le sourire), ce qui lui permet de supporter le tragique de sa propre existence et on hésite entre quelqu'un qui a effectivement perdu la tête ou au contraire un homme qui, dans un étonnant excès de lucidité, choisit de siffler lui-même la fin de cette récréation dramatique.
J'ai bien ressenti l'empreinte de Pessoa dans ce roman original dans sa présentation et aussi une certaine empathie pour Andrew... et peut-être aussi pour ce jeune auteur (de 77 ans !) rencontré par hasard dont c'est le deuxième roman traduit en français et qui nous livre peut-être, à travers ses livres, un peu de son parcours personnel.
Les rêveuses Frédéric Verger (Ed. Gallimard)
La guerre peut bouleverser la destinée, c'est sans doute ce qu'a dû se dire le jeune allemand de 17 ans engagé dans l'armée française, Peter Siderman, quand, pris dans la tourmente de la débâcle de 1940, il échange sa plaque militaire avec celle d'un mort inconnu.
Désormais il sera Alexandre d'Anderlange et les hasards de cette nouvelle identité le ramènent en Lorraine, désormais allemande, où il a grandi. Une telle situation porte en elle le germe de bien des aventures et, sans trop savoir comment, il se retrouve au sein de la famille de celui dont il a usurpé le nom. Il devient donc le fils d'une famille aristocrate ruinée mais bizarrement, alors que tous se rendent compte de la substitution, il y est accepté et décide de rester dans ce décor aussi mystérieux et inquiétant que les habitants qui le peuplent, désireux à la fois de faire perdurer un passé révolu et de survivre dans un présent difficile. 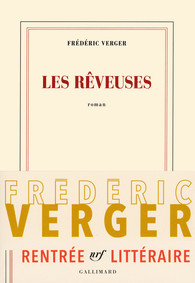
Dans cette situation passablement surréaliste viennent se mêler des souvenirs personnels un peu flous, mais Peter ne tarde pas à comprendre la raison de l’acceptation de sa présence d'autant que, petit à petit, il habite le passé d'Alexandre au point parfois de s'identifier à lui. Il cherche à percer le mystère que cet homme mort portait en lui, et même s'il n'y a aucune ressemblance entre eux, il accepte, certes contraint, mais aussi avec une certaine curiosité, de jouer le rôle qu'on lui a assigné dans cette improbable comédie.
La réponse aux appels de détresse de Blanche, et la rencontre avec la riche veuve contribuent largement à le faire entrer dans les habits de l'absent, ce qui fait de lui, au hasard des événements un peu rocambolesques et parfois dramatiques, un invité ou un prisonnier, un étranger de passage ou un véritable membre de cette famille décousue, un peu comme si ce jeune aristocrate mort lui faisait cadeau des années de vie que la camarde lui avait arrachées. Son instinct de survie réveille cependant en lui sa personnalité originelle ce qui donne une intéressante étude parallèle de caractères.
Tout au long de ce roman subsiste une sorte d’ambiguïté entre ces deux personnages, l'un mort, l'autre vivant. Le style fluide, précis et poétique tisse autour de cette aventure un halo de mystères et de secrets mais aussi de tristesse et de nostalgie. Les descriptions sont réalistes et haletantes, spécialement au cours de l'exploration du couvent en ruines et des recherches qu'il y mène. Cette histoire de nonnes rêveuses du couvent d'Ourthières dont on notait les songes, simulations ou réalité, donne au texte l'allure d'un conte aux images allégoriques et la recherche de Blanche confère au récit une dimension épique et même initiatique. Ces documents où sont collationnés les rêves des nonnes, cette rivalité entre les familles d'Etrigny et d'Anderlange, l'ombre fantasque et les accès de folie de Blanche, riche héritière devenue religieuse sans qu'on sache vraiment si elle est présente dans ce couvent délabré de sa propre volonté ou si c'est le résultat d'une manœuvre familiale, le commandant allemand, alcoolique, aussi affable et prévenant que méchant, qui recherche inlassablement quelque chose qui ressemble à un paradis perdu, le côté à la fois enthousiaste et ambigu des habitants de cette datcha intemporelle, cette obsédante présence de la mort qui rôde, entretiennent un suspens lentement distillé.
J'ai été happé, du début à la fin, par cette histoire aux multiples rebondissements, à la fois passionnante et inquiétante, j'ai apprécié l'humour subtil, la cocasserie mais aussi le tragique de certaines situations, qu'offrent au lecteur attentif ces quatre cent quarante pages pendant lesquelles je ne me suis jamais ennuyé. Les écrits intimes et sporadiques d'Alexandre, l'évocation des songes des religieuses et les personnages qui, comme des fantômes, apparaissent dans ce roman, avec la présence mystérieuse d'un chat, provoquent en effet cette ambiance où le lecteur va de découverte en découverte, éprouve pour Peter une véritable empathie et vit avec lui cette inquiétante épopée.
J'y ai également vu une étude pertinente sur l'espèce humaine capable des pires et des meilleures choses, l'étonnante volonté de survivre de Peter face à la mort omniprésente, l'évocation fréquente du sommeil qui en est l'antichambre, les hasards et la fragilité de la vie dont nous ne sommes que les usufruitiers.
Je remercie les éditions Gallimard et Babelio, de m'avoir permis de découvrir cet auteur et ce roman.
Où j'ai laissé mon âme Jérôme Ferrari (Actes sud)
Il y a différentes façons de faire la guerre. Pour le capitaine Degorce, père de famille chrétien et pieux, la recherche du renseignement qui peut épargner des vies françaises innocentes justifie la torture, en ce mois de mars 1957 en Algérie.
Il est chargé de faire parler les prisonniers et sait les en convaincre. Il a mis sur pieds une organisation qui a réussi à démanteler un réseau terroriste au point d'arrêter Tahar qui en est le chef. Il sait qu'il fait un sale métier, bien différent de celui qu'il avait imaginé, mais, au nom de la discipline il accomplit sa tâche, même s'il en a honte.
Jeune étudiant il a fait de la Résistance et a été interné à Buchenwald, plus tard, en Indochine, il a combattu le communisme au nom de la mission civilisatrice de la France et des valeurs de la République. Pour cela, le lieutenant Andreani qui fut son compagnon d'armes et le suivit dans les camps d'internement des Viêts, lui témoigne une admiration inconditionnelle. Maintenant, en Algérie, les choses ont changé et le capitaine est devenu un tortionnaire par la force des choses, mais cela, il ne le supporte pas. Pourtant, face à ses hommes, il se doit de jouer le rôle du chef, de leur rappeler le sens de leur mission qui se doit d'être efficace, légitimant ainsi la torture. D'ailleurs la capture de Tahar lui vaudra promotion et décorations mais il n'en a cure, il est face à sa conscience et n'est pas en paix avec lui-même. Il estime son adversaire qui est aussi un ennemi, son combat pour l’indépendance de l'Algérie est aussi légitime que celui qu'il menait en France sous l'Occupation et plus tard sur le théâtre d'opérations extérieures et ce même si Tahar a dû ordonner des attentats, c'est à dire la mort de civils innocents.
Dans ce contexte il est sans doute difficile de discerner le bien du mal et chacun a conscience de faire son devoir. Le capitaine est seul face à son devoir d'infliger à Tahar les mêmes souffrances que celles qu'il a subies de la part de la Gestapo mais il le fait malgré sa foi chrétienne, il est seul aussi devant Tahar qu'il veut convaincre de la vanité de son combat, mais en vain. Plus tard Andreani constatera, devant le tribunal militaire qui le condamnera à mort, que cette guerre d'Algérie a complètement changé Degorce au point de faire de lui un laquai servile… et un lieutenant-colonel décoré à qui Dieu ne sera d'aucun secours. Il a perdu son âme, a choisi d'oublier ses hésitations existentielles et a touché ses trente deniers pour prix de sa trahison intime. La nature humaine est ainsi faite, faible et misérable et l'oubli, comme l'hypocrisie et le mensonge font partie du décor dans lequel elle aime à vivre. Andreani lui aussi y laissera son âme mais pour des raisons différentes.
Ce qu'on appelé pudiquement au début « les événements d'Algérie » pour admettre ensuite qu'il s'agissait d'une véritable guerre, a été un drame pour l'honneur de l'Armée et pour les militaires. Il y eut de part et d'autre des atrocités, des attentats mais il s'agissait moins de livrer des combats traditionnels que de se transformer en tortionnaires et en bourreaux au nom de la logique et de l’obéissance. Cette guerre a bousculé les consciences et beaucoup ont choisi leur camp au mépris de la discipline, ont proclamé leur rejet de ces méthodes ou les ont appliquées avec zèle. Elle a donné lieu à une rébellion au sein de l'armée, à des proclamations officielles et à des promesses pourtant vite trahies, des abandons par la France, pays des Droits de l'homme, des harkis qui avaient pourtant choisi de se battre pour elle... Tout cela pour se terminer par un exil de populations civiles pour une métropole inconnue et des plaies qui ne se refermeront jamais.
Je ne connaissais cet auteur qu'à travers « Le sermon sur la chute de Rome » qui lui a valu le Prix Goncourt en 2012 (La Feuille Volante n° 1152). Ce roman qui invite à une réflexion sur la nature humaine aurait d'ailleurs amplement mérité cette distinction. Ici, j'ai retrouvé avec plaisir le style remarquable de Jérôme Ferrari qui s'attache son lecteur du début à la fin et ce nonobstant la longueur de certaines phrases.
© Hervé GAUTIER – Juillet 2017
Rien Emmanuel Venet (Éd. Verdier)
Parce qu'il a l'intention de fêter leur vingt ans d'amour, un musicologie invite Agnès, sa compagne, au Negresco. Après une étreinte, cette dernière lui pose une question aussi légère que les volutes bleues de la fumée de sa cigarette « A quoi pense-tu ?».
En fait ce voyage amoureux n'est qu'un prétexte pour gommer les petites érosions et les accidents inévitables d'une vie commune mais surtout parce que ce palace niçois a donné asile pendant quelques jours à Jean-Germain Gaucher, un musicien de troisième ordre de la Belle Époque à qui le narrateur a consacré sa thèse de doctorat et qui est venu ici avec sa maîtresse, la sulfureuse et ambitieuse soprano Marthe Lambert. Malheureusement une rénovation a fait disparaître la chambre où Jean-Germain et Marthe batifolèrent, qu'importe, c'est pour le narrateur l'occasion d'inviter son lecteur à faire plus ample connaissance avec ce musicien qui n'a laissé dans l'histoire de la musique, comme dans l'histoire tout court, qu'une trace fort ténue, que son travail universitaire s'attacha à faire revivre.
Le narrateur évoque la vie quelque peu tumultueuse de Gaucher qui la préféra cependant à la profession juridique voulue par son père. Il évoque surtout la mort du musicien, par ailleurs pas très heureux en ménage, qui a connu des relations extra-conjugales plus que cahoteuses et dont la carrière artistique qui aurait pu être florissante, s'est perdue dans des compositions de cabaret et des pochades légères. Cette mort bizarre, le musicien est écrasé par son propre piano lors d'un déménagement, donne à penser qu'il s'agit d'un suicide. Ce thème sera une des pistes de réflexion de cet ouvrage, hypothèse enrichie par les remarques d'un de ses amis qui ratiocine à l'envi sur ce sujet et ce malgré l'enquête qui a conclu à l'accident.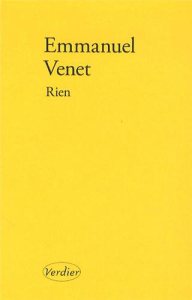
J'ai bien aimé ce Gaucher et la façon dont l'auteur le fait vivre sous nos yeux sous la forme d'une biographie convaincante et ce d'autant plus qu'elle appartient complètement à la fiction. On nous parle souvent et à l'envi, en les donnant en exemple, de tous ceux qui ont réussi, mais on passe sous silence les milliards de gens qui tentent leur chance sans jamais la croiser. J'ai lu dans ce roman qui tient son lecteur en haleine jusqu'à la fin, une caustique étude de personnages et de caractères, Jean-Germain construisant pour lui-même ses propres châteaux en Espagne, se laissant griser par le succès ou les passions amoureuses dont on sait qu'elles ne sont que temporaires, se complaisant dans l'échec comme il se vautre dans la vantardise qui emprunte plus à l’imagination qu'à la réalité. A travers lui j'ai lu un rappel bienvenu aux choses de la vie, la fuite du temps, le destin qui vient parfois contrecarrer les projets les plus fous qu'on fait pour soi-même, la complaisance qu'on tisse face à l'adversité, la vanité des entreprises humaines et surtout le fait que nous ne sommes ici-bas que les modestes usufruitiers de notre propre vie. Cela donne une somme d'aphorismes bien sentis.
J'observe que Jean-Germain tient un journal intime ce qui en dit assez long sur la conscience qu'il a de son mal de vivre, mais encore une fois je ne suis pas bien sûr de la fonction cathartique de l'écriture et, mettre des mots sur ses maux ne me semble pas aujourd'hui être une thérapie efficace, comme son suicide plus que vraisemblable semble le prouver. Le psychiatre qu'est aussi l'auteur doit bien avoir un avis sur la question. Pour Gaucher la fuite reste possible mais d'une efficacité improbable, tout au plus se réfugie-t-il dans l'imaginaire, cette espérance gratuite et sans issue qui n'enfante que des fantasmes et des chimères. Mais cela ne l'arrange pas vraiment, tout comme ne le console pas de ses échecs répétés, de son mariage raté, des ses amours de contrebande sans issue, de son talent ignoré et des mauvaises affaires de son établissement, l'alcool dont il était devenu avec le temps et l'habitude, un adepte militant. Même la séduction de sa propre épouse lui paraît problématique et surtout pas vraiment apaisante. C'est comme cela, les amours de Jean-Germain et de sa légitime, à condition qu'ils aient jamais existé, se sont abîmés dans la routine, l’incompréhension et finalement l'indifférence silencieuse, ce qui fait dire au bon sens populaire que, contrairement aux apparences, le mariage ou la vie commune tuent l'amour, et ce n'est pas faux. Et je ne parle pas de l'inconfortable certitude de s'être trompé dans son choix !
J'ai aimé aussi que l'auteur ne tombe pas dans la trop facile évocation du Pigalle et de ses plaisirs. Je retiens également les remarques quelque peu acerbes du narrateur sur les affres de la vie universitaire, sur les difficultés de la création littéraire, de la façon de réussir dans le domaine de la recherche et de la publication ainsi que les fourches caudines sous lesquelles il faut passer pour être reconnu. A sa manière, il est lui aussi un peu Jean-Germain Gaucher et ce n'est peut-être pas un hasard s'il a choisi ce personnage comme sujet d'étude. Là aussi le narrateur se laisse aller, inspiré par son expérience personnelle, à une somme apophtegmes désabusés mais pertinents que bien des auteurs feraient bien de méditer. J'en retiens une « En matière d'art, non seulement il n'y a rien à attendre de l'altruisme ni de la sollicitation, mais les vertus cardinales s'appellent orgueil et égocentrisme ». Il en va de même sur le travail de créateur et sur la façon de mener sa carrière.
A travers les propos de son ami, le narrateur fait en quelque sorte le point sur la création artistique, les relations amoureuses et même la vie en général. Il en vient tout naturellement à s'interroger sur son mariage, sa vie de famille et son parcours sentimental, leurs aspirations, leurs imperfections, leur désenchantement. Il évoque sa rencontre avec Agnès, le hasard qui l'a provoquée, puis la lente érosion des choses qui l'amène à considérer que son couple, après vingt ans de vie commune et deux enfants, s'est lentement transformé en deux solitudes, avec mensonges et hypocrisies pour sauver les apparences, compromissions et artifices pour le faire durer, une manière de se rapprocher de Gaucher et de son désespoir et peut-être aussi des autres humains. Il pousse même son questionnement jusqu'aux relations sociales qu'il entretient, à ses dires, de moins en moins, refusant de satisfaire à l'esprit grégaire qui, sous toutes ses formes, gangrène notre société et notre quotidien. Comme il le dit «( il résiste) à la tentation de la normalité », tout en tentant de combattre la marginalité.
Mais revenons à la question initiale posée par sa compagne et à laquelle il répond simplement « à rien ». Outre le fait qu'il m'a toujours parut étonnant qu'on puisse ne penser à rien, cette somme de pages qui constituent le roman tend à prouver que l'auteur-narrateur n'a pas vraiment laissé la vacuité envahir son esprit, à moins bien sûr qu'il ait préféré cette réponse laconique et négative à la nécessité d'avoir à confesser à sa compagne tout ce qu'il a confier au lecteur.
Ce récit se décline de la part du narrateur sur le ton d'un monologue et sur le thème des illusions perdues. J'ai apprécié le style alerte, subtil, ciselé et délicatement ironique de ce trop court roman dont l'auteur m'était inconnu. Le hasard, pour une fois, a bien guidé mon choix. D'après ce que j'ai lu de lui, il publie peu et c'est dommage puisque sa facon de m'a à la fois étonné et conquis au point que je vais sans doute en lire davantage. Cela a en tout cas été pour moi un bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER – Juin 2017.
Une étrange affaire au bureau des hypothèques -J Chesneau
Auto-édition
Dans la vénérable administration fiscale, la « Conservation des hypothèques » était jusqu''à présent, pour les fonctionnaires de tout grade, du directeur au simple agent, un poste de fin de carrière apprécié par tous et à plus d'un titre. C'était un service un peu à part où l''ambiance était différente, l'environnement plus feutré, le travail plus méthodique peut-être, jusqu'au temps qui semblait, ici plus qu'ailleurs, se dérouler selon un autre rythme. C'est que, cette spécialité du « service public » dont l 'existence remonte à la Révolution française et à son respect du droit de propriété, a pour fonction d'assurer la publicité légale de tous les actes soumis à l'Enregistrement qui ont trait à la propriété foncière. Elle a donc un rôle essentiel dans le quotidien des Français.
Qu'il puisse s'y passer quelque chose d’extraordinaire qui vienne briser la routine administrative, les vieux papiers, les fiches cartonnées rédigées avec grand soin et à la main et qui étaient les gardiennes des transactions immobilières depuis des générations, est du domaine de l'impossible.
Et pourtant, en ce matin d'hiver 1990, Marie-Jo, une agente matutinale et zélée, entrant dès 7H30 dans les bureaux, trouve le corps d'un homme, étranger au service, en train d'agoniser entre les bacs rotatifs métalliques. Émoi général, on appelle le SAMU, les pompiers, la police judiciaire, on rend compte à la hiérarchie et évidemment la presse locale s'en mêle, bref un bouleversement qui va conduire chacun à être interrogé et le Conservateur, qui espérait mieux avant son départ en retraite, à s'inquiéter quelque peu devant la présence dans ses locaux, pourtant sécurisés, de ce mystérieux intrus. Une délicate enquête s'annonce en direction d'un couple d'agriculteurs et d'une sordide affaire de donation plus qu'improbable dans le cadre d'un conflit familial pour le moins compliqué par une rénovation du cadastre, qui s'égare dans un conflit d'intérêts, le tout sur fond de confidentialité où chacun a à cœur de témoigner tout en restant sur ses gardes en respectant les prérogatives administratives et hiérarchiques qui s'imposent autant que les susceptibilités sociales.
L'auteur déroule cette courte fiction (une centaine de pages) à l'épilogue inattendu, en y mêlant humour, expressions et vocabulaire administratif caractéristique. C'est assez rare qu'un roman noir s'inscrive dans le cadre de l'administration fiscale, généralement considérée comme rébarbative et qu'on évite volontiers. C'était certes le cadre de travail de l'auteur qui ne manque pas, à l'occasion, de se faire le témoin du changement de mentalités et du bouleversement de carrières venant avec l'introduction de la dématérialisation informatique, de la rationalisation du travail et des économies inévitables tout en respectant le service rendu aux usagers, dans une unité administrative traditionnellement vouée à un certain conservatisme.
Je parlerai aussi de cette irrésistible envie d'écrire et de partager, sans doute dans le cadre restreint de ses collègues de travail, le fruit de son imagination pour cet auteur qui signe là son quatrième ouvrage dont la plupart a été publiée « à compte d'auteur ».
© Hervé GAUTIER – Mars 2017
Chanson douce Leïla Slimani (Ed. Gallimard, Goncourt 2016)
Louise est vraiment plus qu'une nounou. Non seulement elle s'occupe de Mila et d'Adam, les enfants de Myriam et de Paul, mais elle se révèle une parfaite « fée de ce logis »entre cuisine et nettoyage. Cet emploi tombe plutôt bien pour elle, veuve, la cinquantaine et en difficultés financières. Les relations qui s’installent entre le couple et elle sont même de bonne augure et chacun y trouve son compte, même si, au terme de ces rapports, les parents abandonnent volontairement un peu de leur rôle d'éducateur au profit de cette étrangère qu’ils ne connaissent guère et qui s'accapare la place ainsi laissée vacante, jusqu'à ce que se crée une situation qui risque d'échapper à tout le monde. Certes, ils peuvent la congédier à tout moment, mais cette éventualité nourrit la dépendance qui peu à peu s'installe en eux au profit de Louise. Cela fait d'elle une sorte d'esclave moderne qui chaque jour s'enfonce dans sa condition, un servage volontaire qui fera d'elle, et sans peut-être qu'elle s'en rende compte au départ, une femme efficace, indispensable mais surtout envahissantet même transparente.
C''est un roman sociologique qui évoque aussi notre mode de vie actuel, l'obligation de travailler pour l'épouse face au salaire du mari parfois insuffisant, la tentation qu'elle peut avoir d'une ouverture sur le monde professionnel avec promotion et reconnaissance à la clé, face à une vie repliée sur un foyer, l'obligation de confier ses enfants, c'est à dire ce qu'elle a de plus cher au monde souvent à des gens inconnus, d’autant plus dévoués qu'ils s'impliquent plus complètement dans ce travail qu'ils ne le feraient dans un emploi ordinaire; on peut bien tomber ou non. Quant à la réussite professionnelle dont on nous rebat les oreilles depuis si longtemps au point qu'elle en devient obligatoire, elle sous-tend elle-même ce genre de situation et la nourrit, avec tous les risques que cela comporte. Il y a les préjugés de classe mais aussi l'implication logique de Louise face aux enfants. Même si ici nous sommes en pleine fiction[pas tant que cela puisque des faits semblables se sont déroulés aux USA], la réalité n'est jamais très loin. Je ne veux pas endosser la robe d'un improbable procureur mais Myriam et Paul, parents absents et employeurs abusifs, me paraissent bien coupables d'avoir ainsi livré leurs enfants, mais aussi leur foyer, leur intimité,leur vie, à Louise à qui le spectacle de la réussite et de l'argent auxquels elle n'avait pas droit était donné quotidiennement. La petite Milla et peut-être Sylvie, la belle-mère de Myriam, auraient pu être des vigies et faire prendre conscience à Myriam de cet écartèlement entre son rôle de mère et sa réussite professionnelle, mais personne ne les a écoutés. Le texte plein d'analepses, nous présente Louise comme une femme méritante, un peu mythomane, trahie par les siens, victime des événements, délaissée par son employeur, et finalement déstabilisée, tout ce qui va peu à peu faire d'elle une meurtrière. Une histoire qui sonne pour chacun d'entre nous comme un avertissement. Je ne sais pas si une telle « fée » existe mais qu'importe. Que l'auteure appuie sur le trait ne me paraît pas irréel. Nous vivons dans une société où l'exagération est quotidienne et n'étonne plus personne. La communauté dans laquelle nous vivons, à l'inverse de toute la logique du pourtant proclamé « vivre ensemble », fabrique chaque jours des exclus et des marginaux qui accumulent en eux des ressentiments. Ce glaçant récit en est l’illustration autant que son écriture peut être une sorte d'exorcisme.
J'ai apprécié le talent de l'auteur, les phrases simples et agréables à lire, une écriture sobre et élégante, de courts chapitres, une architecture du texte bien construite en forme d'analepse et malgré tout un suspense distillé jusqu'à la fin, même si les premières phrases du roman ne laissent aucune ambiguïté sur l'épilogue sanglant. Je ne connaissais pas cette auteure et je me félicite qu'elle ait été distinguée par ce prix littéraire prestigieux. Il m'est parfois arrivé dans cette chronique de dire qu'il a été, dans le passé, attribué à des écrivains qui ne le méritaient pas. Ce n'est nullement le cas ici, tant s'en faut, et je suivrai volontiers l'univers créatif de Leïla Slimani.
Nouvelles inquiètes Dino Buzzati (Ed. Robert Laffont)
Traduit de l'italien par Delphine Gachet.
L'univers de la nouvelle est particulier et réunir dans un recueil des textes écrits à des moments différents, sous des inspirations diverses tient parfois de la gageure. Ceux-ci ont en effet été publiés dans « Le Corriere della Sera », le célèbre quotidien milanais où Buzzati a occupé des postes différents de 1928 à 1972. Il a gardé de son ancien métier de journaliste son sens de la concision qui sied si bien à ce genre littéraire et qui en fait l'originalité. Il a le souci du petit détail qui tient lieu de longues descriptions, joue avec le suspense au point que le lecteur en vient à désirer ardemment l’épilogue, surtout quand il met du fantastique dans son texte.
Ici nous ne sommes pas dans « le désert des Tartares » (Feuille volante n° 1076) qui lui valut sa notoriété, où il raconte une longue histoire, celle de ce capitaine Drogo qui attend quelque chose de la vie sans trop savoir quoi et qui finit par lui échapper, encore que le texte qui ouvre ce recueil en reprend le cadre, un peu comme si la vie militaire exerçait sur l'auteur une sorte de fascination. C'est le même Giovanni Drogo qui revient dans une de ces nouvelles mais sous la forme d'un jeune homme qui attend, lui aussi et qui finit par rencontrer la Camarde. Mais, revenons sur le titre. Il est parlant et c'est un thème qui convient parfaitement à notre auteur, au regard qu'il porte sur la vie. C'est vrai que si on se penche un tant soit peu sur notre condition humaine, si on accepte de l'observer, de l'analyser, de la disséquer, il y a bien de quoi être inquiet ! Notre condition d'homme implique la mort, même si en Occident nous faisons semblant de l'oublier et vivons sans y penser. Elle est présente dans tout ce recueil, encore évite-t-il la traditionnelle tartuferie dont parlait Brassens « Tous les morts sont de braves types depuis qu'ils ont cassé leur pipe ». Ainsi Buzzati remet-il les pendules à l'heure en évoquant les disparus tels qu'ils étaient vraiment de leur vivant. Cela fait parfois un choc. Non la vie n'est pas si belle que cela et quand elle peut l'être, nous avons cette bizarre volonté de nous la compliquer jusqu'à détruire ce que nous avions patiemment tissé. Quant à l'enfer, il n'existe pas dans l'au-delà mais bien ici, dans notre vie terrestre, et il ne cache pas sa conviction dans ce domaine. Notre vie est un perpétuel combat, contre nous-même et surtout contre les autres où chacun rêve d'éliminer son voisin pour s'approprier ce qui lui appartient ? N'est-ce pas une comédie qui tourne parfois à la tragédie entre flagorneries, compromissions, trahisons et simulacres. Chacun pour soi est le mot d'ordre, étonnez-vous qu'ainsi la solitude soit le résultat de tout cela !
Pendant qu'il y est, il règle aussi son compte à l'amour et aux amoureux qui choisissent de ne rien voir de la réalité immédiate. A la passion du début succède rapidement des espérances de pompes funèbres, quand on n'entretient pas artificiellement l'illusion qui cache désespérément les mensonges, les duplicités, les adultères. Les enfants perdent vite leur innocence et dès lors qu'ils entrent plus avant dans la vie ils apprennent tout le parti qu'ils peuvent tirer de ses hypocrisies et du jeu sur les apparences. Pendant qu'il y est, il n'oublie pas la fuite du temps qui nous rapproche inexorablement du terme et empoisonne la vie de ceux qui en prennent conscience et déplorent cette contingence. Encore faut-il qu'il ne se déforme pas mystérieusement et bouleverse le quotidien de notre vie en se peuplant de fantômes qui bien entendu se vengent. Le temps lui-même dissout tout, la beauté, la jeunesse. Parce que, pour corser le tout, son écriture s'enrichit de mystère, les récits se font sibyllins, les dénouements énigmatiques, histoire de dire à son lecteur qu'il est, grâce à lui, dans un autre monde, une autre dimension où il faut faire abstraction de la logique, oublier le cartésianisme pour ne privilégier que ce qui échappe à l'esprit le plus rationnel, sans oublier de rire de tout !
© Hervé GAUTIER – Décembre 2016
Otages intimes - Jeanne Benameur (Actes Sud)
Étienne est reporter de guerre. Il a été pris en otage et a cru mourir, s'accrochant seulement à un mince espoir de libération qu'il connaît aujourd'hui dans l'avion qui le ramène en France. Il a été une monnaie d'échange, a laissé derrière lui d'autres journalistes qui sont peut-être morts et il le sait. Ce métier, il l'a choisi avec ses départs et ses risques pour sa vie, comme son père avant lui, pêcheur en haute mer et qui n'est jamais revenu. Après avoir connu cette solitude de jeune veuve, sa mère, Irène, institutrice de campagne mais aussi musicienne, a connu celle de savoir son fils en danger de mort avec cette quasi-certitude qu'il ne reviendra pas lui non plus, victime de son métier. Dans l'avion qui le ramène à Paris, il sait qu'il va devoir réapprendre à vivre, mais ne sait pas comment. A l’aéroport, Irène l'attend mais elle n'est pas seule, il y aussi Emma, sa dernière compagne.Même si tout est fini entre eux à cause de ses départs et des angoisses que cela lui infligeait, parce qu'il était « un intermittent de la vie », elle pense encore à lui malgré une liaison entamée avec Franck. Elle ne parviendra cependant pas à renouer avec lui. D’autres aussi l’attendent il y a Enzo, « le fils de l'Italien », l'ami d'enfance, le menuisier, le parapentiste qui jouait aussi du violoncelle ; avec Étienne qui était pianiste et Jofranka, l'étrangère, l'enfant recueillie qui était flûtiste, ils formaient un trio, heureux de jouer ensemble, heureux de vivre. Ils s'étaient promis de ne jamais se quitter, ils étaient un peu « les trois enfants d'Irène ». Enzo est resté au village, et Jofranka, son épouse éphémère,est avocate à La Haye et se consacre aux femmes détruites par la guerre, les aide à témoigner de ce qu'elles ont vécu. Étienne doit réapprendre à vivre, oublier sa détention et la mort qu'il a côtoyée et pour cela il revient au village près de sa mère un peu comme on remonte le temps , y retrouve Enzo puis Jofranka.
ramène à Paris, il sait qu'il va devoir réapprendre à vivre, mais ne sait pas comment. A l’aéroport, Irène l'attend mais elle n'est pas seule, il y aussi Emma, sa dernière compagne.Même si tout est fini entre eux à cause de ses départs et des angoisses que cela lui infligeait, parce qu'il était « un intermittent de la vie », elle pense encore à lui malgré une liaison entamée avec Franck. Elle ne parviendra cependant pas à renouer avec lui. D’autres aussi l’attendent il y a Enzo, « le fils de l'Italien », l'ami d'enfance, le menuisier, le parapentiste qui jouait aussi du violoncelle ; avec Étienne qui était pianiste et Jofranka, l'étrangère, l'enfant recueillie qui était flûtiste, ils formaient un trio, heureux de jouer ensemble, heureux de vivre. Ils s'étaient promis de ne jamais se quitter, ils étaient un peu « les trois enfants d'Irène ». Enzo est resté au village, et Jofranka, son épouse éphémère,est avocate à La Haye et se consacre aux femmes détruites par la guerre, les aide à témoigner de ce qu'elles ont vécu. Étienne doit réapprendre à vivre, oublier sa détention et la mort qu'il a côtoyée et pour cela il revient au village près de sa mère un peu comme on remonte le temps , y retrouve Enzo puis Jofranka.
Tous ces personnages sont des solitaires même si certains comme Étienne et Jofranka ont choisi de quitter le village, ont pris le parti d'approcher la violence, de « tremper dans la chaos du monde » chacun à sa manière ; c'est un peu comme s'ils avaient besoin de la guerre et du malheur. Enzo et Irène, eux, ont eux choisi d'y rester, à la recherche d'une hypothétique paix que probablement ils ne trouveront pas. Chacun revient sur son enfance, sur son passé, Étienne tourmenté par ses photos, par ce qu'il a vu, qu'il ne peut oublier et qu'il raconte, Jofranka par son combat difficile pour les femmes meurtries par la guerre, Enzo par le souvenir de sa femme qui lui a définitivement échappé, échec intime qu'il tente d'exorciser par le travail du bois et sa complicité avec l'air, Irène qui, elle aussi jadis, s'est vengée de son mari et ses longues absences. Son fils, bien que petit à cette époque a compris que quelque chose se passait. Plus tard, il a choisi ce métier de reporter pour fuir ce microcosme familial délétère, errer dans le monde, aller au-devant de la violence et peut-être recherche la mort. C'est à la fois une quête dramatique, un acte de désespoir et un geste bizarrement expiatoire. Peut-être fuit-il aussi cette amitié qui devait être solide et qui a été trahie par l'amour d'Enzo et Jofranka. Elle a choisi de consacrer sa vie à la défense des femmes détruites par la guerre parce qu'elle est elle-même une réfugiée, une recueillie, une façon peut-être d'honorer une dette ? Enzo ne parviendra jamais à se délivrer de son ex-épouse et il le sait. Il conserve en lui l'amour pour elle et ne s'en libérera jamais à cause de sa part de mystère. Comme chacun d'entre nous, ils ont quelque chose à exorciser, quelque chose à prouver, une vérité à trouver, une vie à sauver, la leur peut-être dont il ne sont que les usufruitiers et qui est si fragile. Pendant l'incarcération de son fils, Irène s'est considérée elle-même comme un otage et elle a revécu les absences de son mari, Louis, qui la trompait avec une autre femme qu'il allait retrouvée au cours de ses voyages. Tous sont d'ailleurs un peu captifs dans cette histoire, à travers leur vécu, leurs liens avec Étienne, leurs projets reportés ou avortés, les silences qui entourent leurs fantasmes, leurs peurs, leurs obsessions. Tous sont libres maintenant et c'est l'eau vive et fraîche du torrent familier qui symbolise le mieux cette liberté. C'est elle qui les réunit chez Irène malgré leur passé parfois tourmenté, leurs regrets et leurs remords, c'est cette liberté qui décidera peut-être de leur avenir. Ce roman aux multiples thèmes témoigne de la violence dont est capable l'homme pour ses semblables, c'est aussi un témoignage sur la solitude dans les combats et les recherches intimes, celles qui caractérisent chacun d'entre nous, même si nous prétendons le contraire, même si nous nous jouons la comédie parce qu'elle fait partie de la condition humaine, qu'elle est inévitable et qu'elle revient toujours.
Je ne suis entré que tard dans ce roman intense, bien écrit et agréable à lire, émouvant et poétique aussi et je ne regrette pas ma persévérance.
© Hervé GAUTIER – Novembre 2016
La honte Annie Ernaux (Gallimard)
C'est bizarre les livres. On leur donne vie après les avoir portés longtemps, ils mûrissent, nous vieillissons et il finissent par sortir, parfois un peu malgré nous, souvent à notre grand étonnement et le point final se met comme de lui-même. Pour eux on sollicite la mémoire, l’imagination, le travail, la documentation et ce souffle un peu bizarre qu'on nomme inspiration sans vraiment êtres capables de le définir. Souvent on fait appel à son histoire personnelle qui se raccroche à des photos, comme ici, la traditionnelle communion solennelle, un voyage en famille, une carte postale. A l’époque de la jeunesse de l'auteure qui est aussi un peu la mienne, les photos étaient en noir et blanc sur papier glacé, avec un rebord dentelé, un cadre blanc et on écrivait souvent au dos, une date ou un lieu… C'était le temps des messes en latin, avec des prières qu'on récitait par cœur sans les comprendre, de la communion reçue à jeun depuis la veille, des dizaines de chapelet ânonnées pour tout et n'importe quoi et dont on finissait par être persuadés qu'elles étaient indispensables à la bonne marche du monde...
L'auteur, fille unique d'une famille de petits commerçants provinciaux, catholiques, conservateurs, a une mère dominatrice et un père soumis mais qui, un jour de colère, menaça de la tuer. Nous sommes en 1952, elle a douze ans et cette scène violente se grava dans sa mémoire au point que, bien des années après, elle en rechercha la trace dans le journal local, vainement évidemment. Poussée par l'envie d'écrire, elle relate cet événement avec une grande économie de mots mais aussi se livre à une étude topographique, sociologique, linguistique, une étude des expressions et comportements sociaux de cette petite ville de Y. qui, au sortir le la guerre, se relève lentement du conflit, de ses bombardements...L'auteure insiste sur ce quartier populeux, à la limite de la campagne, avec sa population ouvrière, ses usages, ses tabous, son rythme de vie pour se concentrer sur la boutique familiale de « l'épicerie-mercerie-café ». Elle y détaille la conduite qui est propre à un petit commerce relative à la discrétion, à la manière de se comporter, de l'image qu'on donne de soi pour éviter la perte de clientèle génératrice de faillite infamante. Dans un autre chapitre elle détaille sa scolarité à l'école privée, ce qui était un privilège à l'époque, puisque payante, où se conjuguaient religion et savoir dans un rythme et des rites immuables, ses interdits, sa hantise de vivre en état de péché mortel, la malédiction de l'école laïque, mais aussi ses hantises de fille, ses règles qui ne viennent pas assez vite, un corps de femme qui prend du retard sur celui des autres… Cela c'était avant, avant cet épisode familial, repris d’ailleurs par un cousin qui a roué de sa tante de coups, un peu comme si quelque chose s'effondrait dans ce décor si bien agencé qu'on eût dit que rien ne pouvait venir le déranger. En même temps, la toute jeune fille qu'elle est encore regarde le monde extérieur avec des yeux curieux et même un peu envieux. Chez elle aussi les choses changent, les goûts s'affirment qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on lui a enseigné à l'école de Dieu, cet établissement que l'élite sociale dont elle ne fait pas vraiment partie, est censée fréquenter. Ainsi la honte tissée dans cet épisode familial se double-t-elle d'une décision, celle de renier un peu ses parents, anciens prolétaires devenus petits commerçants, et la menace que cette honte dure toujours et qu'elle s'impose à elle dans sa permanence [« Il y a ceci dans la honte : l'impression que tout maintenant peut vous arriver, qu’il n'y aura jamais d'arrêt, qu'à la honte il faut encore plus de honte encore. » ]
Il y a cet aspect documentaire intéressant et qu'il ne faut surtout pas négliger dans un tel contexte, surtout vu à travers les yeux d'une petite fille qui découvre le monde. Après ce qui avait introduit ce court roman et qui était bien de nature à traumatiser gravement une enfant de son âge, je me suis interrogé sur le long développement sur son éducation religieuse, sur la vie quotidienne à Y , sur ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas à cette époque, me demandant si elle ne s'écartait pas du sujet. Je m'attendais, légitimement peut-être, à un développement sur la honte comme le titre semble l'indiquer et pourquoi pas sur la culpabilisation si ancrée dans cette société d'après-guerre inspirée par le judéo-christianisme où il fallait se sentir coupable de tout ainsi que le curé de la paroisse le serinait chaque dimanche dans son sermon. Cette honte revient cependant à la fin, d'une manière assez inattendue cependant, à travers l'écriture qui non seulement lui permet de solliciter sa mémoire mais surtout de parvenir peut-être à exorciser le passé, ses mauvais moments surtout. Le temps souvent long qui passe entre ces deux épisodes, celui où l'on vit l'événement et celui où on l'écrit, prend sa vraie signification dans les mots qu'on trace sur la feuille blanche. Pourtant quelque chose m'attire chez cette auteur découverte par hasard, cette faculté particulière qu'elle a de raconter au « premier venu » qu'est le lecteur son vécu, son espoir, son intimité, ses phobies, ses fantasmes…Elle peut sans doute éprouver une certaine honte à écrire mais celle-ci ne sera jamais aussi grande que celle qui l'a envahie lors de cet épisode familial.
Cela dit, j'aime son style, cette phrase fluide, agréable à lire.
© Hervé GAUTIER – Septembre 2016.
Le voyant - Jérôme Garcin (Gallimard)
Jacques Lusseyran (1924-1971) est un élève de huit ans comme les autres et, à la suite d'un accident stupide, une bousculade qui précède la récréation, il perd l'usage de ses yeux. Sa vie aurait pu en être bouleversée mais ce garçon qui porte en lui des qualités exceptionnelles va, au contraire, puiser dans cette infirmité une force peu commune puisqu'il refuse d'y voir un handicap. La guerre le surprend en pleine adolescence. Il est alors élève à Louis-le-Grand mais la loi en vigueur sous Vichy interdit aux handicapés les concours de la fonction publique. Il voit ainsi son rêve 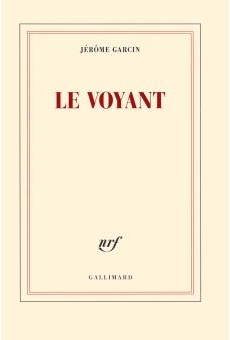 d'enseignant s'effondrer mais cela fait de lui un Résistant chargé du recrutement au sein du mouvement « Défense de la France ». Cela peut paraître paradoxale mais il perçoit, dans la façon de serrer une main, la détermination d'un candidat au combat. Sans qu'il y soit pour rien, c'est pourtant un de ces postulants qui enverra tout son réseau à Buchenvald. Il a à l'époque 20 ans et ne verra rien de l'horreur des camps mais la sentira et, pire peut-être, l'imaginera. Interprète et placé dans la block des invalides, il échappera ainsi aux mauvais traitements et survivra, laissant une œuvre reprise en Allemagne et aux États-Unis, mais pas en France où il sera un auteur sans éditeurs et donc sans lecteurs. On préférait en effet le rescapé à l’écrivain. Pourtant, à son retour du camp, il n'eut droit à rien, ni pension, ni la moindre reconnaissance, sauf la Légion d'honneur et, la loi de Pétain qui interdisait la fonction publique aux invalides n'ayant pas été abrogée, il vit s'évanouir un nouvelle fois son rêve d'enseigner. Un profond traumatisme mental s'ensuivit qui bouleversa sa vie et il rechercha vainement une voie de secours qu'il trouva peut-être dans les sectes ésotériques, dans ses nombreuses aventures féminines et un poste de professeur d'université… aux États-Unis ! Pour lui écrire et aimer étaient synonymes de la vraie vie. A sa mort accidentelle sur une route de France, il avait 47 ans.
d'enseignant s'effondrer mais cela fait de lui un Résistant chargé du recrutement au sein du mouvement « Défense de la France ». Cela peut paraître paradoxale mais il perçoit, dans la façon de serrer une main, la détermination d'un candidat au combat. Sans qu'il y soit pour rien, c'est pourtant un de ces postulants qui enverra tout son réseau à Buchenvald. Il a à l'époque 20 ans et ne verra rien de l'horreur des camps mais la sentira et, pire peut-être, l'imaginera. Interprète et placé dans la block des invalides, il échappera ainsi aux mauvais traitements et survivra, laissant une œuvre reprise en Allemagne et aux États-Unis, mais pas en France où il sera un auteur sans éditeurs et donc sans lecteurs. On préférait en effet le rescapé à l’écrivain. Pourtant, à son retour du camp, il n'eut droit à rien, ni pension, ni la moindre reconnaissance, sauf la Légion d'honneur et, la loi de Pétain qui interdisait la fonction publique aux invalides n'ayant pas été abrogée, il vit s'évanouir un nouvelle fois son rêve d'enseigner. Un profond traumatisme mental s'ensuivit qui bouleversa sa vie et il rechercha vainement une voie de secours qu'il trouva peut-être dans les sectes ésotériques, dans ses nombreuses aventures féminines et un poste de professeur d'université… aux États-Unis ! Pour lui écrire et aimer étaient synonymes de la vraie vie. A sa mort accidentelle sur une route de France, il avait 47 ans.
Paradoxalement peut-être, cette lumière qu'il avait perdue, il la retrouvait en lui-même et sa nuit était pour lui une véritable clarté. Lui qui refusa toujours une canne blanche et usa très tôt d'une machine à écrire ordinaire sut être un chef, et plus tard un professeur, charismatique autant qu'un inspirateur dans ce combat pour la liberté. Il portait en lui un message d'espoir pour tous les aveugles de tous les temps puisque, ainsi, son handicap était pour lui une occasion de « voir autrement ». Paradoxalement, son expérience de Buchenvald lui a redonné le goût de vivre. Son exemple, son œuvre sont sûrement de ceux qui sauvent tous les hommes en perdition et pas seulement ceux qui souffrent de cécité. Il a eu, comme le dit l'auteur « la grande clairvoyance des non-voyants ».
Cette chronique a souvent rendu hommage à Jérôme Garcin pour les écrivains et les hommes oubliés qu'il a sortis de l'ombre. Il l'a toujours fait avec humanité et générosité, en mettant au service de cette « résurrection » sa belle et fluide écriture autant que son travail de méticuleux archiviste. C'est donc un double plaisir à chaque fois que de le lire. C'est un fait, la France qui est, comme l'on lit « le pays de culture », méprise souvent en les oubliant ceux à qui le destin n'a pas donné assez de temps pour s'exprimer. La postérité est parfois ingrate dans la reconnaissance qu'elle distille avec parcimonie et parfois même avec rancœur, décidant, pour des raisons bien souvent futiles de précipiter des êtres exceptionnels dans les bas-fonds de l'oubli en les chargeant au passage de cette injustice qu'est le rejet et qui caractérise l'espèce humaine. Jacques Lusseyran fut de ceux-là qui servirent et honorèrent leur pays par leur action, par leur talent, par leur humanisme. Il puisa sa force dans ce qui aurait pu être une occasion de désolation et de découragement et le portrait émouvant qu'en fait l'auteur ne peut que forcer le respect. Il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui se sont levés face à l'occupant, qui n'ont pas voulu « être du côté du plus fort » mais dont les noms ont malheureusement été oubliés.
J'ai personnellement toujours été à la fois bouleversé, révolté et interrogatif face à la mort d'un être jeune. Certes, il n'a pas eu le temps de s'exprimer complètement, et en ce sens c'est un gâchis, mais aussi il ne s'est pas vu vieillir, n'a pas eu le temps de voir ses forces décliner, son enthousiasme se dissoudre.
Après « Pour Jean Prévost »(prix Médicis 1994) où l'auteur nous parle d'un autre écrivain-Résistant mort les armes à la main au pied du Vercors, Jérôme Garcin signe ici un portrait sans concession et une émouvante évocation d’un homme exceptionnel injustement oublié.
En finir avec Eddy Bellegueule Édouard Louis (Seuil)
« Non les braves gens n'aiment pas que, on suive une autre route qu'eux » chante Brassens. Ce n'est pas vraiment le cas de la famille Bellegueule qui ressemble à s'y méprendre à toutes celles du village, le père qui boit et qui, comme les autres hommes, se partage entre le bistrot et l'usine, le décor c'est les terres agricoles, le ciel plombé, l'air pollué, la pluie et le froid, la maison sans confort et trop petite pour une famille de sept enfants, la pauvreté... La mère souvent enceinte et qui ne lésine pas sur le tabac, la télé qui fonctionne en permanence, l'absence de livres, les ressentiments de chacun contre cette vie, solitude et violence ordinaires qu'on exorcise comme on peut. Dans ce milieu social, il faut ressembler à tout le monde, les hommes sont des durs et quittent l'école pour l'usine et les femmes deviennent caissières, se marient et ont des enfants… Dans tout ce décor, Eddy, l'un des fils, aux gestes efféminés, est une énigme pour cette famille qui l'a élevé comme les autres garçons à qui il ne ressemble pourtant pas. A cause de son aspect maniéré, il est le souffre-douleurs de ses camarades de classe. Ses parents ne comprennent ni n'admettent cette différence, ne se gênent pas pour se moquer de lui en espérant sans doute qu'il rentrera dans le rang, qu'il sera comme les autres et ne leur fera pas honte. Certes ils ne sont pas dupes de l'homosexualité de leur fils, certes ils sont pauvres mais veulent donner une bonne éducation à leurs enfants pour qu'ils ne souffrent pas comme eux de la misère, qu'ils n’aient pas à faire face au regard réprobateur des gens, qu'ils échappent à l'alcoolisme… Le racisme ordinaire du père, son intolérance ne l’empêchent pas de défendre Eddy même quand aucun doute n'est plus possible à son sujet, que son attirance sexuelle pour les hommes est un fait indéniable et qu'il est désormais, pour cette raison, en bute aux lazzis de autres. Il tentera bien vainement des expériences féminines autant pour donner le change que pour vérifier ce qu'il savait déjà, mais ne trouvera son salut que dans la fuite de cette famille qui l'aime pourtant mais dans laquelle il ne se reconnaît plus. Ce sera le théâtre puis plus tard les études supérieures, autant de voies auxquelles il n'avait sans doute pas pensé . C'est à la fois un éveil à une autre vie, à la connaissance et à la culture mais aussi l'accès à un monde où il est accepté où il ne sera plus jamais taxé de « pédé ».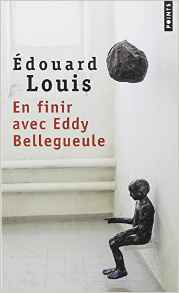
Ce roman en forme de biographie, divisé en deux parties, se déroule en Picardie dans les années 1990, date à laquelle l'homosexualité était moins admise qu'aujourd'hui. Il y analyse la prise de conscience progressive d'un adolescent de son attirance pour les hommes. Il y décrit crûment et sans complaisance une classe ouvrière minée par l'alcoolisme, la xénophobie, l'intolérance, l'absence de culture dans une région qui, par la suite, n'a pas été épargnée par crise économique.
Il est généralement admis que chacun a de bons souvenirs de son enfance. C'est là une idée reçue qui m'a toujours étonné puisque la mienne n'a pas été marquée par le sceau du bonheur. Les circonstances ont certes été bien différentes et surtout en rien transposables à celles de ce roman, mais lire sous la plume d'un auteur un tel témoignage me rassure un peu. Je finissais par me demander si mon cas avait quelque chose d'exceptionnel.
Reste le titre qui sonne comme une page qu'on tourne et j'ai bien eu l' impression de que cette période de sa vie appartenait pour lui à un passé révolu. L'écriture est reconnue pour ses qualités cathartiques. Je ne sais si ce livre a changé la vie de l'auteur (en dehors du succès littéraire qu'il a suscité), s'il a correspondu à une réelle libération (« la force végétale de l'enfance subsiste en nous toute la vie » dit Gaston Bachelard) où s'il a exploité ce moment délétère de sa vie pour entrer en littérature puisque c'est là son premier roman, mais ces pages résonnent en moi avec des accents de sincérité. Il reste que si ses parents correspondent au portrait qu'il en a fait, je les imagine partagés entre la fierté d'avoir un fils écrivain célèbre et les révélations qu'ils ont lues dans son livre.
C'est un roman qui se lit rapidement, un style sans fioriture littéraire, écrit à la première personne, entre témoignage et confidence. Pour autant il y a une sorte de double niveau dans le langage. D'une part l'auteur s'exprime simplement et d’autre part il rend compte des propos de ceux qui l'entourent et qu'il transcrit sans artifice. Cette différence se lit dans le graphisme du texte.
© Hervé GAUTIER- Juin 2016
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle - J d'Ormesson
Tout au long d'un improbable procès, dont on se doute qu'il sortira acquitté, où il est à la fois le juge et l'accusé, Jean d'Ormesson, bien qu'il s'en défende, si on en juge d'après ses propos dans la presse et même sur la quatrième de couverture, nous offre un livre de Mémoires. Dans cette même quatrième de couverture il demande qu'on ne compte pas sur lui pour livrer des souvenirs d'enfance et de jeunesse... mais se dépêche de faire le contraire ! Et pour faire bonne mesure, il en rajoute un peu sur le thème déjà bien sollicité de la « saga » familiale. C'est un véritable monologue, camouflé sous des dehors peu crédibles (Moi, et Moi souvent rebaptisé Sur-moi), une sorte de dédoublement de la même personne qui fait en alternance les demandes et les réponses, dans le seul but de satisfaire sa grande passion, : nous parler de l'auteur, de sa vie, de ses livres...Encore une fois, comme c'est souvent le cas chez lui, nous assistons à un exercice, certes brillant et passionnant, mais fortement inspiré par le solipsisme! Qu'il appartienne à une grande famille aristocratique, avec tous les attributs de celle-ci, qu'il ait lui-même mené une vie pleine de réussite professionnelle, artistique, culturelle, personnelle… sa dimension entretenue de personnage public le laisse penser, et qu'il puisse, à son âge avancé (90 ans), considérer ce parcours comme beau, est parfaitement admissible ; nous eussions été surpris du contraire, nous ses lecteurs. Il égrène donc pour nous ses souvenirs puisés dans la politique, l'histoire, la littérature, le journalisme et l'amour, un parcours aussi brillant que protéiforme, mais la modestie un peu feinte dont il souhaite se parer me semble un peu fausse quand même. Même s'il voudrait bien donner l'impression de n'être pas grand-chose on sent bien, à le lire, qu'il est conscient de n’être pas comme tout le monde. Il s'exprime avec prolixité et j'ai craint au début de m’ennuyer tout au long de ces presque cinq cents pages mais finalement l'intérêt a pris le dessus, preuve s'il en fallait une qu'il n'est effectivement pas un vulgaire quidam. Il s'exprime avec son érudition coutumière et avec cette langue française dont il est un des meilleurs serviteurs, et c'est bien entendu un plaisir de le lire.
Il nous confie son admiration pour les hommes qui bien souvent furent ses maîtres et parfois ses amis et pour les femmes qui ne furent pas toutes ses maîtresses mais dont la beauté sut l'émouvoir. Certes il a commis des fautes et les confesse sans détour mais c'est aussi une manière de se mettre en valeur. Il parle aussi, bien sûr, de l'Académie dont rêve tout écrivain. Il y siège depuis longtemps, Immortel que ces lieux impressionnent, mais qui aurait ressenti comme une insulte personnelle de n'y pas figurer simplement peut-être pour que son nom et son œuvre ne soient pas oubliés définitivement avec sa mort. De cette vénérable institution, dont il fut le plus jeune académicien et dont il est maintenant le doyen, il parle comme d'une assemblée de notables des Lettres mais aussi d'un repère de trublions, friands de petites avanies ou de blagues de potaches, l'esprit en plus, évidemment ! S'il sait reconnaître ceux qui l'ont aidé, c'est aussi une manière de dire que ceux-là ne se sont pas trompés et que, lui donnant leur appui, ils l'ont fait pour un être exceptionnel, c'est à dire lui ! Au cours de ce procès un peu surréaliste où on se demande bien ce qui lui est au juste reproché, à part peut-être avoir existé, il en profite pour réaffirmer son amour du monde, de la vie, pour déplorer un nouvelle fois la condition humaine dans tous ses aspects, la naissance par hasard, le temps qui passe et la mort inévitable, pour réaffirmer sa croyance en Dieu comme il l'avait fait notamment dans « Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit ». Je ne le connais qu'à travers ses livres, c'est à dire mal, mais il me semble qu'il est friand de reconnaissance, avec tout ce que cela comporte de rituels et même d'hypocrisie mais j'avoue qu'il joue parfaitement son rôle dans ce procès imaginaire.
Ce livre qui, encore une fois, emprunte son titre à un vers d'Aragon nous montre sans fard un écrivain mondain, narcissique quelque peu vaniteux mais qu'importe. Pour d'Ormesson, parler de lui est une institution et il est vrai qu'il le fait bien et il sait captiver son lecteur. C'est peut-être l'homme d'un seul livre dont Saint Augustin conseillait qu'on se méfiât. Et après ! Je dois dire en revanche que la fin de ce procès tient un peu de la pantalonnade. Dans la troisième partie, il tire le bilan de sa vie et jette sur le monde qui l'entoure un regard désabusé, serein penseront certains, face à ses changements rapides, à ses oscillations perpétuelles entre ascension et déclin, génératrices de progrès mais aussi de souffrances. Il pense à sa propre mort et en vient même à penser que ce Dieu en Qui il croit n'existe peut-être pas !
Olype de Gouges Catel & Bocquet (Casterman écritures)
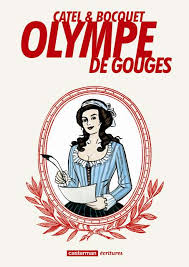 Étonnant parcours que celui de Marie Gouze (1748-1793) qui prendra comme nom de plume Olympe de Gouges, fille bâtarde d'Anne-Olympe Mouisset et du marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, futur académicien, mariée à seize ans elle sera veuve deux fois et à dix-huit ans pourra jouir de sa dot et d'une indépendance que sa nouvelle condition lui confère et dont elle va profiter. Elle ne se remariera plus ! Elle fut une femme de Lettres passionnée de théâtre, de politique et de liberté dans une société où une femme ne pouvait qu'être sous la dépendance d'un homme, féministe, polémiste, révolutionnaire, morte guillotinée… Son authentique et passionnante biographie est détaillée à la fin de cet ouvrage et romancée en trente et un tableaux, au long de ces quatre cents pages.
Étonnant parcours que celui de Marie Gouze (1748-1793) qui prendra comme nom de plume Olympe de Gouges, fille bâtarde d'Anne-Olympe Mouisset et du marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, futur académicien, mariée à seize ans elle sera veuve deux fois et à dix-huit ans pourra jouir de sa dot et d'une indépendance que sa nouvelle condition lui confère et dont elle va profiter. Elle ne se remariera plus ! Elle fut une femme de Lettres passionnée de théâtre, de politique et de liberté dans une société où une femme ne pouvait qu'être sous la dépendance d'un homme, féministe, polémiste, révolutionnaire, morte guillotinée… Son authentique et passionnante biographie est détaillée à la fin de cet ouvrage et romancée en trente et un tableaux, au long de ces quatre cents pages.
Son parcours, de Montauban à Paris a été semé d’embûches, de rumeurs calomnieuses mais aussi de belles rencontres, de pièces de théâtre dont elle était l'actrice mais surtout l'auteure. Elle a effectivement été libre et même libertine voire scandaleuse mais a profité d'un riche amant qui lui a permis de vivre fort confortablement dans la capitale en compagnie de son fils Pierre dont elle a soutenu la carrière. Elle était cultivée, pleine d'esprit et de reparties, et douée d'une bonne plume. Elle a à la fois fréquenté les salons parisiens où elle n'a pas manqué, malgré son accent rocailleux, de s'y faire accepter et d'y briller et a fait évoluer les mentalités sur la société, l’esclavage, l'émancipation du peuple, la condition des femmes et la reconnaissance politique de leurs droits, notamment celui de voter, d'être éduquées et de divorcer. Elle a en effet pris conscience que l'affranchissement récent des hommes du peuple s'est fait aux dépens des femmes qui ainsi furent les oubliées de cette révolution. Elle est en effet à l'origine de la « déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » qui fut ignorée bien qu'elle soit dans le droit fil des idées nouvelles mais que les révolutionnaires comme le roi, qu'elle respectait et courtisait, ont refusée. Donner le pouvoir aux femmes n'était pas dans les projets du législateur et la libération des hommes n’incluait pas celle des femmes qu'il convenait de maintenir dans leur état de subordination ancestral ! Si elle a su s'imposer dans la société de l'Ancien Régime et y faire prévaloir son talent, avec, il faut le dire, une bonne dose d'opportunisme, la Révolution qu'elle avait pourtant appelée de ses vœux, qu'elle avait inspirée et dont elle avait souhaité ardemment la réussite, fut fatale à la patriote passionnée par ses idées qu’elle était devenue. Pour elle aussi la roche Tarpéienne fut proche du Capitole, ce qui est bien souvent la rançon du succès et une des leçons de la condition humaine. Elle vécut la trahison, la palinodie des révolutionnaires, participa à sa manière à la chute de ses meneurs, se fit journaliste pour dénoncer les dérives sanguinaires de la Terreur, prit parti pour les Girondins, s’offrit à être l'avocat de Louis XVI mais fut victime de sa notoriété et de sa soif de changement.
Le graphisme en noir et blanc aurait peut-être mérité un peu plus de détails notamment sur les visages.
C'est un roman graphique, et non pas une BD (quoique je ne ne fasse pas bien la différence) mais ce que je retiens c'est que cette histoire passionnante se lit bien et surtout rend hommage à cette femme d'exception, fort belle, généreuse et altruiste, qui fut pleinement de son temps, fut une amoureuse de la vie, sut s'adapter à cette période troublée de notre histoire en y survivant un temps et marqua son époque.
Hervé GAUTIER – Mars 2016
BILQISS Saphia Azzeddine - Stock
 Bilqiss, c'est le nom de cette femme insoumise, veuve, sans enfant et sans famille, qui, un matin alors que le muezzin dort encore, en proie à une cuite(!), monte en haut du minaret et appelle à la prière (adhan) à sa manière, c'est à dire avec sa sensibilité de femme et de croyante sincère. Dans ce pays imaginaire (l'Afganistan ?) mais quand même bien réel où il vaut mieux être n'importe quoi, un volatile par exemple, qu'une femme, un tel acte est sacrilège. Elle va donc être jugée et bien entendu lapidée parce que sa seule faute est de vivre seule dans une société qui ne veut pas d'elle parce qu'elle met en danger son équilibre. C'est que non seulement elle a ainsi enfreint la loi mais aux yeux des croyants il y a en outre des circonstances aggravantes. Elle possède en effet dans son réfrigérateur des courgettes et des aubergines entières pour sa nourriture mais qui, pour ses juges, évoquent des symboles phalliques, une pince à épiler, du maquillage, des soutiens-gorges, des livres et de la musique ce qui constitue un crime impardonnable aux yeux des habitants du village. Pire peut-être, elle reconnaît les faits et se défend, seule sans pour autant renier Allah !
Bilqiss, c'est le nom de cette femme insoumise, veuve, sans enfant et sans famille, qui, un matin alors que le muezzin dort encore, en proie à une cuite(!), monte en haut du minaret et appelle à la prière (adhan) à sa manière, c'est à dire avec sa sensibilité de femme et de croyante sincère. Dans ce pays imaginaire (l'Afganistan ?) mais quand même bien réel où il vaut mieux être n'importe quoi, un volatile par exemple, qu'une femme, un tel acte est sacrilège. Elle va donc être jugée et bien entendu lapidée parce que sa seule faute est de vivre seule dans une société qui ne veut pas d'elle parce qu'elle met en danger son équilibre. C'est que non seulement elle a ainsi enfreint la loi mais aux yeux des croyants il y a en outre des circonstances aggravantes. Elle possède en effet dans son réfrigérateur des courgettes et des aubergines entières pour sa nourriture mais qui, pour ses juges, évoquent des symboles phalliques, une pince à épiler, du maquillage, des soutiens-gorges, des livres et de la musique ce qui constitue un crime impardonnable aux yeux des habitants du village. Pire peut-être, elle reconnaît les faits et se défend, seule sans pour autant renier Allah !
Bilqiss [qui porte le même nom que la reine de Saba] n’est cependant pas le seul personnage de ce roman puisqu'une journaliste américaine, fille d'un milliardaire, suit ce procès pour son journal, lui donne une médiatisation mondiale et s'imagine qu'elle pourra faire évoluer les choses. Le juge est troublé par la beauté et la personnalité de Bilqiss qu'il connaît mais qu'il doit condamner et ne sait plus quoi faire, coincé qu'il est par sa position dominante et l'envie irrépressible qu'il a de la sauver. Il fait traîner le procès en longueur en lui concédant le droit à la parole dont elle profite en dénonçant les contradictions de cette société, lui rend visite dans sa prison mais n’oublie pas de la faire fouetter pour la pertinence et l'impertinence de ses propos. Cette trilogie tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin et suscite une réflexion sur la place de la femme dans cette société faite par et pour les hommes, le mariage forcé des filles en bas âge et leur maintien dans un état de servilité dramatique, la présence d'Allah et la réalité des abus qu'on commet en son nom, sous couvert de la loi islamique, l'amour impossible entre ce juge et celle qu'il doit condamner. Cette jeune femme a seule tenu tête aux hommes du village et aussi au juge, ce qui, en soi, est déjà un crime, a voulu faire prendre conscience aux autres femmes de la nécessité de s'affirmer, de sortir de leur condition, respecte la religion mais remet en cause ses déviances que les hommes se sont appropriées à leur seul bénéfice.
Cet ouvrage est classé dans la catégorie « roman », pourtant, je l'ai lu comme un livre documentaire (bien qu'il se termine quand même comme un roman) qui en dit long sur une religion que je ne connais que par oui-dire mais qui officialise le calvaire domestique et quotidien de la femme musulmane que son mari tient pour sa bonniche, uniquement destinée à enfanter, des mâles de préférence, qu'il bat et dont il abuse à son gré. Quand à l'amour que nous, occidentaux, célébrons et privilégions comme une valeur et un sentiment, il vaut mieux n'y pas penser. J'ai lu que les fondamentalistes nient la culture et la liberté au profit d'un dogme religieux aveugle et quand j'entends que ces mêmes islamistes qui viennent chez nous poser des bombes et tuer des innocents simplement parce qu'ils sont incroyants, souhaitent importer en occident ce qu'on a du mal à appeler des « valeurs », cela me fait un peu peur quand même ! J'ai pu voir aussi que ces hommes qui se recommandent de Dieu sont tout aussi hypocrites que le sont nos ecclésiastiques occidentaux et je me souviens que les religions ont été au cours de notre histoire un malheureux prétexte donné aux hommes pour régresser intellectuellement et moralement, exacerber leur volonté de puissance mais aussi pour s’entre-tuer. La justice est rendue au nom d'Allah, mais il n'y a pas si longtemps en France, des crucifix ornaient encore les prétoires et on prêtait serment sur l’Évangile. Quant aux exécutions publiques qu'on peut dénoncer dans ces pays comme un spectacle malsain, elles ont fait partie du nôtre également . Certes les choses ont heureusement changé mais l’espèce humaine, elle, aura du mal évoluer et Bilqiss ne se gêne pas pour le faire remarquer à cette journaliste américaine en lui rappelant que son reportage en sa faveur n'était peut-être pas dénué d'arrière-pensées et certaines de ses remarques sur la présence des troupes occidentales dans son pays sont aussi pertinentes que celles qu'elle adresse au juge sur la religion et la société .
En lisant ce texte, avec effroi mais aussi une certaine crainte que le laxisme de nos démocraties n’entrouvre la porte à ce système juridico-religieux et ne détruise durablement notre art de vivre, je n'ai pu oublier que la beauté des femmes est chez nous non seulement un prétexte à la création artistique mais aussi, à titre personnel, une formidable illumination du quotidien. Si Dieu existe les femmes sont assurément la meilleure réussite de la Création mais j'observe que les religions que je connais (celles du Livre) leur font une bien piètre place ! Je me plais à me souvenir du vers d'Aragon "L'avenir de l'homme, c'est la femme. Elle est la couleur de son âme."
© Hervé GAUTIER – Janvier 2016
LE BAR SOUS LA MER Stefano BENNI Actes Sud
 Traduit de l'italien par Alain Sarrabayrouse
Traduit de l'italien par Alain Sarrabayrouse
D'emblée, le lecteur est invité à entrer dans ce recueil de nouvelles un peu étrange. En effet, le narrateur raconte une rencontre, un soir, au bord de la mer. Il aperçoit un vieil homme qui entre dans l'eau. Croyant à un suicide, il tente de le sauver mais se retrouve, à sa suite, dans un bar sous la mer où chaque client se met à lui raconter une histoire plus abracadabrantesque que la précédente, tissant dans ce lieu incertain une sorte de halo mystérieux, entre surréalité et cuisine gourmande. Ce sont d'ailleurs les personnages qui sont dessinés sur la couverture du livre. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires mais aussi un chien, sa puce et, bien entendu, une sirène. Chacun y va de son récit, aussi déjanté qu'irréel, et dessine un univers labyrinthique où le sérieux le dispute à l'humour, sans qu'on sache exactement faire la part des choses… Mais cela a-t-il vraiment de l'importance ? L'auteur ne fait évidemment pas l'économie d'une galerie de portraits dont les noms improbables vous transportent dans un ailleurs assez indistinct où les animaux parlent et se transforment à l'envi mais où j'ai trouvé mes marques sans aucune difficulté.
On y fait des découvertes bizarres comme ces animaux qui vivent entre ces pages et qui sont friands de mots. Vous avez bien compris, ils les mangent ! Certains ont une appétence particulière pour les consonnes redoublées, les signes de ponctuation ou les verbes désormais inusités, quand ils ne s'attaquent pas à la syntaxe ou aux verbes conjugués à l'imparfait du subjonctif ! Cela donne évidemment un texte complètement fou, des jeux de mots, des phrases un peu bouleversées à l'architecture bousculée … J'ai bien aimé aussi « Le samedi porno du Rex », pas pour son côté salace d'ailleurs absent, mais seulement pour l'humour du texte.
Le style est jubilatoire, enjoué, burlesque, s'attachant, son lecteur dès la première ligne sans que l'intérêt suscité dès l'abord ne disparaisse. le texte est « cultivé », plein d'enseignements, léger et les thèmes traités le sont d'une manière originale, témoin cette version très personnelle de Moby Dick ou cette visite forcée et nocturne dans une mystérieuse maison au bien étrange occupant. L'auteur ne néglige aucun détail dans la description des situations ou l'évocation des personnages, use volontiers de l'analepse, ce qui contribue à tisser un décor qui, peu à peu, devient familier au lecteur.
Stephano Benni est un remarquable conteur. Il distille des histoires extraordinaires sans être morbides, extraterrestres, extra humaines dans lesquelles je suis entré de plain-pied avec délice. Je ne sais pas si le monde dans lequel nous vivons tous m'est à ce point indifférent voire désagréable mais l'univers de Benni que j'ai juste entraperçu ici me plaît bien et je m'y réfugie volontiers. J'embarque avec lui dans son voyage et j'ai plaisir à explorer, à son invite, cet univers onirique d'invétérés raconteurs d'histoires, un peu mythomanes quand même et pour le moins décalés et je suis sûr que, avec moi, vous en redemanderez ! D'ailleurs, cette incursion dans un lieu sous-marin, un bar où, dit-on les langues se délient plus facilement, les relations se tissent plus aisément, serait-elle pour le lecteur une invitation à se maintenir dans un lieu intermédiaire, une sorte de monde fait de mots, d'idées et de situations différentes du nôtre, une manière d'être autrement, une antidote bienvenue à notre quotidien ordinaire, une sorte de chance donnée à chacun des clients de révéler sa vision du monde ?
C'est vrai que dans ce recueil, nous ne sommes pas exactement sur terre !
©Hervé GAUTIER – Janvier 2016
DANS LES BOIS ETERNELS Fred Vargas (Ed. Viviane Hamy)
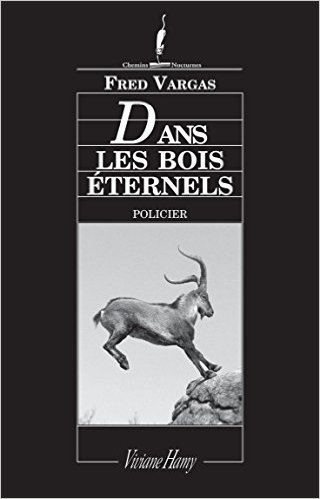 Elle est bizarre cette histoire qu'il est difficile et sûrement inutile de résumer tant elle est compliquée. D'ordinaire, on se débarrasse volontiers d'une affaire délicate en la refilant à un autre. Ici, le commissaire Adamsberg insiste lourdement pour se faire attribuer le meurtre de deux petits dealers parfaitement inconnus mais que revendique la « Brigade des Stups ». C'est oublier un peu vite qu'il est têtu, mais têtu comme un Béarnais, ce qui n'est pas peu dire et ce d'autant plus qu'il vient de croiser un peu par hasard Ariane, la médecin légiste qu'il a connue dans une autre vie, il y a bien longtemps. Il a décidé qu'elle serait une adjointe précieuse dans cette affaire et elle lui livre effectivement des indices intéressants sur ces deux victimes. Elle réussit même à le convertir à sa théorie sur les meurtriers « dissociés » dont pourrait bien faire partie une vieille infirmière, récemment échappée d'une prison allemande, et qui, selon la légiste, ferait une coupable très présentable. Il la mettrait bien dans son lit, cette Ariane, mais ses relations avec les femmes sont compliquées, un peu comme celles qu'il a avec Camille, son épouse, la mère de son enfant mais dont il est actuellement séparé. Elle prend de plus en plus la forme et la consistance d'une ombre, un peu comme celle qui hante la maison que le commissaire a choisi d'habiter et que tout le monde évite à cause justement de ce fantôme. Obnubilé par cette idée, il ira pour autant la rechercher bien loin de Paris, cette silhouette grise qui est liée à cette affaire, à tout le moins le pense-t-il, mais toujours dans des cimetières, à déterrer des cercueils de femmes vierges.
Elle est bizarre cette histoire qu'il est difficile et sûrement inutile de résumer tant elle est compliquée. D'ordinaire, on se débarrasse volontiers d'une affaire délicate en la refilant à un autre. Ici, le commissaire Adamsberg insiste lourdement pour se faire attribuer le meurtre de deux petits dealers parfaitement inconnus mais que revendique la « Brigade des Stups ». C'est oublier un peu vite qu'il est têtu, mais têtu comme un Béarnais, ce qui n'est pas peu dire et ce d'autant plus qu'il vient de croiser un peu par hasard Ariane, la médecin légiste qu'il a connue dans une autre vie, il y a bien longtemps. Il a décidé qu'elle serait une adjointe précieuse dans cette affaire et elle lui livre effectivement des indices intéressants sur ces deux victimes. Elle réussit même à le convertir à sa théorie sur les meurtriers « dissociés » dont pourrait bien faire partie une vieille infirmière, récemment échappée d'une prison allemande, et qui, selon la légiste, ferait une coupable très présentable. Il la mettrait bien dans son lit, cette Ariane, mais ses relations avec les femmes sont compliquées, un peu comme celles qu'il a avec Camille, son épouse, la mère de son enfant mais dont il est actuellement séparé. Elle prend de plus en plus la forme et la consistance d'une ombre, un peu comme celle qui hante la maison que le commissaire a choisi d'habiter et que tout le monde évite à cause justement de ce fantôme. Obnubilé par cette idée, il ira pour autant la rechercher bien loin de Paris, cette silhouette grise qui est liée à cette affaire, à tout le moins le pense-t-il, mais toujours dans des cimetières, à déterrer des cercueils de femmes vierges.
Comme rien n'est simple, cette enquête emmène toute la brigade au cimetière de Montrouge, à la recherche de petits cailloux et de terre logée sous les ongles des deux victimes, ce qui se traduit par l'ouverture d'une tombe et des hypothèses qui paraissent bien légères ! C'est que le commissaire Adamsberg est comme un père pour chaque membre de cette brigade qui le suit aveuglement sans poser aucune question. Les liens qui les unissent son très forts et notamment ceux qui lient le lieutenant Retancourt, une jeune femme imposante mais indispensable au commissaire depuis une aventure canadienne constamment rappelée dans ce roman. C'est aussi sans compter aussi sur le commandant Danglard, érudit alcoolique dont les connaissances étonnent toujours le commissaire et qui lui aussi à un rôle de protecteur. D'ailleurs dans cette brigade comme dans une véritable famille les agents sont solidaires et chacun protège l'autre. Comme dans chaque brigade, il y a toujours le nouveau, celui qu'il faut former et qui bien souvent entrave la bonne marche des choses par ses questions. Ici le Nouveau (avec une majuscule) c'est Veyrenc, un Béarnais lui aussi qui n'est pas exactement un nouveau puisqu'il est policier depuis quelques années déjà, a été enseignant, semble égaré dans la police avec ses cheveux bicolores, cette passion pour Racine et cette manie bien étrange de ne s'exprimer qu'en alexandrins. Est-ce une coïncidence, mais sa présence ici ne doit rien au hasard et il réveille par sa seule présence des souvenirs d'enfance que Adamsberg croyait évanouis et en tout cas qu'il aurait bien voulu oublier.
On va de fausses pistes en histoires abracadabrantesques, empruntées au présent, au passé ou à l'imagination comme ces palabres incertains et apparemment inutiles sur l'os du groin de porc, l'os pénien du chat, le pillage des reliquaires religieux, la recette de la vie éternelle quêtée dans des grimoires, les bois de cerf, la recherche d'hypothétiques femmes vierges dans le département de l'Eure, l'inspiration que trouve le commissaire dans le vol des mouettes sur la Seine ou en pelletant les nuages… Bref l'enquête s'enlise chaque jour un peu plus et les policiers de la brigade doutent ! Mais après tout ce n'est pas autre chose que la réalité avec son droit imprescriptible à l'erreur. Peut-être pas tant que cela cependant puisqu'il est vrai que la vengeance se nourrit de la mémoire et la fausse piste de la mystification !
On ne s'ennuie vraiment pas dans un roman de Fred Vargas et quand c'est fini ça recommence, les impasses ne sont qu'apparentes et l'auteur tient son lecteur en haleine jusqu'à la fin. C'est bien écrit et c'est passionnant.
Hervé GAUTIER – Décembre 2015
TRAITE SUR LA TOLERANCE - Voltaire (Gallimard)
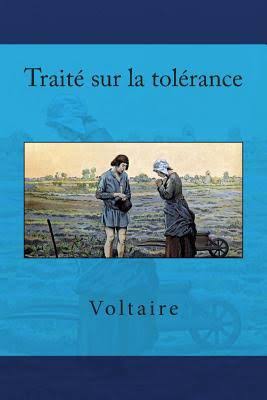 Voltaire est sans doute l'écrivain français dont la pensée et la personnalité ont le plus largement rayonné à l'extérieur comme à l’intérieur de son pays même si on ne retient bien souvent de son œuvre que « Candide ». Il a incarné ce qu'on nomme « Le siècle des Lumières » qui a annoncé le grand changement de la Révolution et quand on parle de lui on pense inévitable au Français à qui ses personnages ressemblent. C'est vrai qu'il s'est largement mis à dos pas mal de ses contemporains, les religieux, les jésuites et les jansénistes surtout, les militaires, les juges, les écrivains, les philosophes... C'est que l’homme était volontiers frondeur, doutait systématiquement des choses établies et ne manquait jamais d'exercer son esprit critique en dénonçant l'absurdité du monde. Il était avant tout attaché à la raison, à la liberté et à son corollaire, la tolérance. Dès lors qu'il avait posé cela, l'histoire lui fournissait la matière à polémiquer, à dénoncer toutes les formes d'intolérance et il ne pouvait que combattre la religion et l'injustice. Il ne devait donc pas laisser passer l'occasion donnée par l'affaire Calas, ce protestant toulousain condamné à mort et exécuté parce qu'on le soupçonnait d’avoir tué son fils qui voulait se convertir au catholicisme. En réalité le fils Calas qui s'était déjà converti, s'était pendu parce qu'il ne pouvait devenir avocat à cause de sa confession protestante. Cette interdiction était la conséquence de la politique de Louis XIV aggravée d'ailleurs sous son successeur. L'intolérance avait ainsi non seulement provoqué le suicide du fils mais par le biais de la condamnation prononcée par la justice, l'exécution du père contre toute logique. Ainsi le fanatisme du peuple attisé par l’Église, généra l’intolérance donc l'abus de pouvoir du tribunal au mépris de la vie. C'est Voltaire seul et déjà âgé (il a à l'époque 70 ans, il mourra à 84 ans)qui obtiendra sa réhabilitation après trois ans d'efforts. C'était pour lui combattre le fanatisme des deux religions, catholique comme huguenote, mais aussi l'iniquité de la justice qui le condamna. Ainsi dans la première partie de son ouvrage montre-il combien, dans l'histoire, l'intolérance et le fanatisme religieux se sont révélés néfastes pour la société. Dans la seconde partie, s'adressant aux sectaires de toutes les religions puis aux chrétiens, il plaide en faveur de la tolérance(« Moins de dogmes, moins de disputes; et moins de disputes moins de malheurs : si cela n'est pas vrai, j'ai tort ».) autant qu'il prône une religion naturelle qui, loin des dogmes qui divisent, a pour effet de rassembler les hommes, de les unir. Voltaire mena le dossier comme un avocat de la défense, combattant la vérité officielle mais son action ne s’arrêta cependant pas là et il ouvrit aussi largement aux victimes les portes de sa demeure de Ferney. Ainsi le libertin, le dilettante, le courtisan, le philosophe, le pamphlétaire, laissèrent-ils la place au polémiste qui agissait au nom des droits de l'homme avant la lettre et il milita par une action engagée en faveur de Sirven, du Chevalier de La Barre, de Montbailli, de Lally-Tollendal. Cet ouvrage, ainsi que d'autres qui suivront, réclament également une réforme de la justice, l'indépendance et la formation des juges et non plus l’achat de leur charges, la preuve de la culpabilité et l'abolition de la « question », des peines proportionnées aux crimes et aux délits...
Voltaire est sans doute l'écrivain français dont la pensée et la personnalité ont le plus largement rayonné à l'extérieur comme à l’intérieur de son pays même si on ne retient bien souvent de son œuvre que « Candide ». Il a incarné ce qu'on nomme « Le siècle des Lumières » qui a annoncé le grand changement de la Révolution et quand on parle de lui on pense inévitable au Français à qui ses personnages ressemblent. C'est vrai qu'il s'est largement mis à dos pas mal de ses contemporains, les religieux, les jésuites et les jansénistes surtout, les militaires, les juges, les écrivains, les philosophes... C'est que l’homme était volontiers frondeur, doutait systématiquement des choses établies et ne manquait jamais d'exercer son esprit critique en dénonçant l'absurdité du monde. Il était avant tout attaché à la raison, à la liberté et à son corollaire, la tolérance. Dès lors qu'il avait posé cela, l'histoire lui fournissait la matière à polémiquer, à dénoncer toutes les formes d'intolérance et il ne pouvait que combattre la religion et l'injustice. Il ne devait donc pas laisser passer l'occasion donnée par l'affaire Calas, ce protestant toulousain condamné à mort et exécuté parce qu'on le soupçonnait d’avoir tué son fils qui voulait se convertir au catholicisme. En réalité le fils Calas qui s'était déjà converti, s'était pendu parce qu'il ne pouvait devenir avocat à cause de sa confession protestante. Cette interdiction était la conséquence de la politique de Louis XIV aggravée d'ailleurs sous son successeur. L'intolérance avait ainsi non seulement provoqué le suicide du fils mais par le biais de la condamnation prononcée par la justice, l'exécution du père contre toute logique. Ainsi le fanatisme du peuple attisé par l’Église, généra l’intolérance donc l'abus de pouvoir du tribunal au mépris de la vie. C'est Voltaire seul et déjà âgé (il a à l'époque 70 ans, il mourra à 84 ans)qui obtiendra sa réhabilitation après trois ans d'efforts. C'était pour lui combattre le fanatisme des deux religions, catholique comme huguenote, mais aussi l'iniquité de la justice qui le condamna. Ainsi dans la première partie de son ouvrage montre-il combien, dans l'histoire, l'intolérance et le fanatisme religieux se sont révélés néfastes pour la société. Dans la seconde partie, s'adressant aux sectaires de toutes les religions puis aux chrétiens, il plaide en faveur de la tolérance(« Moins de dogmes, moins de disputes; et moins de disputes moins de malheurs : si cela n'est pas vrai, j'ai tort ».) autant qu'il prône une religion naturelle qui, loin des dogmes qui divisent, a pour effet de rassembler les hommes, de les unir. Voltaire mena le dossier comme un avocat de la défense, combattant la vérité officielle mais son action ne s’arrêta cependant pas là et il ouvrit aussi largement aux victimes les portes de sa demeure de Ferney. Ainsi le libertin, le dilettante, le courtisan, le philosophe, le pamphlétaire, laissèrent-ils la place au polémiste qui agissait au nom des droits de l'homme avant la lettre et il milita par une action engagée en faveur de Sirven, du Chevalier de La Barre, de Montbailli, de Lally-Tollendal. Cet ouvrage, ainsi que d'autres qui suivront, réclament également une réforme de la justice, l'indépendance et la formation des juges et non plus l’achat de leur charges, la preuve de la culpabilité et l'abolition de la « question », des peines proportionnées aux crimes et aux délits...
La tolérance qu'il réclame et qui sous-tend évidemment à la liberté d'expression, ne trouve pas à s'appliquer seulement contre les fanatiques religieux qui assassinent tous ceux qui ne pensent pas comme eux mais aussi à l'encontre de tout ce qui s'oppose à la liberté de penser quelque forme qu'elle prenne et de quelque bord qu'elle vienne. Ce livre prend actuellement un relief tout particulier et le pamphlet qu'il mène à son époque contre les catholiques et plus précisément contre les abus de l’inquisition, est aisément transposable aujourd'hui. Voltaire ne fut certes pas le premier ni le seul à combattre l'instinct grégaire et la pensée unique mais il fut un véritable « lanceur d'alerte » qui suscita dans l'opinion une prise de conscience contre l'injustice et l'intolérance. Son influence s'est manifestée dans bien des domaines et il eut, sans le savoir, beaucoup de disciples. C'est aussi l'esprit de l'auteur du « Traité sur la Tolérance » qui renaît aujourd'hui dans cette affirmation qui a fleuri dans les rues et dans les médias français. Malheureusement ces attaques contre la liberté ont tendance à se reproduire dans les démocraties que le fanatisme religieux attaque parce qu'elles sont justement plus tolérantes. Être Charlie c'est aussi un peu être Voltaire.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2015
Boussole Mathias Enard (Actes Sud)
L'Orient a toujours fasciné les occidentaux. Frantz Ritter, le narrateur, universitaire orientaliste, un peu mélancolique, valétudinaire et opiomane d'occasion, n'échappe pas à cette évidence, non seulement à travers la musique dont il est spécialiste et qu'il cite volontiers, mais aussi sans doute parce qu'il habite Vienne et que cette ville est censée, pour des raisons un peu obscures, être la porte de cet Orient mystérieux et mythique. Être insomniaque et enfermé dans son petit appartement sur lequel la nuit tombe, invite Ritter, peut-être au soir de sa vie, à évoquer ses souvenirs de voyage d’Istanbul à Alep, de Damas à Téhéran et ce d'autant plus que s'y insinue l'image d'une femme, l’insaisissable et flamboyante Sarah, nomade intellectuelle qui fut jadis sa complice, son mentor et surtout l'objet de ses amours chastes et platoniques. Ce personnage timide, « fils à maman », éternel célibataire, érudit mais solitaire dont les tentatives enamourées et parfois érotiques en direction de Sarah tombent toujours à plat [il aura cependant sa nuit d'amour avec elle à Téhéran], va se remémorer sa vie, ses souvenirs qui ressemblent à un journal d'Orient dont les articles se seraient entassés pêle-mêle et se libéreraient d'un coup à la faveur de cette nuit interminable où il s'égare, fantasme, cite sans cesse d'autres personnages, un épisode de la mythologie grecque ou un détail architectural d'un palais ottoman, un peu comme on fait nuitamment quand le sommeil tarde à venir. Singulier personnage que ce Frantz dont la vie sentimentale est un échec sur toute la ligne et pas seulement avec Sarah [l'image de cette femme renvoie peut-être aux quelques vers de l'exergue ?] et qui doit se contenter du rêve, des hésitations et des souvenirs. La lascivité érotique de l'Orient n'est à l'évidence pas pour lui et il n'a même pas la consolation de la foi, seulement celle, intellectuelle, de l'orientalisme, c'est déjà ça !
En bon orientaliste qu'il est, il entend rendre compte directement de ses impressions, fustige au passage cette vision particulière de l'Orient empruntée aux autres. Cette contrée attire autant le voyageur que l’écrivain et l'artiste et même si ces derniers n'y ont jamais mis les pieds, ils se sont approprié, souvent avec talent, les sensations et les travaux des autres. Fort de cette expérience il en profite même pour évoquer l'histoire, la philosophie, les facettes religieuses de ces pays mais aussi leur implications dans le déroulement géo-politique général, guerres, colonialisme, économie, ethnographique, linguistique... mais aussi, en bon musicologue, il ne se prive pas pour donner son avis sur Wagner, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Mahler...
C'est un texte érudit, plein de méandres parfois un peu pesants, souvent lyrique et poétique aussi, comme sait nous en offrir Mathias Enard et ce, même si le lecteur peut être un déstabilisé par la longueur de certaines phrases et l'érudition de nombre de digressions. Qu'importe après tout, il a les senteurs d'opium, la sensualité des femmes et les accents musicaux de cet Orient aux limites géographiques indistinctes, fictif, réel ou fantasmé qui distille un dépaysement bienvenue à chaque page. Dans cet Orient on croise aussi plus prosaïquement les colonisateurs français et anglais, les bordels d’Istanbul, les échanges internationaux, des personnages vrais ou vraisemblables, souvent hauts en couleurs des trafiquants de tout poils, des espions et des aventuriers dont le portrait est juste esquissé à grands traits mais qui enchantent le lecteur.
Pourquoi la boussole de Mathias Enard, qui devrait normalement indiquer le nord que nous avons nous, peut-être perdu, s’obstine-t-elle à pointer le sud et l'est ? La raison en est sans doute sa connaissance, son amour pour ces pays et leur culture à moins que cela en soit sa volonté de rappeler à l'occident tout ce qu'il doit à l'Orient. La sortie de ce roman n'est sans doute pas un hasard, à l'heure où cet Orient est défiguré par le Djiad, ravagé par les guerres, ses richesses archéologiques pillées par des révolutionnaires religieux bornés et des sauvages incultes, l'image d'une contrée où le sublime côtoie l'atroce. Avec ce texte somptueux, moi, le béotien du voyage dont l'horizon ne dépasse guère le cadastre de mon terroir, j'ai vu l'Orient à travers la lecture attentive et passionnée de ce texte où se mélangent harmonieusement les accents des poèmes persans, les effluves d'opium de Téhéran et la saudade de Fernando Pessoa.
Hervé GAUTIER – Octobre2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
NAGER - Richard Texier (Gallimard)
Je ne connaissais Richard Texier que pour ce qu'il avait fait pour le bicentenaire de la Révolution française et des réalisations conservées dans la ville de Niort, je savais que c'était quelqu’un qui avait réussi et qui poursuivait un parcours où on se découvre tous les jours, où on devient ce qu'on est depuis toujours. C'est pourtant par hasard que j'ai pris sur les rayonnages de la bibliothèque municipale un livre écrit par lui mais qui n'est pas un roman. C'est un parcours de mémoire, un récit où se mêlent des réminiscences de son enfance et une réflexion sur sa création artistique qu'elle nourrit.
C'est donc à une découverte de l'artiste et de son œuvre que ce livre invite. Elle commence par l'évocation de son enfance maraîchine, ses vacances vendéennes, convoque les personnages qui les ont peuplées, avec toujours l'omniprésence de l'eau mêlée à la douceur du climat et à la chaude ambiance familiale. Le Marais Poitevin n'était pas encore cette terre pour touristes quand on fait pour eux naître des feux-follets à la surface de l'onde, mais un endroit un peu mystérieux où la terre et l'eau se conjuguent, où la vie fourmille, où le travail était dur et ingrat. Le lecteur attentif apprend, un peu étonné qu'il doit sa future activité de sculpteur... à la traite d'une vache et celle de peintre à un bidon renversé où le lait se mêle à l'eau d'une conche ! Plus tard se sera sa scolarité à Niort, la découverte de ce talent qu'il portait en lui et qui fut décelé par une institutrice attentive et cultivé passionnément auprès d’artistes locaux qui surent l'encourager. Il deviendra le centre de sa vie.
II analyse ce qui plus tard a sous-tendu son art, la côte atlantique avec les vagues, la saveur salée de l'écume, les secrets de l'estran, la violence des tempêtes, les frondaisons du marais mouillé mais aussi sa curiosité des choses, le contact avec la créativité des autres, se qualifiant lui-même de « chasseur d'éblouissements ». Le goût d'un simple fruit évoque pour lui son passé et cette démarche proustienne lui fait apprécier l'instant présent, une fête autant pour le palais que pour l'esprit, le quotidien banal qu'il célèbre, alors que l'homme est plus volontiers occupé à amasser des richesses [« Nous sommes devenus des barbares sans destin, travaillant à remplir nos cassettes personnelles d'or et de matière morte »]. A ses yeux, l'artiste est dépositaire de la beauté du monde et se doit de l'exprimer simplement et hors de toute chapelle [« Un artiste peut-il tenter, depuis la modeste place où il se trouve, de rendre compte de la magie qu'une simple poire peut convoquer ? Peut-il dire le mystère d'une manière non dogmatique et non religieuse ? Il me fallait essayer »] Cette démarche m'évoque celle de Victor Ségalen quand il définissait l'écriture, « Voir le monde et l'ayant vu, dire sa vision », et lui d'ajouter « l'enjeu de ma recherche est de rendre visible le prodige qui nous entoure ».; Il explore également les chemins de l'imaginaire et de leur mystère, ajoutant parfois une touche sibylline aux titres de ses propres tableaux. Son côté surréaliste ressort quand il parle d'Yves Tanguy et de son tableau « Jour de lenteur » [j''écris cet article face à une reproduction de cette œuvre] qu'il reconnaît comme le principe fondateur de sa peinture parce qu'à ses yeux c'est son enfance qui ainsi émerge. Il dit aussi sa vision du monde, parle du chaos et du cosmos (chaosmos), du grand livre de l'univers, de l'astrologie, de la mécanique terrestre qu'il réinterprète sur certaines de ses toiles où le pinceau n'est pas toujours le seul instrument de sa création mais n'oublie pas cette terre qui est pour lui une source d’inspiration. Cette observation du monde, cette connaissance de son histoire avec ses soubresauts et ses hésitations lui inspirent des aphorismes parfois bien sentis entre démonstrations et réflexions. Sa peinture s'inscrit dans cette énergie cosmique qui, parce que certains supports ne tolèrent pas les retouches, les repentirs, confère à son œuvre spontanéité et authenticité et lui donne une véritable fonction de médiation dans ce monde protéiforme qui l'entoure, en équilibre instable sur le vide. C'est aussi l'occasion de délivrer un message écologiste de sauvegarde de notre planète, pour notre propre vie et celle des générations futures. Parfaitement au fait des réalités quotidiennes, il note opportunément que l'écologie politique a échoué à nous en faire prendre conscience, et voit dans l'art « un moyen valide de réveiller les esprits en créant des œuvres qui affirment la splendeur du monde ».
Mais revenons au titre de cet ouvrage. Pour lui, il faut plonger (et nager) dans l'eau noire de la « Grande Rigole » maraîchine pour atteindre la source de l'imaginaire [« Plonger pour revenir en arrière, retourner vers l'origine, rejoindre symboliquement la matrice, le liquide chaud d'avant la naissance, le temps de la sphère maternelle et protectrice »]. Il invite le lecteur, dans un compte à rebours virtuel, à redécouvrir la puissance créatrice du monde, liant entre eux le pouvoir de l'imaginaire et celui de l'univers. Développant cette idée, il rappelle que chacun d'entre nous possède en lui une potentialité créatrice. Elle a son siège dans le cerveau, véritable « terra incognita » , siège de la créativité selon les surréalistes, mais dont l'étude pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Il en vient à la question de l’inspiration, du travail de création qui « malaxe un magma intérieur, difficile et résistant ». Qu'on ne s'y trompe pas, créer est un combat, une bataille intérieure que livre l'artiste contre lui-même etcontre l''instant fugace d'où naît l’œuvre d'art. On est loin de ce qu fait dire au profane que l'art est évident et procède d'une grande facilité. Faire une œuvre artistique est le résultat d'une alchimie où le cerveau à sa part mais qui laisse aussi place à l'inconnu. Ce phénomène que nous partageons tous peu ou prou, ressemble à une magie, une logique interne qui a son siège dans l'enfance. De cette logique l'artiste tire sa singularité puisqu'il l'observe et donne à voir l'idée qu'il s'en est faite même si au départ il n'en avait pas la moindre notion et que cette représentation s'est peu à peu tissée dans le labyrinthe de son imaginaire secret. Le résultat peut être chaotique pour le commun des mortels qui a parfaitement le droit souverain de le juger, il n'en est pas moins quelque chose d'unique qui ressemble à une vision primordiale, une tache microscopique dans le vide sidéral, le commencement de quelque chose qui, à travers la forme et la couleur va imposer sa présence, son existence, sa permanence magnétique.
Son écriture se décline, à mon avis sous deux formes ou en deux temps si on préfère. Quand Texier évoque son parcours artistique et professionnel, c'est une une évocation de ceux qu'il a croisés et qui ont parfois accompagné voire nourri sa créativité. Je lui préfère personnellement le sortilège du marais quand l'enfance permet de découvrir ce lieu étrange plein de bruits et de silences. J'y retrouve les accents du poète Léon-Georges Godeau pour qui les conches étaient tout autant une invitation à la pêche qu'à la magie des mots qu'il tressait si bien. Oui, cette ouvrage est pour moi une découverte enthousiasmante. Richard Texier fait ici montre d'une belle et savante écriture, apaisante comme les bords de la Sèvre, à la fois poétique et pleine de réflexion.
Le poids du papillon - Erri de Luca (Gallimard-Feltrinelli)
Traduit de l'italien par Danièle Valin.
Ce sont deux récits somptueux, lus alternativement en français et en italien pour la beauté et la musicalité de ces deux langues cousines. Ils ont la montagne italienne pour cadre et la poésie pour souffle, l'un est dédié au duel entre un vieux braconnier et un chamois-roi de sa harde, l'autre à la complicité entre un narrateur et un pin des Alpes.
L'animal est puissant, majestueux, d'une taille au-dessus de la moyenne. Il a engendré une nombreuse descendance mais pour lui, il le sait, la fin est proche et nécessaire parce qu'il sera obligatoirement et rapidement détrôné par un plus jeune. Telle est la loi de cette vie du troupeau sur lequel il règne en maître depuis si longtemps. Il viendra donc au-devant du chasseur qui l'abattra d'une seule balle sans qu'il ressente la moindre souffrance. L'homme solitaire qui gîte dans la montagne après une jeunesse révolutionnaire déçue, l'a poursuivi toute sa vie, en vain ! Il y a en lui un peu du capitaine Achab pourchassant Moby Dick, la baleine blanche et du « Vieil homme et la mer » dans ce combat qui l'oppose à l'animal, face à la nature. Mais aujourd'hui, c'en est fini de ces défis, de ces traques silencieuses et patientes entre deux rois qui partagent le même territoire, la même liberté, la même connaissance du terrain mais pas le même but. Le braconnier reste un homme incapable sans doute de s'attacher, qui n'est pas insensible aux yeux d'une femme mais s'en méfie. L'évocation de leur rencontre dans un café de la vallée a quelque chose de poétiquement sensuel. Il veut poursuivre son parcours terrestre mais maintenant le temps lui est compté parce que la vieillesse l'assaille, ce sera son dernier coup de fusil. Par respect pour cet animal fabuleux, il n'en tirera aucun profit. Il y a une sorte de communauté d'état entre eux, le silence, une solidarité, une attirance commune pour la solitude, une prise de conscience de la fuite du temps, un certain détachement pour les choses, mais cet instant de rencontre est le plus fort qui décidera de la suite.
Les ailes blanches et fragiles d'un papillon viennent donner au récit, dans un écrin de silence, ce qu'il faut de légèreté et de tragique comme la vie elle-même. Elles sont comme une couronne sur la tête de ce chamois-roi, elles s'opposent aux ailes noires des aigles, des rapaces qui volent haut, se nourrissent des dépouilles des animaux qu'ils tuent.
Erri de Luca s'affirme comme un sublime conteur. Le texte est initiatique et sa beauté est rude, comme la montagne. L'auteur est aussi un familier des cimes et des parois rocheuses et sait rendre pour son lecteur l’atmosphère du lieu, la faune comme la flore, sait lire dans les odeurs, dans les traces, dans la course des saisons, anticiper l'orage…
Il est aussi un attentif lecteur de la Bible qui émaille son récit de références religieuses, il y a cet amour de la nature, un peu comme si l'homme partageait avec le chamois et l'arbre cette forme de vie, véritable cadeau de Dieu. La symbolique du ciel religieux et des cimes est très forte comme l'est aussi celle de la foudre qui épargne l'arbre accroché au rocher. La solitude qui fait partie de la condition humaine est ici soulignée par le sublime décor de la montagne. L'homme et le chamois connaîtront aussi la mort qui est l'ultime étape de la vie, mais l'arbre, avant d’être cendre sera bateau guitare ou sculpture...
C'est un recueil de nouvelles plus bouleversant peut-être que les autres écrits d'Erri de Luca.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2015
L'arrière saison Philippe Besson (Juillard)
Une histoire simple : Un soir de septembre un peu orageux, au cap Cod dans l'état du Massachusetts aux États-Unis, un bar, « chez Phillies », donnant sur les falaises d'où se jettent parfois des désespérés. Ben, un barman ordinaire et discret, une cliente, Louise Cooper, 35 ans qui attend Norman. C'est une habituée de cet établissement. Elle sirote un Martini blanc simplement parce qu'elle aime davantage la forme du contenant que le contenu. Elle est auteur dramatique à succès et porte ce soir-là une robe rouge comme ses lèvres. Cette couleur sied aux femmes belles et de caractère, et c'est effectivement ce qu'elle est. Célibataire, elle mène une vie libre et choisit ses amants. Entre Ben et elle, c'est une longue histoire d'amitié et de complicité silencieuse, exactement depuis qu'il a pris son service chez Phillies, il y a longtemps et d'ailleurs il connaît toutes ses pièces. Pour elle, il n'est pas qu'un simple serveur et pour lui elle est plus qu'une habituée.
Un homme arrive, Stephen Touwnsen, un client ordinaire en apparence. Il est avocat d'affaires à Boston, marié à Rachel et père de famille. Ben le connaît aussi et, bien entendu Louise puisqu'ils ont eu ensemble une longue liaison parfois orageuse mais surtout passionnée qui s'est terminée il y a cinq ans par l'apparition entre eux de Rachel qui s'est glissée dans sa vie et dans son lit. Stephen s'était donc marié avec sa nouvelle conquête qui lui offrait le calme même s'il formait avec Louise « un beau couple » comme dirait Ben. Pourtant, pendant toutes ces années de séparation, il n'a pas cessé de penser à elle, bien que cette dernière lui ait interdit de chercher à la revoir. Une page s'était donc tournée pour eux, et Louise avait décrété le silence sur ce souvenir. C'est une femme forte et, après la douleur de la séparation, elle a puisé dans l'écriture une nouvelle raison d'exister en créant des pièces inspirées de cet échec. On ne dira jamais assez l’extraordinaire pouvoir exorciste des mots !
Stéphen savait qu'en passant la porte de ce bar, il la trouverait ici et il lui annonce sa séparation d'avec Rachel. En l'apprenant Louise savoure une sorte de victoire mais pourtant elle s'en moque puisqu'elle attend un homme qui pourtant tarde à venir parce que, pour elle, il va quitter son épouse. Maintenant entre eux s'installe une sorte de silence gêné que Ben respecte et scrute, l'air de rien. Dans ce coin de bar, il règne entre des deux ex-amants une atmosphère surréaliste à cause de ce mutisme que chacun veut briser sans exactement savoir comment faire. Dans leur for intérieur, ils pensent à leur passé commun, à leurs souvenirs, à leurs erreurs aussi tout en laissant à l'autre l'initiative d'interrompre ce silence. Quand elle comprend que Norman ne viendra pas la rejoindre et donc qu'il renonce à elle, tout redevient possible entre Louise et Stephen puisqu'ils sont libres tous les deux et qu'ils n'ont cessé de s'aimer. Peu à peu le silence se lézarde comme un vieux mur et la solitude de ces deux êtres s'estompe, le respect revient à travers des regard muets « Ils s'observent avec tendresse, avec une sorte de gratitude. C'est un regard comme une reconnaissance de dettes. Un regard comme un pardon aussi , pour la douleur ou pour le manque. Un regard comme un regret enfin, de ce qui a été, de ce qui aurait pu être ». Ben, constamment en retrait dans ce café du bout du monde veut rester le figurant discret de ce psychodrame mais en connaît tous les ressorts.
Il y a dans ce roman une musique, une ambiance qui est bien rendue par la fluidité du style. Le texte, agréablement écrit, sans artifice, poétique dans les descriptions, se lit bien et avec plaisir. Il est réaliste et précis comme la peinture d'Hopper. Les phrases sont comme des touches de couleur dont l'ensemble forme un tableau.
Il y a une analyse fine des sentiments de ces protagonistes, une étude psychologique pertinente qui peu à peu emporte l'assentiment du lecteur. Dans ce huit-clos, l'auteur le prend à témoin en lui dévoilant, dans une analyse précise, l'histoire intime de Louise et de Stephen, sans omettre les lâchetés ni les remords.
A la lecture de ce roman, je mesure le rôle du romancier, celui de raconter une histoire, celle de cette femme en robe rouge du tableau de Hopper. Elle n'est qu'un personnage peint sur une toile que les visiteurs du musée ne verront peut-être pas. L'auteur lui invente une tranche de vie qui n'est sans doute qu'une fiction sortie de son imagination ou de l'émotion qu'il a ressentie devant ce tableau et qui porte son écriture.
J'avoue que j'ai toujours été bouleversé par les rencontres d'hommes et de femmes qui, dans le passé ont eu des relations intimes, une vie commune et qui, longtemps après leur séparation, se retrouvent presque par hasard. Leur dialogue est plein de non-dits et les mots peinent à venir à cause sans doute des chagrins, des petites bassesses dont on se souvient et qu'on n'a pas pardonnés, par l'envie aussi qu'ils ont de recommencer leur histoire.
La Feuille volante n° 604– Juin 2015.
La boule noire Georges Simenon (Le livre de Poche)
Nous sommes dans une petite ville des États-Unis dans les années 50. Walter Higgins y mène une vie paisible de père de famille nombreuse et de directeur de supermarché. Il s’implique même à titre bénévole dans diverses activités au profit de la collectivité. Bref, c'est quelqu'un dont on peut dire qu’il a réussi socialement et qu'il est heureux dans cette vie autant qu'on peut l'être et que c'est un type bien. A un détail près cependant, il s'est mis dans la tête d'être membre de Country Club, une association locale de notables qui rejette systématiquement sa candidature sans raison apparente et le fait à travers un vote anonyme qui se manifeste par la présence d'une seule boule noire déposée dans l'urne le soir du scrutin. Il n'a pourtant rien de commun avec ce club mais son appartenance consacrerait sa 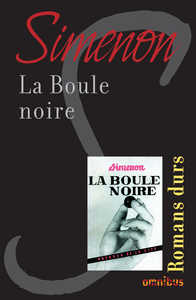 réussite. Ce refus, manifesté pour la deuxième année bouleverse Higgins. C'est peut-être pour lui plus qu'une question de principe puisque même au pays du rêve américain où la réussite personnelle est célébrée comme une vertu, il lui semble que ce qu'on lui reproche ce sont ses origines pauvres, son père absent sa mère alcoolique, destructrice et délinquante. Pour en être arrivé là, il a dû gravir tous les échelons d'une société qui ne lui avait pas fait de cadeaux puisqu'il était parti de rien. Si on lui a confié la direction du magasin, c'est qu'il avait fait ses preuves, débutant comme livreur. En lisant cela le lecteur songe immanquablement à un paranoïaque qui rejoue la grande scène du complot. C'est pour lui tellement révoltant qu'il veut tuer les membres de ce club qui lui refusent l'entrée. Pire peut-être, il découvre qu'au sein de ses activités bénévoles où il s'impliquait pourtant beaucoup, son avis importe peu et on le tient pour rien. Il démissionne donc même si cela peut avoir des conséquences sur son chiffre d'affaires et sur sa situation. Pourtant cette histoire d’appartenance à ce club n'a vraiment aucune importance mais il le vit comme quelque chose d'injuste. Le déroulé des événements le fait pour autant revenir à une réalité plus terre à terre, le fait grandir, lui fait prendre conscience des choses et les relativiser.
réussite. Ce refus, manifesté pour la deuxième année bouleverse Higgins. C'est peut-être pour lui plus qu'une question de principe puisque même au pays du rêve américain où la réussite personnelle est célébrée comme une vertu, il lui semble que ce qu'on lui reproche ce sont ses origines pauvres, son père absent sa mère alcoolique, destructrice et délinquante. Pour en être arrivé là, il a dû gravir tous les échelons d'une société qui ne lui avait pas fait de cadeaux puisqu'il était parti de rien. Si on lui a confié la direction du magasin, c'est qu'il avait fait ses preuves, débutant comme livreur. En lisant cela le lecteur songe immanquablement à un paranoïaque qui rejoue la grande scène du complot. C'est pour lui tellement révoltant qu'il veut tuer les membres de ce club qui lui refusent l'entrée. Pire peut-être, il découvre qu'au sein de ses activités bénévoles où il s'impliquait pourtant beaucoup, son avis importe peu et on le tient pour rien. Il démissionne donc même si cela peut avoir des conséquences sur son chiffre d'affaires et sur sa situation. Pourtant cette histoire d’appartenance à ce club n'a vraiment aucune importance mais il le vit comme quelque chose d'injuste. Le déroulé des événements le fait pour autant revenir à une réalité plus terre à terre, le fait grandir, lui fait prendre conscience des choses et les relativiser.
J'observe quand même que Higgins a bénéficié du soutien sans faille de sa famille et de ses employés, ce qui se révèle à la fois rassurant et salvateur dans une situation qui aurait pu devenir criminelle. Pourtant quand on a le sentiment d'être exclus d'un groupe et en ressent une certaine solitude.
Cette histoire de boule noire a probablement une dimension maçonnique, le terme blackbouler vient de là. Mais au-delà de cette remarque qui ne trouve pas ici sa véritable résonance, ce roman, écrit dans les années 60 prend une dimension très actuelle. Il nous est tous arrivé, dans notre vie familiale ou professionnelle d'être l'objet d'injustices qu'aucune raison ne motivait. Elles nous étaient infligées discrétionnairement soit par quelqu’un qui ne nous aimait pas ou ne nous aimait plus, soit par simple jalousie. En tout cas, la personne qui faisait ainsi acte de malveillance avait une volonté farouche de nous faire du mal, de nous détruire, d'autant plus forte qu’elle ne reposait sur rien d'autre que sur cette faculté de profiter d'une situation de supériorité supposée et parfois temporaire, basée sur la fortune, la position sociale ou hiérarchique. Le pire sans doute était la lâcheté puisque cette situation délétère était couverte par l'anonymat, l'hypocrisie, la mauvaise foi...
Simenon, ce n'est pas seulement les romans policiers où le commissaire Maigret exerce avec talent son pouvoir de persuasion, de déduction et démasque à chaque fois le coupable. J'ai dit dans cette chronique combien j'aimais cette ambiance un peu glauque tissée dans cette série. C'est aussi un écrivain de romans psychologiques et je suis entré, pour des raisons personnelles sans doute, dans ce processus qui m'a parlé d'autant plus que le style est fluide, agréable à lire.
Ce roman a été adapté pour la télévision dans un film de Denis Malleval (2014) diffusé sur France 3 le mercredi 17 février 2015. Le comédien Bernard Campan, que l'on connaissait dans un tout autre registre, donne ici toute sa mesure dans cette dramatique.
©Hervé GAUTIER – Février 2015 -
En attendant Robert Capa - Suzanne FORTES (H d'Ormesson)
Traduit de l'espagnol par Julie Marcot.
Fuyant l'Allemagne nazie, Gerta Pohorylle, jeune juive allemande, admiratrice de Greta Garbo, « avec un passeport polonais », vient d'arriver à Paris. « Elle à 24ans et elle est vivante » ! Elle ne va pas tarder à rencontrer, un peu par hasard, un autre réfugié, photographe, Hongrois, ambitieux mais désargenté. Ces deux-là étaient faits pour se croiser et le fait qu'ils le fassent dans la capitale française est plus qu'un symbole. Gerta y voit un signe, une chance ! Lui, c'est André Friedmann, juif lui aussi, qui vit avec son Leica comme on vit avec une femme. Dans ce Paris d'avant-guerre, pleins d'intellectuels, ils croisent au hasard des cafés ou des cercles, dans le tourbillon germanopratin, James Joyce, Man Ray...
Pourtant, entre eux, ce n'est pas vraiment le « coup de foudre », juste, de la part de Gerta, une sorte d'observation curieuse. Elle adopte cependant cet homme [« Ne t'inquiète pas, ce qu'il te faut c'est un manager...Et c'est moi qui vais être ton manager »]. Pour lui, elle est « la patronne » et il l'initie à la photographie en même temps qu''il devient son amant.
Foncièrement antifasciste, André part pour l'Espagne, d'abord comme reporter-photographe et Gerta, restée à Paris, apporte sa pierre à la réaction républicaine qui se doit de faire front aux bruits de bottes qui approchent, qu'ils viennent de Berlin ou d'ailleurs. Pourtant Gerta et André sont amoureux l'un de l'autre, prennent la décision un peu folle de couvrir la guerre d'Espagne comme photo-reporters en s'inventant les pseudonymes américains de Gerta Taro et Robert Capa. C'est une manière pour eux d'échapper à leur judéité autant que d'inaugurer leur nouvelle vie ensemble. En changeant de nom, André devient un américain triomphant et audacieux, en devenant Taro, Gerta s'approprie phonétiquement le nom de Garbo, son actrice fétiche.
Ce conflit les fascine autant qu'il les révolte et ils rendent compte en images du quotidien des républicains au front ou dans les villes et villages. Cette guerre fait d'eux un couple mythique qui ne vit que pour son métier de photographe de guerre et sa passion d'informer, armés de leur appareil photo ou à l'occasion d'un fusil, tissant leur propre légende, exposant leur vie. Leur amour fait contrepoids à la violence des combats et, petit à petit, ils changent leur vision romantique de la guerre. Si des atrocités ont été commises de part et d'autre, eux ont choisi leur camp, celui des républicains. Comme ils sont jeunes, leur vie se déroule au mépris du danger, tantôt houleuse et cahoteuse, tantôt passionnée, au sein même de ce conflit sanglant. Pourtant l'amour de leur métier se conjugue assez mal avec celui, à la fois sensuel et épisodique qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Gerta est éprise de liberté et d'indépendance mais a du mal à exister professionnellement dans l'ombre de Capa. Certains de ces clichés sont attribués à Robert; le journalisme de guerre n'est pas vraiment une affaire de femme ! Cependant, quand elle apparaît, au front ou à l'arrière, tous ces hommes un peu frustes n'ont d'yeux que pour elle. Pourtant, elle n'est pas vraiment une beauté au sens des canons traditionnels, mais il émane d'elle une sorte d'aura. « La guerre l'avait dotée d'une beauté différente, de survivante » écrit joliment Susanna Fortes.
C'est aussi un hommage aux journalistes de terrain qui risquent leur vie pour l'information du plus grand nombre, mais c'est aussi un  récit passionnant, émouvant et poétique où le lecteur croise Raphaël Alberti, Ernest Hemingway, autant qu'une version romancée de la vie libre, passionnée et solaire de ces deux amants, une mise en lumière de celle de Gerta dont on ne connaissait jusqu'alors que très peu l'existence. Elle se révèle sous la plume de l'auteur être une femme courageuse, passionnée et passionnante quand le nom seul de Capa était connu autant d'ailleurs que certaines de ses photos dont l'une d'elles, devenue célèbre, représente un milicien espagnol anonyme, fauché par une balle. Capa ne se remit jamais de ce cliché par ailleurs sujet à polémique.
récit passionnant, émouvant et poétique où le lecteur croise Raphaël Alberti, Ernest Hemingway, autant qu'une version romancée de la vie libre, passionnée et solaire de ces deux amants, une mise en lumière de celle de Gerta dont on ne connaissait jusqu'alors que très peu l'existence. Elle se révèle sous la plume de l'auteur être une femme courageuse, passionnée et passionnante quand le nom seul de Capa était connu autant d'ailleurs que certaines de ses photos dont l'une d'elles, devenue célèbre, représente un milicien espagnol anonyme, fauché par une balle. Capa ne se remit jamais de ce cliché par ailleurs sujet à polémique.
C'est un roman très bien documenté sur cette Guerre civile ( d'aucuns l'ont baptisée « incivile ») qui déchira l'Espagne de 1936 à 1939 et qui annonça la Deuxième Guerre Mondiale. L'auteur mêle donc dans ce travail, la fiction à la réalité. C'est une histoire tragique aussi puisqu'elle se termine par la mort de Gerta, la première femme reporter tuée pendant la Guerre Civile, fauchée à la bataille de Brunete en juillet 1937 à l'âge de 27 ans [« C'est à cet instant qu'elle comprit que toute une vie tenait dans l'éclair d'un millième de firmament, car le temps n'existait pas. »].
Elle qui vivait dans l'espoir d'une victoire des républicains ne vit pas leur défaite. Elle sera enterrée au cimetière du Père Lachaise, en présence de milliers de personnes, son éloge funèbre prononcée par Pablo Neruda et Louis Aragon. Elle ne quittera jamais plus la mémoire de Capa qui s'en voulait de l'avoir abandonnée aux combats meurtriers de l'Espagne. Sa vie à lui est désormais en pointillés, et quand il débarque, le jour J à Omaha Beach avec la première vague d'assaut, il pense aussi à cette mort qu'il a si longtemps défiée. S'il survit, comme par miracle au débarquement et au conflit, c'est en Indochine en 1954, à l'âge de 40 ans que le destin les réunira.
Il se dégage de ce roman une formidable énergie autant qu'un amour de la vie de la part de ces êtres, morts jeunes, que le monde fascinait mais qui n'étaient pas faits pour lui, qui mettaient constamment en balance leur vie sachant qu'ils n'en étaient que les usufruitiers. Ils ont pris des risques pour vivre intensément l'instant, pratiquer l'art de la photo unique qui résume tout, mais aussi pour satisfaire leur idéal d'informer, de témoigner, d'être présents là où il n'y avait personne d'autre, et d'y arriver avant les autres ! Avec eux, la photo est devenue une véritable arme.
L'occasion de ce récit a été inspiré à Susanna Fortes, un peu par hasard à cause de la découverte de négatifs et de clichés de Capa et de Gerta, en 2008, au Mexique. Il a le grand mérite de mettre en lumière la personnalité de cette femme d'exception qui n'était jusque là qu'une silhouette.
© Hervé GAUTIER
Pas Pleurer - Lydie Salvayre (Goncourt 2014)
 Étonnant roman où se mêlent les voix de Georges Bernanos, écrivain catholique, royaliste, militant de l'Action française et résident temporaire aux îles Baléares au moment où éclate la Guerre civile espagnole et celle de Montse, la mère de la narratrice, âgée de 15 ans à l'époque. Bernanos, contrairement à ce qu'on pouvait attendre de lui, stigmatise avec colère les massacres aveugles perpétrés par les franquistes et dénonce le silence complice de l’Église espagnole bien plus inspirée par l'allégeance à ce pouvoir que par le message de l’Évangile. Montse, appartenant à une famille pauvre de cette Espagne ancestrale et rétrograde, gouvernée par les notables possédants et bénie par l’Église, est en réalité le personnage central de ce livre. Sa voix est claire, joyeuse et grâce à l’avènement de la République, elle découvre avec naïveté et utopie la liberté toute nouvelle et la remise en question de cette société qui va, mais pour un temps seulement, être bouleversée par la création de communes libres.
Étonnant roman où se mêlent les voix de Georges Bernanos, écrivain catholique, royaliste, militant de l'Action française et résident temporaire aux îles Baléares au moment où éclate la Guerre civile espagnole et celle de Montse, la mère de la narratrice, âgée de 15 ans à l'époque. Bernanos, contrairement à ce qu'on pouvait attendre de lui, stigmatise avec colère les massacres aveugles perpétrés par les franquistes et dénonce le silence complice de l’Église espagnole bien plus inspirée par l'allégeance à ce pouvoir que par le message de l’Évangile. Montse, appartenant à une famille pauvre de cette Espagne ancestrale et rétrograde, gouvernée par les notables possédants et bénie par l’Église, est en réalité le personnage central de ce livre. Sa voix est claire, joyeuse et grâce à l’avènement de la République, elle découvre avec naïveté et utopie la liberté toute nouvelle et la remise en question de cette société qui va, mais pour un temps seulement, être bouleversée par la création de communes libres.
Nous sommes dans un roman et j'ai apprécié aussi que l'auteur contrebalance, parfois avec humour, l’horreur au quotidien par une histoire d'amour. Montse connaît le « grand amour » éphémère comme la guerre sait en créer mais qu'un mariage arrangé ne saurait éteindre. Elle se prête pourtant à une mésalliance par convenance sociale et familiale mais surtout pour éviter un scandale, une sorte de gâchis que seule la naissance d'un enfant réussit à transformer. J'ai choisi de voir dans cette passade et surtout dans cette naissance, même si elle est immorale, une sorte d'antidote à toute la violence qui a baigné cette époque de guerre, qui a opposé jusque dans la mort les membres d'une même famille au nom d'idéologies différentes.
Le guerre civile espagnole a été l'inspiratrice de nombreuses œuvres artistiques parce non seulement elle a été le théâtre d’atrocités de part et d'autre, parce qu'elle a servi de laboratoire à la deuxième guerre mondiale mais surtout parce qu'elle a correspondu à un espoir de liberté et de démocratie pour un peuple opprimé. Malheureusement, la dictature franquiste a interrompu brutalement et durablement cet élan. Dans ce roman j'ai lu toute cette révolte à travers le personnage de Montse.
C'est peut-être une vue de mon esprit mais j'ai lu dans ces pages des accents céliniens. Ce n'est pas seulement parce que l'auteure emploie le « frangnol », sorte de sabir que parlait sa mère à son arrivée en France et qui constitue à mes yeux la manifestation sémantique de sa révolte par la création d'un nouveau langage, un peu comme le faisait Céline usant de l'argot, mais aussi parce ces phrases sont souvent laissées en suspens, sans ponctuation (contrairement à Céline qui usait beaucoup du point d'exclamation) comme on le fait dans le langage courant en interrompant son propos pour en modérer la violence. Parfois les phrases sont d'une longueur démesurée et j'y vois là aussi la marque de cette indignation ainsi manifestée.
Il y a une galerie de portraits qui caractérise cette société composée de riches et de pauvres, ces derniers, partagés entre les idées nouvelles d'émancipation et ceux qui, malgré leur condition d'esclaves, souhaitaient n'y rien changer. José, le frère de la narratrice est convaincu par les idées nouvelles tandis que Diego, mari d'occasion de Montse mais profondément amoureux d'elle, choisit de bouleverser cet ordre social ancestral et d'endosser une paternité pour laquelle il sait être étranger. Tous les deux sont en opposition l'un avec l'autre autant qu'ils sont en rupture avec leur milieu social auquel ils souhaitent échapper. Les personnages ainsi croqués évoquent l'Espagne de cette époque troublée mais aussi l'espèce humaine dans tout ce qu'elle a de grandeur et surtout de petitesse.
Cette guerre que je n'ai pas connue m'a toujours passionné, je ne saurais dire pourquoi, peut-être à cause du mouvement général qu'elle a suscité, surtout dans les brigades internationales pour la défense de la liberté et contre le fascisme, peut-être parce qu'elle a contribué, comme toutes les autres, à révéler ce qu'il y a de pire dans la nature humaine, peut-être aussi parce qu'elle a montré une nouvelle fois toute l'hypocrisie du Vatican qui se révélera derechef pendant la deuxième guerre mondiale à propos de l’extermination des juifs que Pie XII feindra d'ignorer. La hiérarchie catholique espagnole ne sera pas en reste qui bénira la dictature de Franco et surtout l'accompagnera autant pour la légitimer et l'asseoir que pour en recueillir les prébendes.
Alors, quid du titre ? Les circonstances historiques inclinaient plutôt à la tristesse voire aux larmes pourtant, j'ai goûté le ton de ce roman fort bien écrit et fort richement documenté, plein d'analyses et de remarques pertinentes, alternant humour et pathétique. « Ici on fusille comme on déboise » écrivait Antoine de Saint-Exupéry, journaliste dépêché en Espagne avant qu'il ne soit l'écrivain-pilote que nous aimons. Effectivement, aux exécutions sommaires perpétrées par les fascistes succédèrent celles des communistes jusque dans leur propre camp et contre leurs alliés anarchistes. Les exactions et la défaite militaire précipitèrent les vaincus en France, pays des droits de l'homme et de la liberté qui les accueillit pourtant si mal. Nous savons tous que les larmes ne servent à rien et surtout pas à exorciser le deuil, le chagrin, la colère, la souffrance. Face au monde qui s'effondre et à celui, fasciste, totalitaire qui se met en place dans un pays déchiré, l'auteur oppose l'amour fou de Montse pour un inconnu de passage, celui plus effacé mais sincère de Diego puis celui, enfin, que suscite un enfant qui réconcilie tous les membres de cette famille disparate et anachronique.
L'abandon des idéaux surtout politiques qui ne résistent pas longtemps à l'hypocrisie et à l'opportunisme des hommes et leur lâcheté, leur haine et leur oubli ne valent pas non plus la peine qu'on en pleure. C'est là la marque de l'espèce humaine à laquelle nous appartenons tous. Le parcours de José qui tourne à la désillusion en est ici l'illustration, celui de Diego, différent mais quand même semblable témoigne de cette remise en question. Reste le destin de ces pauvres gens précipités dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue, ne connaissaient pas les façons de vivre et qui devaient s'y adapter, alors « pas pleurer », peut-être, mais là je ne suis pas bien sûr et puis écrire est un exorcisme bien plus efficace sans doute que toutes les larmes. Dont acte !
J'ai souvent dit dans cette chronique et ailleurs que ce prix Goncourt qui consacre un écrivain et honore les lettres françaises avait souvent été attribué à des auteurs qui ne le méritaient pas. Après avoir lu ce roman passionnant, je ne réitérerai pas cette remarque et me félicite d'avoir croisé Lydie Salvayre que je ne connaissais pas auparavant et dont je poursuivrai assurément la lecture de l’œuvre.
Hervé GAUTIER
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier P. Modiano
 Saint-Augustin conseillait qu'on se méfiât de l'homme d'un seul livre. Pour ma part, j'ai toujours pensé que ce concept d’unicité dans la création était probablement la marque des grands écrivains. Ils explorent ainsi, et pendant longtemps, avec patience et détermination, leur inconscient, exprimant par l'écriture une œuvre parfois protéiforme mais qui en réalité est une quête intime, une sorte d'obsession qui les tenaille et dans laquelle peut-être le lecteur peut se retrouver. Ce travail sur soi me paraît respectable quand il est mené sincèrement et c'est le cas pour Patrick Modiano. En lui décernant le Nobel de littérature, l'Académie suédoise a consacré cette démarche de la mémoire et de la quête personnelle en le comparant à Marcel Proust, on ne peut rêver meilleure référence ! Grâce à lui, qui a eu sans doute, comme à son habitude, du mal à exprimer avec des paroles ce qui lui arrivait, la France, pays de Victor Hugo et de Voltaire, retrouve une place qu'elle n'aurait jamais dû quitter dans le domaine de la culture. Il nous reste au moins cela quand tout s’effondre dans notre beau pays !
Saint-Augustin conseillait qu'on se méfiât de l'homme d'un seul livre. Pour ma part, j'ai toujours pensé que ce concept d’unicité dans la création était probablement la marque des grands écrivains. Ils explorent ainsi, et pendant longtemps, avec patience et détermination, leur inconscient, exprimant par l'écriture une œuvre parfois protéiforme mais qui en réalité est une quête intime, une sorte d'obsession qui les tenaille et dans laquelle peut-être le lecteur peut se retrouver. Ce travail sur soi me paraît respectable quand il est mené sincèrement et c'est le cas pour Patrick Modiano. En lui décernant le Nobel de littérature, l'Académie suédoise a consacré cette démarche de la mémoire et de la quête personnelle en le comparant à Marcel Proust, on ne peut rêver meilleure référence ! Grâce à lui, qui a eu sans doute, comme à son habitude, du mal à exprimer avec des paroles ce qui lui arrivait, la France, pays de Victor Hugo et de Voltaire, retrouve une place qu'elle n'aurait jamais dû quitter dans le domaine de la culture. Il nous reste au moins cela quand tout s’effondre dans notre beau pays !
Avec ce roman, Modiano, qui a fait depuis longtemps l'objet d'attention et de commentaires dans cette chronique, explore à nouveau sa mémoire individuelle et à travers elle son enfance. Qui est donc ce Jean Daragane, écrivain sexagénaire et solitaire qui n'écrit plus mais lit Buffon ? Son enfance à Saint-Leu-La-Forêt, il a choisi de l'oublier jusqu'à la découverte fortuite d'un carnet d'adresses, selon lui « une piqûre d’insecte » où figure le nom de Guy Torstel, un détail anodin mais qui va cependant faire revenir à lui un passé qu'il croyait révolu et faire revivre les fantômes qu'il avait croisés dans les années 1950 et 1960. Peu à peu les choses s'éclaircissent, le passé s'estompe pour laisser place au souvenir. C'est aussi le réveil de la trace presque effacée d'une femme, Annie Astrand qui fut pour lui une mère de substitution et plus tard peut-être davantage parce que sa mère l'avait abandonné. C'est vers elle que convergent des lieux aussi différents que Saint-Leu-La-Forêt, le poste frontière de Vintimille, le Tremblay , le square Graisivaudan...
C'est aussi le souvenir un peu estompé d'un roman d'amour écrit par Daragane à l'âge de vingt ans. C'était sa première œuvre qui peut parfois être gauche mais qui bien souvent est le résultat de ce qu'on porte en soi depuis longtemps et qu'on exprime avec son cœur parce qu'ainsi les mots sont un message [« Écrire un livre, c'était aussi, pour lui, lancer des appels de phare ou des signaux de morse à l'intention de certaines personnes dont il ignorait ce qu'elles étaient devenues. Il suffisait de semer leurs noms au hasard des pages et d'attendre qu'elles donnent enfin de leurs nouvelles »]. Ce roman est une bouteille à la mer dont l’auteur a brouillé un peu les pistes mais pas suffisamment quand même pour qu'Annie Astrand puisse se reconnaître. Qui est ce mystérieux Guy Ottolini qui en sait apparemment beaucoup sur Daragane et souhaite son aide pour un travail d'écriture ?
Dans ce roman comme dans tous les autres, le lecteur perd un peu le fil de l'histoire mais peu importe. Le passé et le présent sont comme cette « piqûre d'insecte » qui sert de prétexte à la résurgence de la mémoire, même si on ne le souhaite guère ou si on ne s'y attend pas. Les personnages ont quelque chose d'évanescent, d'insaisissable, ils sont comme absents ou de simplement de passage et désireux de ne pas s'attarder, comme si leur rôle se limitait à de la figuration. Ils ont une attitude énigmatique, donnent l'impression de se méfier les uns des autres, certains comme Annie Astrand sont même entourés d'un halo inquiétant fait de difficultés avec la police ou de séjour en prison, les scènes semblent être suspendues dans le temps, dans l'espace. Les questions sont parfois sans réponses et le lecteur à le sentiment d'être le témoin de séquences intemporelles ou qui devraient restées secrètes. On retrouve cette petite musique à la fois nostalgique, touchante et pour moi toujours attachante, l'atmosphère que Modiano sait si bien tisser dans ses livres, cette ambiance un peu floue, mystérieuses voire inquiétantes qui naît de ces morceaux de puzzle lointains qui peu à peu trouvent leur place et que cette écriture simple mais poétique contribue à créer. Le passé y insinue sa fragrance un peu surannée mais pas si désagréable que cela cependant. C'est le fil d'Ariane de son œuvre et j'ai toujours plaisir à le suivre.
Le livre refermé, j'ai toujours la même impression de vide ou d'un certain malaise tissé par la lecture. Pour moi, l'auteur traduit bien avec ses mots ce que sont les bribes de souvenirs qui, pour chacun d'entre nous, émergent du passé à l'occasion d'une évocation, d'un nom, d'une image. C'est là la signature de Modiano, peut-être aussi la marque de mon existence personnelle et c'est sûrement en m'accrochant à cette apparente vacuité qui pourtant m'est familière que je me retrouve dans son écriture et dans son univers romanesque si particulier.
Hervé GAUTIER – Novembre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
Murmurer à l'oreille des femmes - Douglas Kennedy (Belfond)
Sacré Douglas Kennedy ! Je ne connais pas sa biographie et encore moins sa vie intime mais si ces douze nouvelles en sont le reflet, puisqu'elle sont écrites à la première personne, même sous le masque d'autres personnages, je me dis que soit c'est une sorte de don Juan, soit c'est un sacré vantard. Car qu'il se cache sous la masque d'un modeste comptable, d'une brillante avocate d'affaires ou d'un professeur respecté, il puise sans doute autant dans son imagination que dans son expérience les modèles qu'il met en scène, même s'il alterne, pour la crédibilité de la lecture sans doute, les hommes et les femmes, l'écriture permettant cette fiction. Ça l'aurait même pris de bonne heure, cette attirance pour l'autre sexe, dès l'âge de 7 ans, à l'entendre, à l’occasion d'une simple rencontre, puis ensuite il aurait connu le grand amour, à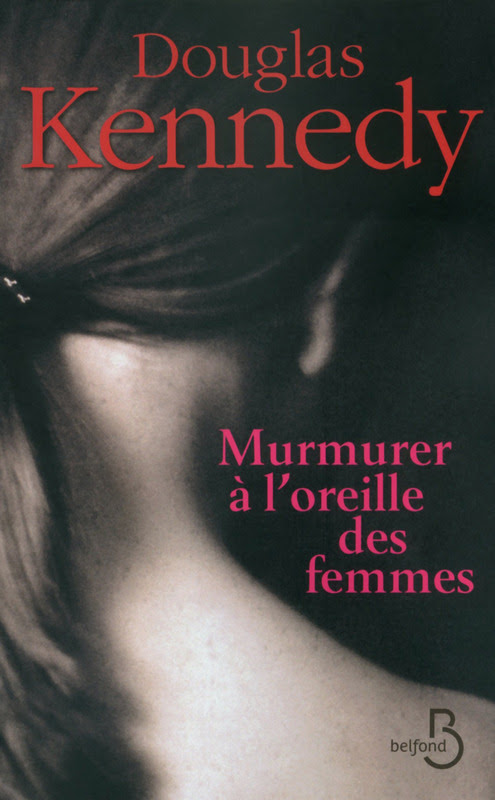 supposer bien sûr qu'il existe. Il pourrait même se dire qu'il a été « l’homme de la vie » d'une ou de plusieurs femmes, ce qui est plutôt flatteur et il est de bon ton pour un homme de se vanter de ses succès féminins ou de laisser planer un doute sur ses performances sexuelles! Pour un homme comme pour une femme, c’est tentant de pouvoir se dire « qu'ils sont faits l'un pour l'autre » et que par conséquent ils doivent passer leur vie ensemble. Alors on fait rimer « amour avec toujours », on parle de destin et si on y croit, de Dieu, cela ne coûte rien, mais finalement tout cela est bien artificiel et résiste bien rarement à l'épreuve des faits, du temps et de l'usure des choses, bien des mariages se concluent par un divorce...
supposer bien sûr qu'il existe. Il pourrait même se dire qu'il a été « l’homme de la vie » d'une ou de plusieurs femmes, ce qui est plutôt flatteur et il est de bon ton pour un homme de se vanter de ses succès féminins ou de laisser planer un doute sur ses performances sexuelles! Pour un homme comme pour une femme, c’est tentant de pouvoir se dire « qu'ils sont faits l'un pour l'autre » et que par conséquent ils doivent passer leur vie ensemble. Alors on fait rimer « amour avec toujours », on parle de destin et si on y croit, de Dieu, cela ne coûte rien, mais finalement tout cela est bien artificiel et résiste bien rarement à l'épreuve des faits, du temps et de l'usure des choses, bien des mariages se concluent par un divorce...
Il a sûrement rencontré des femmes avides de se marier et ardemment désireuses de devenir mères mais l'amour est sans doute le domaine qui révèle le mieux la part d'ombre de chacun. Ici elle se nomme lâcheté, trahison, mensonge, adultère quand ce n'est pas, pour briser la routine matrimoniale destructrice ou l'illusion de la sécurité, pour accéder à cette envie de liberté, céder à l'espoir bien souvent déçu de faire fortune ou obtenir la notoriété, de satisfaire à ce désir inextinguible de tout jeter par-dessus les moulins et changer de vie pour l'inconnu ou les fantasme de la nouveauté, la folie quoi ! Le mariage, surtout s'il succède à une déception amoureuse antérieure ne peut que se conclure par un échec[je suis frappé dans ces nouvelles par la facilité avec laquelle les conjoints ou les amants se séparent, souvent pour des raisons sentimentales mais sans oublier la dimension financière cependant]. Sans doute le charge-t-on de trop d'espérances mais je ne suis pas sûr que l'écriture, dénonçant ce désastreux état de choses, en constitue le baume, pas plus d'ailleurs que tous les produits excitants extérieurs... Quant aux relations extra-conjugales, elles ne valent guère mieux et la déconvenue en est souvent l'issue. De quoi êtres vraiment désespéré ! [« Est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Vouloir ce que l'on n'a pas, avoir ce que l'on ne veut pas. Pensez qu'il existe une autre vie « là-bas »et redouter de perdre celle qui est ici. Ne jamais être sûr de ce que l'on poursuit... » et puis aussi « Rappelle-toi, petit, on est seul, toujours seul »].
Il y a aussi cette certitude qu'ont certains de n'être pas faits pour être heureux, à côté de qui le bonheur passera toujours... sans s'arrêter et pour qui le choix dans cette matière sera toujours mauvais quoiqu’ils fassent.
C'est vrai que la condition humaine est un spectacle à la fois changeant et constant. Quand on choisit l'aspect amoureux des relations entre les gens, le mariage qui épuise l'amour pourtant si ardemment promis et qui transforme les époux en véritables étrangers l'un pour l'autre, quand ce n'est pas pire, avec au bout du compte bien souvent la résignation... ou l'irréparable, c'est là un sujet inépuisable pour qui veut en parler et je crois de Douglas Kennedy le fait bien. Il promène un regard désabusé sur les hommes et les femmes qui composent cette chose étrange qu'on appelle la société avec ses convenances, ses règles, son hypocrisie. Le fait que ce recueil se termine par un improbable conte de Noël veut-il il cependant dire que tout espoir n'est pas perdu ou au contraire que ce monde n'existe que parce que nous y instillons de temps en temps des choses qui n'arrivent que dans les livres ?
Si, dans ces textes, il fait simplement œuvre d’écrivain, non seulement c'est bien observé mais aussi c'est bien écrit. Je ne sais pas si c'est grâce à son style ou à la traduction mais le texte est agréable à lire.
J'ai déjà dans cette chronique l'intérêt que je porte aux romans de Kennedy. L'univers de la nouvelle est très particulier et j'avoue une attirance pour ce genre littéraire. Là je n'ai pas été déçu.
Traduit de l'américain par Bernard Cohen.>
©Hervé GAUTIER – Août 2014
Barbe Bleue Amélie NOTHOMB (Albin Michel)
Drôle d’histoire que celle de Saturnine Puissant, une jeune Belge de 25 ans un peu désargentée qui, venue enseigner au Louvre, cherche de quoi se loger. Elle répond à une petite annonce pour une colocation et rencontre le propriétaire, Dom Emilio Nibal y Milcar, un aristocrate espagnol, un « Grand d'Espagne » selon son propre aveu, qui accepte de lui louer pour un prix dérisoire une chambre dans son hôtel particulier parisien, avec la disposition de la domesticité, du chauffeur... Une occasion a ne pas laisser passer ! Le contrat de location précise qu'elle ne doit pas entrer dans la « chambre noire » qui lui sert à développer ses photos, alors même que celle-ci n'est pas fermée à clé. Elle remarque que les huit précédentes colocataires étaient des femmes et qu'elles ont disparu.
au Louvre, cherche de quoi se loger. Elle répond à une petite annonce pour une colocation et rencontre le propriétaire, Dom Emilio Nibal y Milcar, un aristocrate espagnol, un « Grand d'Espagne » selon son propre aveu, qui accepte de lui louer pour un prix dérisoire une chambre dans son hôtel particulier parisien, avec la disposition de la domesticité, du chauffeur... Une occasion a ne pas laisser passer ! Le contrat de location précise qu'elle ne doit pas entrer dans la « chambre noire » qui lui sert à développer ses photos, alors même que celle-ci n'est pas fermée à clé. Elle remarque que les huit précédentes colocataires étaient des femmes et qu'elles ont disparu.
C'est que cet Espagnol est bizarre. Séducteur impénitent, fort imbu de lui-même, il est exilé en France mais ne sort pas de chez lui. Noble, il souhaite que cela se sache, richissime, il adore l'or qu'il possède apparemment à profusion, se déclare royaliste, catholique dogmatique, pratiquant jusqu'à l’extrême, cite la Bible à l'envi, fanatique de la Sainte Inquisition, il pratique volontairement le « trafic des indulgences », celui-là même qui est à l'origine du luthéranisme, en couvrant son confesseur d'or en échange de son absolution ! Rien à voir avec jeune femme libérée et moderne qu'il demande d'emblée en mariage, qu'il couvre de cadeaux et dont il satisfait les moindres caprices. Il l'invite à sa table à tout propos. Saturnine ne s'en laisse pas conter, argumente, finasse, se moque de lui, lui porte volontiers la contradiction jusqu'à l'impertinence, le provoque, prétend qu'elle ne tombera pas dans le panneau de la transgression de l'interdit pour ce qui concerne la « Chambre noire » parce que, elle en est sûre, il a assassiné les huit précédentes colocataires pour le même motif bizarre... et elle ne sera pas la neuvième ! A son amour, elle répond volontiers par des vacheries.
Apparemment les autres femmes ont peur de lui et pourtant il considère que la femme est la colocataire idéale, qu'il a aimé toutes les précédentes, mais elles sont disparu ! A Saturnine qu'il associe à l'or et au champagne de grandes marques, il offre une jupe qu'il a lui-même fabriquée, faite de riches tissus et d'une doublure d'un jaune particulier et mystérieux, et qui, lorsqu'elle la porte lui fait l'effet d'une étreinte amoureuse. Bien qu'elle considère Emilio comme un dangereux malade mental, elle ne tarde pas à tomber amoureuse de lui. Reste cependant les photos, au nombre de huit, apparemment cachées dans la chambre noire, et qui ne représentent que des femmes mortes, l'occasion pour elle de mener une sorte d'enquête qui n'en est cependant pas une. Elle s'installe au contraire dans cette sorte d’ambiguïté où elle ne sera pas tuée puisqu'il lui a avoué son secret et qu'elle peut donc demeurer à ses côtés en tant que sa colocataire. Emilio la photographie elle aussi, mais à l'inverse des autres victimes, elle est bien vivante.
C'est une fable plaisante, facile à lire, bien écrite, pas dénuée du tout d'intérêt et de culture et qui évoque à la fois Henri VIII d'Angleterre (Barbe Bleue) pour l'amour des femmes et leur assassinat et la Fée Mélusine pour la transgression de l'interdit, une sorte de roman à énigme où, encore une fois, Éros danse avec Thanatos.
J'avoue que le nom d'Amélie Nothomb ne m'était pas inconnu mais je n'avais rien lu d'elle auparavant. Je l'ai découverte pour la première fois, autant par curiosité que par envie de lire un auteur connu et médiatisé
©Hervé GAUTIER
Lulu femme nue - Etienne Davodeau - Futuropolis (B.D.)
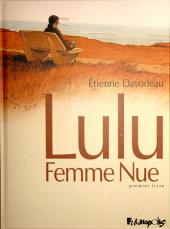 Les lecteurs friands de bandes dessinées pornographiques vont être déçus, le titre, même s'il invite aux fantasmes ne cache rien d'autre qu'une banale histoire, une tranche de vie d'une femme de quarante ans, mariée, mère de famille qui, après une longue période de chômage de plus de quinze années décide de se rendre à un entretien d'embauche à quelques dizaines de kilomètres de chez elle. Bien sûr, sans diplôme ni qualification, cela tourne court mais au lieu de rentrer directement chez elle, elle décide de s'octroyer une journée de liberté. Elle croise la route de Solange, une VRP qui l'invite à parler d'elle, ce qu'elle n'a encore jamais fait. C'est bien la première fois que quelqu'un s'intéresse à elle dont la vie, jusque là, se résumait à pas grand chose « J'ai parfois l'impression d'être presque une extension de la gazinière et du lave-linge », « ma vie ne me plaît pas, il ne se passe rien » avoue-telle. Poursuivant son projet de liberté temporaire, Lulu demande à Solange de l'emmener avec elle. Elle se retrouve donc au bord de la mer, en octobre, errant entre jetée et plage ou au hasard des rues, seule mais surtout ne cherchant pas à prévoir l’instant d’après, libre, apaisée, calme.
Les lecteurs friands de bandes dessinées pornographiques vont être déçus, le titre, même s'il invite aux fantasmes ne cache rien d'autre qu'une banale histoire, une tranche de vie d'une femme de quarante ans, mariée, mère de famille qui, après une longue période de chômage de plus de quinze années décide de se rendre à un entretien d'embauche à quelques dizaines de kilomètres de chez elle. Bien sûr, sans diplôme ni qualification, cela tourne court mais au lieu de rentrer directement chez elle, elle décide de s'octroyer une journée de liberté. Elle croise la route de Solange, une VRP qui l'invite à parler d'elle, ce qu'elle n'a encore jamais fait. C'est bien la première fois que quelqu'un s'intéresse à elle dont la vie, jusque là, se résumait à pas grand chose « J'ai parfois l'impression d'être presque une extension de la gazinière et du lave-linge », « ma vie ne me plaît pas, il ne se passe rien » avoue-telle. Poursuivant son projet de liberté temporaire, Lulu demande à Solange de l'emmener avec elle. Elle se retrouve donc au bord de la mer, en octobre, errant entre jetée et plage ou au hasard des rues, seule mais surtout ne cherchant pas à prévoir l’instant d’après, libre, apaisée, calme.
Elle s'est simplement contentée d'annoncer par téléphone à sa famille et à Cécile, son amie, sa petite escapade temporaire sans qu'elle sache vraiment combien de temps elle va durer. Chez elle, on s'inquiète, son mari, Tanguy, un être frustre, pas très fin et alcoolique qui commence à noyer son ennui dans la bière, ses deux fils, Morgane, sa fille de seize ans. Xavier, le mari de Cécile part à la recherche de Lulu. Pendant ce temps, notre aventurière rencontre Charles et en tombe amoureuse, décide de vivre avec lui quelques jours même s'il se révèle être un ancien taulard flanqué de ses deux frères, sorte de pieds nickelés marginaux, mais sympathiques et attachants. Xavier puis, à sa suite Margot et ses frères retrouvent Lulu mais décident de la laisser vivre cette passade. Elle repart donc à l'aventure, sur la route, sans argent et rencontre Marthe, une veuve solitaire mais philosophe qui lui offre son amitié et ses rillettes périmées contre la relation de son histoire et de ses journées désœuvrées. C'est un échange à la hauteur de cette histoire échevelée et même parfois un peu surréaliste mais peu importe, nous sommes dans une fiction, restons-y ! La vie s'écoule ainsi jusqu'à leur rencontre avec Virginie, une jeune serveuse de bar un peu paumée et exploitée par sa patronne. Un temps elle semble marcher avec ses deux comparses et veut tout envoyer par dessus les moulins mais finalement préfère son travail mal payé et précaire. Finalement tout rentrera dans l'ordre mais pas exactement comme avant, quand Lulu ne vivait que pour les autres.
Ce que je retiens de cette fable qui n'est peut-être pas si fictive que cela, c'est qu'elle est une illustration de ce « démon de midi » qui intervient dans chacune de nos vies, souvent sans prévenir et les illumine ou les pourrit, c'est selon. J'ai apprécié également l'humour subtil du texte et des dessins, le suspens qui irrigue tout ce récit puisque, au fil de cette lecture on ne peut pas ne pas penser que Lulu est morte à la suite de cette foucade. C'est en effet Xavier qui, au cours d'une nuit entre copains et à l'aide de bières, d'interrogations et d'états d'âme fait la relation de cette aventure de Lulu. Cela ressemble à une veillée funèbre. Ce n'en est pas une, quoique !
J'observe aussi que c'est la parole qui a pris le dessus sur le gris de la vie de Lulu et de Marthe. La couleur justement, elle varie entre la grisaille et le sépia, le bleu étant réservé au ciel et à la mer, symbole de cette liberté que le bord de la mer souligne et que Lulu attendait peut-être depuis longtemps sans oser sauter le pas. Pendant ces dix neuf jours qu'a duré son escapade, cette femme pas vraiment belle, mal habillée et pas sexy du tout a été elle-même pour finalement revenir au bercail entre enfants, mari et quotidien ménager. En fait de nudité, elle est beaucoup plus morale que physique et on imagine la vie future de Lulu, même dans son quotidien familial qui ne sera plus vraiment pareil après cette fugue.
Je ne suis pas familier des bandes dessinées mais là, j'ai bien aimé et cela a consisté pour moi en un bon moment le lecture, plein d'émotion, de tendresse, d'humanité.
© Hervé GAUTIER - juin 2014
Oscar et la Dame rose - Eric Emmanuel Schmitt
Oscar est un petit garçon espiègle de dix ans qui est soigné dans un hôpital pour enfants parce qu’il est atteint d'une leucémie. Il se surnomme lui-même « crâne d’œuf » à cause de la chimiothérapie qui lui a fait perdre ses cheveux. De même il donne à ses  copains des noms en rapport avec leur maladie, « Bacon » parce que c'est un grand brûlé, « Pop Corn » parce qu'il est énorme, « Peggy Blue » parce qu'elle a la maladie bleue... une façon comme une autre d'oublier la maladie avec l'aide de l’humour d'autant qu'il va sûrement mourir.
copains des noms en rapport avec leur maladie, « Bacon » parce que c'est un grand brûlé, « Pop Corn » parce qu'il est énorme, « Peggy Blue » parce qu'elle a la maladie bleue... une façon comme une autre d'oublier la maladie avec l'aide de l’humour d'autant qu'il va sûrement mourir.
Mamie-Rose c'est la bénévole qui vient lui rendre visite et qui a sympathisé avec lui. C'est une vielle dame, ex-catcheuse à ce qu'elle dit, qui revêt une blouse rose pour entrer dans sa chambre. Il l'aime plus que ses propres parents qui pourtant viennent le voir avec régularité et lui apportent des cadeaux dont il n'a que faire. Il sent qu'ils lui mentent et cela ne lui plaît guère. Pourtant ils l'aiment mais ne peuvent rien face à cette maladie qui va l'emporter. Ils se préparent à cette issue fatale sans trop le montrer à leur enfant. C'est que nous sommes dans la période de Noël, exactement douze jours avant et ce petit garçon, à l'instigation de la dame rose, entreprend d'écrire à Dieu une lettre par jour en lui demandant de venir le voir et en lui racontant tout ce qui lui arrive, une manière aussi de dérouler un compte à rebours puisque sa greffe de moelle osseuse n'a pas pris et qu'il le sait.
C'est aussi cette même Mamie-Rose qui lui propose d'accélérer le temps et d’imaginer qu'à une journée correspond une décennie, une façon comme une autre d'avoir droit à une vraie vie, complète, comme les autres. D'ailleurs il se prend au jeu, se choisit une fiancé en la personne de « Peggy Blue », en tombe amoureux, l'épouse, se constitue une famille fictive et fait semblant de croire à tout cela même quand son « épouse » sort de l'hôpital, guérie ! Avec son stratagème du temps accéléré, ils ont passé leur vie ensemble et c'est l'essentiel. Oscar est mort pourtant parce que la maladie a été la plus forte, mais il a choisi de partir quand ses parents et Mamie-rose étaient partis boire un café, un peu comme le petit prince de Saint Ex, avec cette simple phrase comme épitaphe « Seul Dieu a le droit de me réveiller »
C'est une fable, bien sûr mais elle est émouvante parce qu'il est question de la souffrance et de la mort qui sont notre lot à tous. Pourtant tout cela n'est pas triste, pas dramatique comme cela aurait pu l'être, à cause du style volontairement simple, naïf, naturel, comme celui d'un enfant. Le fait de s'adresser à Dieu à l’instigation de la vielle dame est à la fois puéril et sérieux. En contrepoint il y a la mort qui dans nos civilisations occidentales est à la fois tabou et désespérante et pourtant ce roman ne tire pas de larmes. Il est à la fois cocasse et poétique.
Comme il le dit lui-même, la vie n'est pas un cadeau, c'est juste un prêt, nous n'en sommes que les usufruitiers alors que nous agissons comme si nous étions immortels. Il n'est pas inutile de la rappeler aussi simplement que cela.
©Hervé GAUTIER – N° 749 – Mai 2014
Les creux de maisons - E Pérochon (Ed. du Rocher)
« Les Creux de Maisons », c'était ces cabanes insalubres du bocage vendéen où se réfugiaient jusqu'au début du XX° siècle les plus pauvres, des journaliers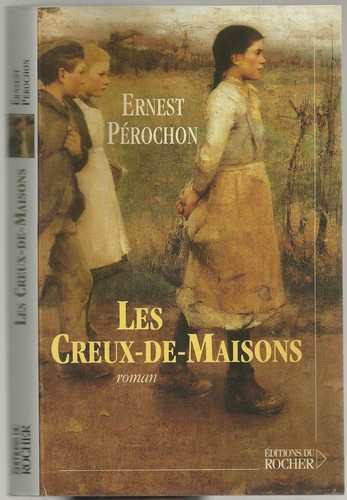 qui n'avaient pour toute richesse que leurs bras et qui travaillaient comme des esclaves pour un salaire de misère ou qui, trop démunis, envoyaient leurs jeunes enfants mendier, souvent pieds nus, de ferme en métairie quelques quignons de pain et de la nourriture ; on les appelait les « cherche-pain ». Séverin Pâtureau a été l'un d'eux. Au début du roman, nous le voyons revenir du service militaire, quatre longues années passées sur la frontière de l'Est de la France, dans une ville de garnison. Il est maintenant un homme comme l'atteste la moustache qu’il porte fièrement puisque, à l'époque, cet épisode de la vie correspondait à un passage initiatique : quand on avait été soldat, tout devenait possible puisqu'on avait servi sa Patrie sous l'uniforme. Il se gage donc comme valet dans les environs de Bressuire et ne tarde pas à rencontrer Delphine, la fille d'un meunier qui l'aimait depuis l'enfance. Il la « fréquente » puis l'épouse. Ils s’établissent eux aussi dans un « creux de maison », lui restant valet et elle travaillant en journées, de quoi vivre heureux, rêver, faire le projet de « prendre une terre », une borderie, c'est à dire travailler pour son compte et non plus pour les autres ou peut-être partir pour les Charentes plus riches et ouvertes au machinisme agricole. Tout cela ne sont que des chimères et, à la suite d'une mauvaise querelle, tout bascule et Séverin perd sa place. Le voilà journalier. L'absence totale de contraception qui génère des familles anormalement nombreuses que les parents ne peuvent nourrir, la maladie, la raréfaction du travail font que cette famille connaît la misère, la famine puis la mort de Delphine après son sixième accouchement. Selon la tradition une grand-mère vient aider Séverin à élever ses enfants, mais cette situation nouvelle oblige l'aînée à se transformer en « cherche-pain » à son tour, au grand dam de son père. Certes les Pâtureau sont aidés par la collectivité et Séverin est dur à sa peine malgré son âge mais ils sont pauvres et le seront toute leur vie. Il se fait même braconnier pour survivre et bien entendu il se fait prendre, perd son travail et l’aînée meurt.
qui n'avaient pour toute richesse que leurs bras et qui travaillaient comme des esclaves pour un salaire de misère ou qui, trop démunis, envoyaient leurs jeunes enfants mendier, souvent pieds nus, de ferme en métairie quelques quignons de pain et de la nourriture ; on les appelait les « cherche-pain ». Séverin Pâtureau a été l'un d'eux. Au début du roman, nous le voyons revenir du service militaire, quatre longues années passées sur la frontière de l'Est de la France, dans une ville de garnison. Il est maintenant un homme comme l'atteste la moustache qu’il porte fièrement puisque, à l'époque, cet épisode de la vie correspondait à un passage initiatique : quand on avait été soldat, tout devenait possible puisqu'on avait servi sa Patrie sous l'uniforme. Il se gage donc comme valet dans les environs de Bressuire et ne tarde pas à rencontrer Delphine, la fille d'un meunier qui l'aimait depuis l'enfance. Il la « fréquente » puis l'épouse. Ils s’établissent eux aussi dans un « creux de maison », lui restant valet et elle travaillant en journées, de quoi vivre heureux, rêver, faire le projet de « prendre une terre », une borderie, c'est à dire travailler pour son compte et non plus pour les autres ou peut-être partir pour les Charentes plus riches et ouvertes au machinisme agricole. Tout cela ne sont que des chimères et, à la suite d'une mauvaise querelle, tout bascule et Séverin perd sa place. Le voilà journalier. L'absence totale de contraception qui génère des familles anormalement nombreuses que les parents ne peuvent nourrir, la maladie, la raréfaction du travail font que cette famille connaît la misère, la famine puis la mort de Delphine après son sixième accouchement. Selon la tradition une grand-mère vient aider Séverin à élever ses enfants, mais cette situation nouvelle oblige l'aînée à se transformer en « cherche-pain » à son tour, au grand dam de son père. Certes les Pâtureau sont aidés par la collectivité et Séverin est dur à sa peine malgré son âge mais ils sont pauvres et le seront toute leur vie. Il se fait même braconnier pour survivre et bien entendu il se fait prendre, perd son travail et l’aînée meurt.
Il s'agit d'un roman rural, si on veut l'appeler ainsi où l'auteur dépeint la vie dure d'un monde de paysans pauvres de l'ouest de la France. Dans sa préface, Pérochon indique qu'il ne veut pas se faire le chantre d'une quelconque vision idyllique et pastorale de cette vie mais, au contraire, en dépeindre la rudesse. Pérochon se fait le témoin de ce temps heureusement révolu où les foires n'étaient pas seulement destinées aux transactions commerciales mais servaient aussi à rencontrer son futur conjoint, où la messe était incontournable. Il parle des coiffes, des coutumes, mêlant le patois aux descriptions poétiques de la nature, dénonçant au passage les processions catholiques ou des rituels païens pour faire tomber la pluie ! A travers une galerie de portraits qui témoigne d'une attentive observation, il croque toute une société rurale, n’épargnant ni le clergé ni les maîtres ni les fermiers, campant un décor de misère, fait d'augmentation du coût de la vie, de familles exagérément nombreuses, d'exode rural...
Ce roman paraît en 1912 en feuilleton dans « L’Humanité » puis aux frais de l'auteur l'année suivante. Ernest Pérochon [1885-1942] est alors instituteur dans le nord des Deux-Sèvres. Après sa mobilisation en 1914, il obtint le Prix Goncourt en 1920 pour son roman « Nêne » (paru en 1914), de la même inspiration, grâce au soutien actif de Gaston Chérau [1872-1937] journaliste et écrivain, deux-sévrien comme lui. C'est bien sûr son œuvre la plus connue mais, à mon avis et sans bien entendu dévaluer en rien les mérites de « Nêne », Pérochon eût mérité ce prix pour « Les Creux de Maisons ». Ce fut le départ de son abondante production romanesque mais il est également l'auteur de poèmes, de contes pour enfants et même de romans de science-fiction. Il devint ensuite un homme de Lettres reconnu jusqu'à sa mort en 1942, victime de brimades de la part du régime de Vichy qu'il refusait de servir. Son œuvre fut quelque peu oubliée jusqu'en 1985 où l'on célébra le centenaire de sa naissance, date à partir de laquelle ses romans furent réédités et sa mémoire entretenue par des conférences et des expositions. Il est actuellement célébré à la hauteur de son talent et ce n'est que justice pour cet écrivain injustement oublié pendant si longtemps.
J'ai très tôt connu le nom d'Ernest Pérochon, mais pas son œuvre. En effet, avec Pierre Loti et Anatole France, il était l'auteur des dictées qui à l'époque étaient le quotidien de l'école primaire. C'était pour moi une épreuve redoutée qui ne fut cependant pas une invitation à découvrir ses romans, découverte qui ne vint que bien plus tard. Je l'apprécie maintenant comme un serviteur de notre belle langue française.
©Hervé GAUTIER – n° 740 - Avril 2014
Au revoir la haut - Pierre LEMAITRE (A Michel-Goncourt 2013)
« Alors au revoir, au revoir là-haut, ma Cécile, dans longtemps » Telles sont les dernières paroles du soldat Albert Maillard qui, au fond d'un trou d'obus va mourir. Elles font écho à l'exergue en tête du roman et lui donnent son titre.
La trame de cette fiction, car c'en est une, est finalement une suite de rencontres comme le hasard nous e réserve parfois dans la vraie vie. Ici, c'est la Grande Guerre qui favorise celle du 2° classe Albert Maillard qui frôle la mort par ensevelissement dans un trou d’obus et le soldat Édouard Péricourt qui lui sauve la vie au péril de la sienne. Ils sortiront de ce conflit pas mal cabossés, surtout Édouard, mais vivants et unis par un lien amical solide. Si Albert n'est rien qu'un simple salarié, un homme du peuple, son camarade est le fils un peu délaissé parce que trop artiste et efféminé du banquier bien connu qui a fait sa fortune sur les crises successives. Il a eu la mâchoire arrachée refuse la greffe et le retour dans sa famille et naturellement c'est Albert qui qui va s'occuper de cet homme défiguré, tenté un temps par la mort et dont il ignore tout. Il va subvenir à ses besoins et le ramener à la vie. Son état est si désastreux qu'il va même jusqu'à le faire mourir, mais fictivement, en intervertissant son livret militaire avec celui d'un « poilu » mort : officiellement il devient donc Eugène Larivière. Albert, à qui la guerre a tout pris, son emploi, sa femme parti avec un autre, ses illusions, s'occupe dans la vie civile quotidienne à la quelle ils ont été rendus, de cette « gueule cassée » qui maintenant est dépendant à la drogue qui apaise ses souffrances. Édouard-Eugène qui refuse toujours de revenir dans sa famille où sa mort est presque passée inaperçue, sauf peut-être pour Madeleine sa sœur, ne peut rien attendre de l’État au titre des soins puisqu’il est officiellement mort. Il se contente de porter des masques qui cachent son image insoutenable et de rester cloîtré.
Rencontre encore quand le capitaine d'Aulnay-Pradelle, noblaillon « fin de race », prêt à tout pour se faire valoir et parfois même à tuer y compris ses propres soldats mais surtout désargenté, va croiser la route de Madeleine Péricourt venue chercher le corps de son frère. Il l'épousera pour redorer son blason et son patrimoine, la trompera et son mariage partira à vau-l'eau. La libération fera de lui un affairiste inhumain et méprisant pour ses semblables qui se jettera dans des transactions douteuses. La République qui avait si bien su mener ses enfants à la boucherie va oublier les survivants et s'occuper des morts puisqu'il faut bien célébrer la victoire et surtout préserver les apparences. C'est là que Pradelle intervient puisque, maintenant introduit par son mariage dans la société dirigeante, va monter une société qui sera chargée, par adjudication, d'exhumer les soldats morts des champs de bataille et de les inhumer dans de grandes nécropoles. L'affaire faite de trucages des marchés publics, de malfaçons, de vols et de corruption tournera court et Pradelle, lâché par tous mourra seul et ruiné.
De son côté, Albert qui a à sa charge Édouard survit comme il peut avec peu de ressources. On ne donne pas cher de leur avenir à tous les deux quand ledit Édouard a une idée de génie. Lui qui a un don pour le dessin décide de l'exploiter quand l’État incite les communes de France à honorer leurs enfants en érigeant un « monument aux morts ». Partant du principe que plus un mensonge est gros plus il prend, notre dessinateur va, sans sortir de chez lui, monter une arnaque baptisée du nom ronflant de « Souvenir Patriotique » qui fait appel aux subventions publiques d'ailleurs maigres mais surtout à la souscription. C'est, certes, escroquer les petites gens qui avaient perdu un proche à la guerre et donc une insulte aux morts mais pour eux, c'est une revanche. L'affaire réussit bien au-delà de leurs espérances et pour eux un départ sous d'autres cieux plus cléments pour les délinquants est maintenant inévitable. Là non plus tout ne se passera pas comme prévu et le scandale éclatera.
Parce que la morale doit toujours être sauve, le père Péricourt, maintenant bourrelé de remords à cause de la disparition de son fils à côté de qui il est passé délibérément avant ce drame, y laissera quelque argent et sûrement davantage, Pradelle retrouvera une place qu'il n'aurait jamais dû quitter et nos deux acolytes ne profiteront pas vraiment de cette fortune mal acquise.
J'ai lu ce roman jusqu'à la fin avec passion autant pour connaître l'épilogue que pour le plaisir de lire le texte. Ce n'est pourtant pas à cause du style fort peu académique mais peu importe. J'avoue que j'ai volontiers goûté l'humour subtil des phrases, la manière à la fois caustique et fluide avec laquelle Pierre Lemaître s'exprime [j'ai même parfois souri à certains bons mots bien que le sujet ne s'y prête pas vraiment]. Je ne l'ai pas fait non plus à cause de l'attribution de ce prix prestigieux. J'ai déjà déploré maintes fois dans cette chronique qu'il ait été attribué à des romans qui ne le méritaient pas ; Je l'ai pourtant lu avec gourmandise à cause de l'histoire pleine de suspense, de l'étude psychologique des personnages qui s'accompagne d'un réel sens de la formule et du culte du détail. C'est une authentique évocation de l’espèce humaine qui n'est ni respectable ni fréquentable mais à laquelle nous appartenons tous. Ce qui a aussi retenu mon attention c'est sans doute le montage de cette arnaque, certes fictive mais quand même géniale autour des débris de cette guerre qu'on a baptisée Grande (avec une majuscule) et que l’État voulait vite oublier comme il voulait oublier ceux qui l'avait faite, vivants ou morts. On avait su les trouver, les forcer à se battre, à vivre dans des conditions inhumaines, à mourir « Pour la Patrie », on saurait bien les abandonner (comme toujours) malgré toutes les déclarations lénifiantes et patriotiques des hommes politiques et les commémorations hypocrites ! Et ceux qui étaient décidés à profiter des commandes de l’État autour du transfert des morts ne manquaient pas. J'y ai lu aussi l'histoire d'une amitié entre deux anciens combattants devenus frères d'armes un peu par hasard, à la fois inventif et flamboyant pour Édouard et maladivement inquiet pour Albert aussi dissemblables l'un de l'autre par leur vie, leur classe sociale, leur culture. Leur expérience du champ de bataille les a définitivement unis, eux qui appartiennent à cette génération délibérément sacrifiée sur l'autel de la Patrie.
Je ne connaissais pas Pierre Lemaître avant ce roman réellement captivant qui fut pour moi un grand moment de lecture. Je crois bien que je vais continuer à explorer son œuvre.
Hervé GAUTIER – n° 734 - Mars 2014
Cheval de guerre- Michael Morpurgo (Folio Junior)
Traduit de l'anglais par André Dupuy.
Au moment où nous célébrons le centenaire de la Première Guerre mondiale, où les livres qui paraissent sur le sujet sont inspirés ou rendent compte des témoignages de poilus, j'ai trouvé assez original de donner la parole à un cheval qui, lui aussi avait participé aux combats. Il s'agit donc d'un roman écrit en 1982 et adapté au cinéma par Steven Spielberg en 2011 où un cheval raconte sa vie à la première personne.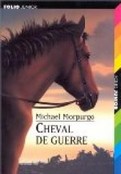
Elle commence à la veille de la Grande Guerre, il est acheté par un fermier alcoolique dont le fils âgé de 13 ans, Albert, s'attache à lui, le baptise Joey, le monte chaque jour, le fait travailler. Il devient rapidement une belle bête. Cependant la guerre éclate et l'armée achète le cheval qu'Albert ne peut suivre, trop jeune pour s'engager. De cheval de ferme, il devient donc monture de cavalerie mais le régime n'est pas le même et Joey rencontre Topthorn, un autre étalon. Ils partent ensemble pour la France et le théâtre des combats. Le capitaine Nicholls qui l'avait pris en amitié au point de le peindre, avait promis à Albert de s'occuper personnellement est tué lors d'un affrontement et Joey est confié au soldat Warren qui s'attache à lui.
L'art de la guerre qui excluait maintenant les charges de cavalerie le transforme en bête de trait pour l'artillerie, toujours en compagnie de Tophorn mais ils tombent tous les deux aux mains des Allemands qui les versent dans le service de santé. Les voilà chevaux d'ambulances. Après pas mal d'errements, il revient dans le camp anglais mais sans Tophorn qui a trouvé la mort et termine la guerre comme un véritable soldat. Notre cheval survit à la mitraille, à la maladie et même à une mort annoncée, et tant mieux si cela tient du miracle. C'est vrai que c'est une bête d'exception [« Je te le dis mon ami, dans un cheval , il y a quelque chose de divin, particulièrement dans un cheval comme celui-ci »] et cela mérite bien un happy-end.
C'est l'occasion pour l'auteur de glisser pas mal de réflexions sur l'absurdité de la guerre et sur la folie des hommes. C'est donc une sorte de fable, un peu dans ma manière de La Fontaine, la rime et la morale en moins mais l'émotion en plus. C'est donc une fiction qui emprunte autant à la réalité qu'à l'imagination de son auteur et Joey quelque soit l'endroit où il est, réussit à s'attacher les hommes qu'il côtoie, militaires ou civils, à ne laisser personne indifférent. Il y a entre eux une véritable complicité
et même davantage. L'auteur prête à ce cheval décidément hors du commun une vie d'homme mais quand il est sur le champ de bataille on a des égards pour lui, on ne lui tire pas dessus parce qu'il n'a pas d'uniforme mais aussi parce qu'un cheval est précieux et c'est sans doute ce qui lui sauve la vie quand tant de ses congénères trouvent la mort dans la tourmente, comme les hommes d'ailleurs.
C'est un conte pour enfants et comme tel il doit bien se terminer parce qu'ils ne comprendraient pas qu'il en soit autrement. Il faut laisser à l'enfance tout le merveilleux qui va avec, ils auront bien le temps, quand ils auront grandi, de comprendre et peut-être d'admettre que tout cela est faux mais après tout, cela n'a pas beaucoup d'importance !
N° 722 - Février 2014.
Le pigeon - Patrick SÜSKIND FAYARD.(1987)
Tout est médiocre chez Jonathan Noël, son emploi actuel de vigile dans une banque, sa jeunesse sans joie séparée de sa mère déportée dans un camp de concentration et de son père lui aussi disparu, sa vie d'enfant recueilli par un oncle, caché pendant la durée de la guerre puis employé comme travailleur agricole. Plus tard, en 1953, il fut sommé par ce parent de s'engager pour combattre en Indochine, ce qu’il fit docilement. Ce furent trois années tristes au terme desquelles il apprit que sa sœur aussi avait disparu. A son retour, cet oncle tyrannique exigea qu’il épouse une jeune fille qu'il n'avait jamais vue, ce qu'il accepta, pensant trouver enfin le bonheur et le calme. Las, elle était enceinte d'un autre avec qui elle partit. La seule chance qu'il eut fut de trouver près de la banque parisienne où il travaillait, une petit chambre de bonne sans confort au sixième étage d'une maison bourgeoise où d'emblée il se trouva bien et qu'il aménagea à son goût. Bien des années plus tard, alors qu'il est maintenant près de la retraite, il va l'acheter pour y être complètement chez lui. C'est donc un être rangé et solitaire qui vit au jour le jour depuis longtemps sans trop se poser de questions et surtout en évitant le plus possible les relations avec les autres hommes[« De toutes ces péripéties, Jonathan Noël tira la conclusion qu’on ne pouvait se fier aux humains et qu'on ne saurait vivre en paix qu'en les tenant à l'écart »]. Lui qui n'a pas vraiment eu de femme dans sa vie, sa petite chambre est « sa maîtresse car elle l’accueille tendrement en elle ».
Lui qui, d'ordinaire prenait soins de ne rencontrer personne quand il sortait de sa chambre tombe dans le couloir, un matin, nez à nez avec un pigeon. Cette rencontre fortuite le bouleverse au point que, dans son travail, il commet pour la première fois quelques étourderies dans son service, déchire son pantalon, événements sans importance mais qui, à ses yeux, prennent la dimension d'un drame puisqu'il se croit fini. Il envie même le clochard qui lui vit en liberté et sans aucune contrainte ; il en conçoit une véritable admiration lui pour qui la vie n'est qu’obéissance, qu'apparences, que subordination, que déférence. Alors qu'il a largement passé la cinquantaine et qu'il devrait pouvoir relativiser bien des choses de la vie, la rencontre avec ce pigeon le perturbe tellement qu'il va jusqu’à dormir à l'hôtel pour ne pas avoir à le rencontrer de nouveau, passe une nuit tourmentée qu'un orage d'été va venir inopportunément troubler en faisant revivre des souvenirs douloureux de son enfance. Il parvient cependant a surmonter cette épreuve, rentre chez lui pour constater que le pigeon a disparu, ce qui l'apaise. Bizarrement, cet être tourmenté revit son enfance mais celle d'avant la disparition de sa mère et éprouve un plaisir puéril à patauger dans les flaques d'eau. C'est un peu comme si l 'orage en éclatant l'avait délivré de ses phobies.
Voilà donc l'histoire apparemment sans relief de cet homme. Il m’apparaît qu'elle illustre une sorte de phobie des êtres humains, pas forcement de la vie qui s’arrêtera un jour, mais de ses semblables qui ne lui ont réservé que des déboires et qui sont la vraie source de tous ses malheurs. Sa vie qu'il a organisée lui-même et qui est volontairement en retrait du monde extérieur ne peut même pas s’accommoder de la présence d'un pauvre volatil arrivé là par hasard et qui provoque chez lui une véritable angoisse. Il y a toute une symbolique dans ce personnage à la fois lié à une divinité chrétienne par son nom et son prénom et par la vie quasi-monacale qu'il mène. Comme un ascète ou un mystique, il voit dans ce pigeon bien innocent qui intervient dans sa vie si bien réglée la personnalisation du mal au point qu'il la bouleverse. Il vit volontairement coupé des autres mais les humains ne lui sont pour autant pas étrangers puisqu’ils l'observent et en est conscient. A cet égard, le spectacle du clochard lui inspire une sorte d’injustice puisqu'il vit sans contrainte alors que lui qui a fait toute sa vie son devoir d'état vit un véritable malaise puisqu'un simple pigeon est capable de venir troubler un équilibre décidément bien précaire. La thématique de l’œil, celui du pigeon (« Cet œil, un petit disque rond, brun avec un point noir au centre était effrayant à voir... C'était un œil sans regard. Et il fixait Jonathan ») mais aussi celui de la couturière grossi par ses lunettes en est la marque. Même s'il refuse le monde des humains Jonathan Noël en fait cependant partie. Non seulement il doit travailler pour vivre mais aussi il a avec lui un minimum de contacts inévitables. Il partage avec la race humaine qu'il fuit des caractéristiques et pourtant il est seul au point de n'échanger que peu de mots avec la concierge et surtout de se parler à lui-même, à la deuxième personne.
Les déjections en sont une marque qu'il retrouve dans la saleté apparente du pigeon, celles des matières fécales de l'oiseau mais aussi celles du clochard (alors qu'il avait éprouvé une certaine attirance pour sa vie libre, dès lors qu'il l'a vu déféquer en pleine rue, il en a conçu du dégoût, du mépris et de la pitié) et même la répulsion qu'il éprouve face à sa propre urine rappellent aussi la décomposition, la vieillesse et la mort qui nous attend tous. Dans cette chambre qui a les dimensions d'un cercueil, il songe au suicide
Ce récit est une méditation sur la vie qui n'est pas aussi belle que tous ceux à qui elle a souri veulent bien le proclamer, sur la fragilité du bonheur patiemment et même égoïstement tissé et peut-être aussi de l’être humain. La réaffirmation que les autres (et bien souvent nos proches qui sont bien plus à même de pratiquer la trahison et l'hypocrisie) sont trop souvent la source de nos maux peut paraître un truisme mais, à mon sens, il n'est pas inutile de le rappeler et de l'illustrer ainsi par une histoire romancée.
Cette chronique s'est déjà intéressée à l’œuvre de Süskin (La Feuille Volante n° 157 à propos de « La contrebasse » et n°159 à propos du «Parfum »). Cela a toujours été une intéressante invitation à la réflexion.
Traduction de l'allemand par Bernard Lortholary
©Hervé GAUTIER – N° 716 - Janvier 2014
14 - Jean Echenoz Éditions de Minuit
Nous sommes en août 1914 dans un paysage de Vendée et c'est la mobilisation générale. Selon l'image d’Épinal depuis longtemps établie l'engouement pour la guerre est général, même si, n'étant pas de cette génération j'ai toujours eu un peu de mal à y croire. Il faut dire que, pour qu'ils partent « la fleur au fusil », on avait mis les hommes en condition : « Cela n'allait pas durer longtemps, l'Allemagne sera vaincue, nous sommes les plus forts, Vous serez de retour pour Noël... » Dans ces conditions on ne pouvait qu'être optimistes ! Parmi les hommes qui partent, il y a Anthime, Charles, deux frères qui ne se ressemblent pas mais qui appartiennent à une famille de notables qui dirige l'usine locale de chaussures Borne-Seze. Quand Anthime a volontiers des copains dans le peuple, Charles détonne avec ses airs supérieurs. Avec Padioleau, Bossis et Arcenel tous sont incorporés le même jour, dans le même régiment qui part pour les Ardennes. Il y a aussi ceux qui restent. Blanche Borne, une jeune fille tout à fait comme il faut est de ceux-là. Elle est la fille unique du directeur de l'usine. Elle les attendra l'un et l'autre. Rapidement il apparaît qu'elle est enceinte des œuvres de Charles et pour lui éviter de se faire tuer au front où les choses se gâtent, il est muté, par protection dans l'aviation naissante mais trouve la mort rapidement. Anthime quant à lui reçoit le baptême du feu sans y avoir été vraiment préparé, encouragé par une anachronique batterie- fanfare dépêchée au milieu des combats. Ses lettres à Blanche dépeignent une situation catastrophique, des blessés, des morts, le froid, les tranchées, les poux, les rats, la neige, la mitraille, les bombardements, les charges meurtrières...
A l'arrière on s'organise et les femmes prennent la place des hommes. Blanche met au monde Juliette. Elle prend le nom de sa mère, Charles, non marié avec elle, est déjà mort. Anthime, lui, s'adapte aux circonstances qui ne sont guère brillantes. Il faut dire qu'il s'est toujours fait à tout. Pourtant, dans les tranchées le chaos s’installe et avec lui la peur des obus, de l’explosion des sapes, la mort aveugle qui rode, la putréfaction des cadavres, la boue, le terrain gagné et reperdu... Restent les autres compagnons d'infortune, ceux des Vendéens qui ont été incorporés en même temps que lui. Ils s'étaient un peu perdu sde vue au hasard des opérations mais leur amitié militaire leur avait permis de supporter la guerre. Certains avait été tués ou manquaient à l'appel et Arcenel, après un moment d'absence s'éloigne vers l'arrière. Repris il sera considéré comme déserteur et fusillé pour l'exemple. Il s'adapte à tout cet Anthime, même au pire puisque, après deux ans de combat, il perd son bras droit emporté par un éclat d'obus. Cette blessure providentielle fait de lui certes un invalide mais surtout un démobilisé. Pour lui la guerre est finie, il peut rentrer chez lui et retrouver Blanche en deuil. Par hasard, il retrouve Padioleau qui a perdu la vue à cause des gaz. Ils parleront ensemble de cette guerre meurtrière qui n'en finit pas mais finiront par s'ennuyer à ces évocations.
Anthime qui souffrait de son bras absent et qui ne pouvait plus guère effectuer son travail de comptable se voit intégré à la place de Charles, au collège de direction de l'entreprise. Les commandes de guerre profitent largement à cette usine de chaussures qui travaille pour l'armée mais qui en profite pour livrer des brodequins d'une piètre qualité ce qui attire l'attention des militaires et provoque un procès qu'il faudra aller défendre au tribunal de commerce de Paris. Pour faire bonne mesure on prend des sanctions et c'est bien entendu le lampiste qui prend, contre un belle indemnités cependant. Blanche sera déléguée au procès pour représenter et défendre l'entreprise. Anthime bien entendu l'accompagne. Elle deviendra sa femme et la mère de son fils prénommé Charles.
Il s'agit du 15ème roman de Jean Echenoz qui n’est pas un inconnu pour cette revue (La Feuille Volante n° 408, 412, 413...) rompt ici avec sa série de romans biographiques, « Ravel » consacré à Maurice Ravel (2006) (La Feuille Volante n° 425), « Courir » qui parlait du coureur Émile Zatopeck, (2008) (La Feuille Volante n° 407), « Des éclairs » qui évoquait le physicien Nicolas Tesla (2010) (La Feuille Volante n°492). Il ne parle pas du déroulement des opérations militaires, ce n’est pas une de ces grandes fresques historiques auxquelles on nous a habitués mais a trouvé son prétexte à partir de carnets de guerre découverts dans sa famille. Ce texte assez court rend compte de détails de la vie de poilus, des hommes de base dans les tranchées au quotidien d'une manière à la fois émouvante et simple. Il le fait avec son habituel style qu'il teinte d'un certain humour bien que le sujet ne s'y prête guère. Quant à l'épilogue, il ne surprendra sans doute personne.
Je n'ai pas été déçu par ce dernier roman qui se lit très facilement. Ce fut, comme d'habitude, un bon moment de lecture.
N° 699 - Novembre 2013
Blood Ties Un film de Guillaume CANET
Nous sommes à New-York en 1974 . Chris, la cinquantaine sort d'une longue peine de prison pour un meurtre. Son frère, Franck, plus jeune, vient le chercher mais ne se sent pas très à l'aise, évidement lui est policier et son frère est un assassin. Il y a autre chose : les deux frères ne se connaissent pratiquement pas, ont eu des vies parallèles et même rivales et ce depuis l'enfance ; Le père, Léon qui avait une préférence pour Chris malgré la prison qu’il a connue très tôt, a fait ce qu'il a pu pour élever ses trois enfants mais le départ de leur mère a déséquilibré cette famille qui aurait pu être heureuse.
Quand Chris sort de prison, il reprend contact avec sa famille, avec Franck évidemment mais aussi avec son père malade et avec sa sœur qui voudrait bien reconstituer cette famille déchirée. Il reproche à son frère de ne pas être venu le voir pendant toutes ces années d'incarcération et lui ne peut que lui opposer son métier de policier, ce qui est évidemment une mauvaise raison. Les deux frères auraient dû être complices au cours de leur adolescence mais un minable cambriolage qui s'est terminé par l'arrestation de Chris les a définitivement séparés, Franck l'ayant trahi au dernier moment. C'est pour Chris le départ d'un long parcours dans la délinquance. Il ne cessera de fréquenter les tribunaux.
Pourtant, à sa sortie de prison, Franck héberge son frère, l'aide à renouer les relations avec ses enfants et son ex-femme, Monica, lui trouve un travail pour justifier sa réinsertion, mais c'est un emploi précaire, mal payé, peu valorisant. Et puis on se méfie de cet ancien taulard qui perd patience et joue même de malchance dans sa volonté de se réadapter. Chris fait preuve apparemment de bonne volonté, rencontre Nathalie avec qui une nouvelle vie rangée devient possible. Pourtant, ses anciens amis le contactent et, bien entendu, il replonge. Ce sera le départ d'une série de braquages qui feront de lui un homme riche mais toujours un marginal. Pire peut-être, il monte une affaire de prostitution dans laquelle Monica se retrouve promue mère-maquerelle et trafiquante de drogue. Elle sera dénoncée et la police remontera jusqu'à Chris.
De son côté Franck qui est pourtant un bon flic, doit affronter ses collègues et sa hiérarchie : On le soupçonne de jouer un double jeu surtout quand il croit reconnaître Chris qu'il blesse dans un casse qui tourne mal. Il rompt définitivement les liens avec son frère et préfère quitter la police. Ni la mort de leur père, ni les fêtes de famille sous l'égide de leur sœur ne parviennent à ressouder ce « lien du sang » définitivement rompu entre les deux frères. C'est vrai qu'ils sont bien différents. Chris a pour les femmes l'aura du mauvais garçon et n'a aucun mal à conquérir Nathalie. Franck, lui, n'a rien d'un Don Juan, a toujours été un garçon timide, réservé mais aussi un peu gauche avec les femmes. Il aggrave même son cas en renouant avec Vanessa, une ancienne amie mais qui est azussi la compagne d'Anthony Scarfo, un malfrat violent que Franck a jadis arrêté et fait jeter en prison. Quand ce dernier sort, il harcèle le policier et sa compagne et menace de tuer Franck.
Le « lien du sang » sera renoué à la fin, mais avec celui de Scarfo que Chris, malgré le fait que la police le recherche n'hésite pas, dans la gare de « Grand Central », à tuer Scarfo pour protéger son frère et ainsi lui sauver la vie. En agissant ainsi, il sacrifie son propre avenir. Bien entendu il retournera en prison pour longtemps alors qu'on peut imaginer que Franck, réhabilité par le geste de son frère, pourra réintégrer la police et être heureux avec Vanessa.
Même s'il s'agit d'un remake du film de Jacques Maillot « Les liens du sang » de 2008, le thème du film jouant sur l'opposition au sein d'une même famille entre un flic et un voyou me semble pertinente. D'autre part la distribution est somptueuse et le jeu des acteurs convainquant.
Hervé GAUTIER - n° 692 - Novembre 2013
Bleus horizons Jérôme GARCIN (Ed. Gallimard)
Jean de la Ville de Miremont, 28 ans, employé à la Préfecture de la Seine, était-il l'exacte illustration de cette image d’Épinal qui a montré les militaires, conscrits pour la plupart, partir au combat la fleur au fusil, persuadés qu'ils seraient de retour à Noël ? Se considérait-il, de part ses origines aristocratiques ou de sa confession chrétienne comme comptable de l'intégrité du territoire national ou le défenseur des valeurs patriotiques ? Devait-il à son côté poète des idéaux inatteignables ? Lui qui avait été réformé à cause d'une santé fragile insista pour s'engager, « pour la seule durée des hostilités ». Avait-il eu la prémonition de sa mort ? Il fut tué au tout début du conflit, en novembre 1914 au « Chemin des Dames » !
Le prétexte de ce roman est le témoignage reconstitué et réécrit par Jérôme Garcin de l'amitié exceptionnelle de Louis Gémon, (1885-1942), obscur poète selon ses propres dires et de Jean de la Ville de Miremont (1886-1914) poète et romancier prometteur fauché en pleine jeunesse dans sa tranchée presque sous les yeux de son ami. Cette amitié basée principalement sur l'amour de la littérature débuta à Libourne lors de leur incorporation puis s'affirma dans les tranchées, autant dire qu'elle fut de courte mais intense. Après la mort de Jean de La Ville, Gémon s'attacha , pendant toute sa vie, avec abnégation et admiration, à faire connaître l’œuvre de son ami. Il le fit certes au nom du devoir de mémoire pour l'arracher à l'indifférence et à l'oubli mais aussi pour le faire revivre, pour que son écriture qu'il jugeait indispensable à la littérature fût connue de tous, lui dont l'existence avait été si injustement et si violemment interrompue. Il insista longtemps pour que cette œuvre fût publié chez Grasset, sut motiver François Mauriac qui fut l'ami de Jean et qui signa une préface et Gabriel Fauré qui mit quelques-uns de ses poèmes en musique, notamment « Vaisseaux, nous vous aurons aimés » mais surtout il sacrifia sa vie professionnelle, son bonheur conjugal et sa propre existence à cette mission parce que son ami avait fait de lui, au fond de sa tranchée, son véritable exécuteur testamentaire littéraire (Jean avait laissé à Louis un recueil de poèmes, « L'horizon chimérique » pour qu'il le publie si d'aventure il mourrait avant lui). En effet, Gémon qui était aussi un auteur, s'effaça constamment devant Jean, vécut en présence de ce fantôme au point qu'il accepta que sa compagne le quitte, lassée de cette quête qu’elle jugea impossible (« J’ai cru que je survivais à Jean, mais la vérité, c’est que je me suis tué pour lui. Je lui ai tout sacrifié, au point d’en oublier de respirer. Je n’ai pas réussi à écrire parce que je passais mon temps à le relire. J’ai préféré son passé à mon avenir. Il a été mon jumeau de guerre, mon double idéal, et je ne suis jamais parvenu à en faire le deuil. »). Il le fit aussi sans doute pour exorciser cette culpabilité d'avoir survécu à l'enfer de la guerre lui qui, grièvement blessé, en revint, estropié mais vivant. Garcin imagine que la mère de Jean sollicite Louis Gémon pour lui parler des derniers moments de son fils. Il donne donc la parole à Louis qui, à travers les vers de Jean, livre les impressions que la guerre puis le quotidien lui inspirent, recréant, en parallèle, une histoire personnelle de cet homme dont on ne sait pratiquement rien. Louis se remémore l'été 1914 où l'ombre du conflit planait sur le pays, ces jeunes Français qui voulaient faire la guerre comme un passage initiatique ; elle serait courte et évidemment victorieuse et Jean n'échappa pas à cette fascination pour le combat. La réalité fut bien différente mais pendant que des jeunes gens souffraient et mourraient dans des conditions atroces, à l'arrière on festoyait et d'autres, plus riches ou plus débrouillards échappaient à leur devoir.
Je retiens, à titre personnel les premiers mots de ce roman. Parlant de la mère de Jean, le narrateur, Louis Gémon, note « Elle attendait de moi que je l'encourage à porter plainte non pas contre l'armée mais contre le destin... Croyait-elle vraiment intimider Dieu, et faire condamner, pour le mort de son garçon, le juge suprême ?» De part son engagement religieux elle avait fidèlement servi et aimé ce Dieu qui lui avait enlevé son dernier fils encore vivant. Ces quelques mots me paraissent tout à fait sujets à remise en cause profonde des convictions religieuses et même de la foi des êtres humains en une divinité qu'on nous présente comme bonne et compatissante. Cette « vérité » qui a valeur de dogme, existe autant que les choses humaines sont normales, c'est à dire qu'elles ne sont en rien bousculées par les événements, mais aller à l’enterrement de ses enfants remet forcément en cause tout ce qu'on nous a affirmé. La révolte qu'on peut éprouver contre le destin, c'est à dire contre Dieu, est à la fois légitime et parfaitement inutile, c'est à dire finalement tellement frustrante que la foi en souffre forcément au point de disparaître et qu'on se raccroche à ce qu'on trouve pour ne pas sombrer.
Ce n'est pas la première fois que cette revue s’intéresse à l’œuvre romanesque de Jérôme Garcin [La Feuille Volante n°447 et 450]. Sa démarche est cette fois particulièrement bienvenue en ce qu'elle contribue à tirer de l'oubli quelqu'un d'exceptionnel dont le destin a été malheureusement brisé mais aussi un poète qui a si bien servi notre langue et notre culture. J'ai lu ce roman sobrement écrit et plein de sensibilité avec une réelle émotion en pensant aussi, comme nous y invite l'auteur, à tous ceux qui ont accompagné Jean dans la mort et qui auraient pu avoir une vie après cette guerre. Il y a certes Louis Pergaud, Alain Fournier et Charles Peguy dont on se souvient mais il y a aussi les anonymes qu'on s'est empressé d'oublier et dont le souvenir ne perdure sur terre qu'à travers un nom gravé sur un monument ou une croix de bois ...
Hervé GAUTIER - N° 687– Octobre 2013
Les Pays Marie-Hélène LAFON (Ed. Buchet Chastel)
Pour un agriculteur, on disait plutôt un cultivateur ou un paysan, même si on n'était pas exposant, aller au salon de l'agriculture, même pour trois ou quatre jours, était toujours un événement, surtout si on venait du Cantal. On aimait marcher dans les allées, regarder et toucher les bêtes même si elles faisaient partie de son quotidien. Ce n'était pas comme ces parisiens qui ne connaissent que le lait en briques et la viande découpée en barquette au supermarché. C'était aussi l'occasion d'aller à la Capitale, de voir Paris. Pour cela on sollicitait les amis ou la famille et comme tout bons provinciaux on a toujours un cousin qui habite la banlieue et qui pilote les nouveaux-venus dans cette ville où ils ont l'impression d'être dans un pays étranger, presque sur une autre planète.
Ainsi commence l’histoire de Claire qui y faisait ainsi ses premiers pas. Plusieurs années plus tard, bac avec mention en poche, elle y reviendra, mais comme étudiante à la Sorbonne parce que le métier de paysan, entre les négociations de Bruxelles et les difficultés grandissantes de l'agriculture de montagne, c'était terminé. Le père le disait d'ailleurs à la fin des repas de famille « On finissait, on était les derniers » même si cette génération d'agriculteurs ont inauguré le confort des machines qui facilitent le travail. Voilà donc Claire, étudiante parisienne en hypokhâgne qui découvre le milieu universitaire avec à la fois la crainte des mandarins méprisant la piétaille estudiantine et une sorte d'admiration pour M. Jaffre, un professeur pas vraiment dans le moule et même un peu rebelle. Elle ne s'y sent pas tout à fait à sa place, peut-être parce qu'elle est fille de paysan et qu'elle y côtoie d'autres étudiants qui remettent leurs pas dans ceux de leur père dans des humanités qu'on fait ainsi de génération en génération. Étudiante besogneuse, effacée mais appliquée, elle ne fréquente guère les autres, se contente de regarder de plus ou moins loin les plus brillants, les plus emblématiques ou les plus flamboyants, et de travailler. Elle leur préfère des « pays », des compatriotes, même si, comme Alain, ils sont magasiniers à la Sorbonne, dédiés à la manutention de livres qu'ils ne lisent pas et dont ils ne comprendraient peut-être pas le texte. Elle vit à Paris mais craint surtout de ne pas être reçue ce qui équivaudrait pour elle à la suppression de sa bourse sans laquelle elle devrait renoncer aux études. Elle travaille dur et les mois d'été, elle les passe derrière le guichet d'une banque pour un supplément d'argent qui lui permettra de s'offrir des vêtements qui la feront un peu plus ressembler à une parisienne. D'ailleurs, elle ne retourne que très rarement en Auvergne, vit pratiquement une existence citadine, de plus en plus étrangère à son pays et ne reçoit des nouvelles de la famille que par la poste. Cet intermède estival et bancaire est certes alimentaire mais lui permet surtout d'observer un autre monde, celui du travail, de s'y faire accepter autant par son entregent, sa discrétion que par sa disponibilité mais surtout d'envisager autre chose, une carrière dans la Fonction Publique que lui permettront ses futurs diplômes, avec avantages sociaux et sécurité d'emploi. Cet entracte laborieux lui permet cependant de goûter les conversations oiseuses et sans grand intérêt qui généralement y ont cours, basées plus ou moins sur le quotidien des employés de l'agence et de leur histoire personnelle, de rencontrer tout un aréopage de collègues originaux ou parfaitement inintéressants qui d’ordinaire peuplent le monde du travail... et de jouir de sa position d’intérimaire très temporaire.
Nous la retrouvons à quarante ans, un peu vieillie, divorcée sans enfant, professeur à Paris, sa ville désormais où elle vit avec métro, trains et appartement sans ascenseur, mais qui passe ses vacances en Auvergne, dans son pays. Ce sont ses deux « terriers », ses deux refuges. Elle est maintenant une vraie parisienne qui reçoit annuellement chez elle sa famille, son neveu et son père, comme un rituel. Elle les initie aux nouvelles technologies, leur montre les avantages du confort moderne, de la vie à Paris, les traîne dans les musées auxquels ce père terrien ne parvient pas à s'intéresser. Le temps a passé pour elle comme pour les autres avec son cortège de souvenirs et de regrets d'enfance avec des objets arrachés au passé comme autant de jalons générateurs de mémoire qu'on garde jalousement et qui rappellent le pays quitté, comme déserté, « pour faire sa vie ». Un gouffre s'est creusé entre elle et cette famille au point qu'ils appartiennent maintenant à deux mondes différents qui ne se comprennent peut-être plus. Une bonne illustration de la phrase d'Eugène Delacroix mise en exergue de cet ouvrage «Nous ne possédons réellement rien ; tout nous traverse »
Il y a beaucoup de Marie-Hélène Lafon dans cette Claire, son départ d'Auvergne, son parcours universitaire, sa vie professionnelle et peut-être familiale ; c'est sans doute vrai mais il reste que ce départ de son « pays », de son décor d'enfance pour un autre univers auquel on doit impérativement s'adapter est, sans aucun doute, commun à tous et que nous tous pouvons, le transposant et au-delà de l'histoire, nous l'approprier.
Dans une précédente chronique (La Feuille Volante n° 671 à propos de « MO »), j'avais dit mon sentiment à propos du style que je trouvais trop haché, trop minimaliste, simplifié à l’extrême et à mon sens trop peu agréable à lire pour un lecteur peu averti comme moi. Je ne l'ai heureusement pas retrouvé ici, bien au contraire. La phrase est, dans ce roman, plus ample même si elle est un peu longue, plus précise, plus poétique parfois, plus colorée, impertinente quelquefois, illuminée à l'occasion de mots vernaculaires (Le vent de neige se dit en Auvergne « écire » ou « burle ») et fort agréablement enlevée avec ce rien d'humour qui vous la fait relire rien que pour le plaisir. J'ai donc lu ce livre avec délectation, un peu à cause de l'histoire, un peu à cause de la musique et de la justesse des mots, de l'odeur des lieux, de la suavité des paysages décrits et peut-être aussi de la nostalgie qu'il distille. Et puis j'apprécie toujours quand un auteur m'emmène avec lui pour un bon moment de lecture et surtout quand il sert, avec sa plume, notre si belle langue française.
Hervé GAUTIER - n° 683 – Octobre 2013
Berthe Morisot, le secret de la femme en noir D BONA
Tout a commencé par un tableau d’Édouard Manet, celui d'une femme, en noir avec un bouquet de violettes sur la poitrine pour seul bijou. Cette femme c'est Berthe Morisot et c'est un mystère. Elle est peintre elle-même, appartenant au groupe des Impressionnistes, et apparaît déjà sur de nombreux tableaux de Manet, c'est une grande bourgeoise, de bonne éducation, pas un modèle professionnel. Son père, ancien préfet est membre de la Cour des Comptes et sa mère, par une filiation compliquée, est la petite-nièce du peintre Fragonard. Elle n'a donc pas, selon la légende des peintres, une vie maudite. L'école des Beaux-Arts est fermée aux femmes, Guichard, un peintre ami lui ouvre ainsi qu'à sa sœur Edma les portes du Louvre où elles peuvent ainsi copier les maîtres. Là, elles rencontrent d'autres peintres mais ce qui intéresse le plus Berthe, ce sont les paysages.
Elles sont admises dans la bonne société, dans le grand monde des arts et de la politique et Berthe rencontre Manet dont les toiles font scandale. Les deux sœurs travaillent avec talent mais Berthe s'impose et le peintre qui la prend souvent pour modèle a tendance à intervenir sur ses toiles, ce qui lui déplaît fort. Avec le temps Berthe qui a subi l'influence de son maître réussi à substituer les couleurs claires à la palette noire de Manet. A trente ans elle est encore célibataire et doit résister aux sollicitations de sa famille qui souhaite la voir mariée, mère de famille et se détourner de la peinture. La guerre de 70 ne la tire pas de son ennui, elle s'impose un mutisme face à la Commune et alors que la guerre civile fait rage dans Paris elle est dégoûtée de ses semblables. Elle ne vit que pour la peinture et bientôt pour l'aquarelle ! A la fin des hostilités, elle retrouve Manet et souhaite poser pour lui. Les différents prétendants qui se pressent autour d'elle sont éconduits, soit par elle, soit, comme Puvis de Chavannes, par la famille. A trente trois ans, elle finit par jeter son dévolu sur Eugène Manet, le frère sans grand talent et de petite fortune d’Édouard dont elle devient la belle-sœur. Dès lors Berthe s'épanouit, n'est plus anorexique comme avant mais cesse d'être le modèle d’Édouard qui peindra dorénavant des femmes inconnues, sensuelles et nues. Non seulement la vie conjugale ne la comble pas, elle n'est pas heureuse malgré ses voyages et sa vie paisible mais encore sa peinture ne reflète pas exactement ce qu'elle est : c'est une passionnée et une combative et elle se présente comme une femme détachée de tout. Dans l’intimité de son couple, Eugène, conventionnel, jaloux, valétudinaire ne semble pas être l'homme qu'il lui faut pour mener correctement sa carrière. Pourtant, il la respecte en tant qu'artiste et lui qui peint également s'efface volontiers devant elle. C'est un brave homme, dévoué et sincère sur qui elle peut compter. Sa décision est prise et même si elle se heurte à l'ironie maternelle, Berthe a trouvé sa voie, elle sera peintre professionnelle mais, tournant le dos à l'Académie, choisit la liberté de peindre en rejoignant le groupe des Impressionnistes où elle est la seule femme.
Elle expose au salon de 1874 où la critique se moque de ce courant nouveau. Elle devient donc avec ces indépendants une marginale de la peinture. Elle va cependant suivre cette voie malgré tout le monde ; c'est que cette femme est un mystère. Elle est parfaitement intégrée à ce groupe qui gagne en nombre et en originalité mais vend peu.
C'est au moment du pire déchaînement médiatique contre les Impressionnistes qu'elle met au monde sa fille Julie. Cette naissance la comble de bonheur et l'apaise. Sa fille reçoit une éducation bourgeoise et sa mère a soin de s’entourer de peintres et d'écrivains. Un attachement profond l'unit à Julie mais celle-ci aura toujours un peu de la mélancolie de sa mère. Même éreintées par la critique et par la presse, des expositions se succèdent et tant pis si ce mouvement souhaite bousculer le bourgeois friand de réalisme, tant pis si on confond un peu contestation et révolution (la Commune n'est pas si loin), Berthe s'impose ! Elle fait d'ailleurs des émules féminines, et, artistiquement s'éloigne un peu de Manet mais se rapproche de Monet. Autour des Impressionnistes, le groupe s'étoffe, Renoir, Degas, Monet, Sisley, Pissaro...
La santé de son mari se détériore et et autour d'elle c'est bientôt une véritable hécatombe. Elle devient veuve à 51 ans et reprend ses habits de deuil si chers à Manet. Dès lors elle ne trouve sa consolation que dans la peinture, regarde l'avenir autant pour elle que pour Julie, se fait même le défenseur des femmes. Elle qui n'a que très peu peint les hommes se met maintenant à représenter des jeunes filles étrangères, la jeunesse comme un paradis perdu ! Julie peint désormais et son style rappelle celui de Manet. Berthe meurt à 54 ans en 1895 .
L'auteur revient sur le titre de ce livre. Berthe Morisot était faite d'ombres et de silences qu'elle aimait. Elle posa pour Édouard Manet mais épousa son frère qui était un homme discret et sans relief. A sa mort on retrouva une importante correspondance avec les impressionnistes et les amis mais seulement quatre courtes lettres d’Édouard Manet lui étaient adressées. D'autre part rien ne permet d'affirmer qu'elle correspondit avec lui. Dominique Bona y voit une énigme, suppose une liaison entre eux, une correspondance secrète détruite peut-être avant de mourir par elle-même, pour effacer, pour purifier ce qui ne pouvait être avoué ? Entre la tristesse et le vertige qu'elle croit percevoir dans les yeux de Berthe, elle laisse le lecteur dans l'expectative. Il y a sans doute pour elle une sorte de frustration à ne pas lever un coin de ce voile qui restera à jamais une interrogation.
C'est un roman bien construit, agréable à lire, une biographie fouillée et précise que, comme à son habitude, nous livre Dominique Bona. Elle choisit de nous présenter une femme d'exception, rebelle à sa manière dans le domaine de la peinture, éprise de liberté, toujours insatisfaite et perfectionniste, ténébreuse et silencieuse qui a, par son talent, marqué son temps et l'histoire de la peinture. Elle la réhabilite donc et en profite pour donner sur la peinture de Berthe mais aussi sur celle des impressionnistes un avis éclairé qui s'étend d'ailleurs à l’œuvre des écrivains qui ont entouré le groupe.
© Hervé GAUTIER - n° 677 – Août 2013
L'année du volcan - Jean-François PAROT - JC LATTES
Nous sommes en Juillet 1783 et le vicomte de Trabard vient de mourir, tué en pleine nuit par son cheval, Bucéphale. Ce nom avait déjà été porté par le destrier d'Alexandre le Grand mais si ce cheval avait peur de son ombre, il semblerait bien que la monture du vicomte ait craint les pétards jetés dans son box nuitamment, ce qui, pour le commissaire Le Floch est sans aucun doute le signe d'un assassinat camouflé en accident. D’autant que le cheval est présenté comme une bête fougueuse alors qu'il n'en n'est rien ! Quant au vicomte, pour être noble il n'en était pas moins quelqu’un de peu recommandable dont on n'aurait bien pu vouloir se débarrasser. Le vicomte et la vicomtesse vivent sous le même toit mais mènent deux vies bien séparées ce qui pourrait bien être une explication à cette mort mystérieuse, les domestiques, sous couvert de la fidélité à leurs maîtres, cachent des informations à nos policiers, les appartements de M. de Trabard ont été fouillés bien avant l'arrivée de la police et les nombreux détails qui s'accumulent lors de leurs recherches contribuent à épaissir le mystère qui entoure cette affaire et posent bien plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Le plus étonnant est sans doute que la reine qui fait mander Nicolas le Floch pour enquêter, entend être tenue exclusivement et personnellement informée des développements de ses investigations. Un cas de conscience pour notre « commissaire aux affaires extraordinaires » qui rend compte d'habitude au Roi lequel lui accorde toute sa confiance et à qui il est tout dévoué ! Autour du marquis de Ranreuil, ses amis le mettent en garde : cette affaire est grave et pourrait entraîner sa disgrâce, et pour faire pression sur lui, on le menace même de révélations sur sa vie privée ! 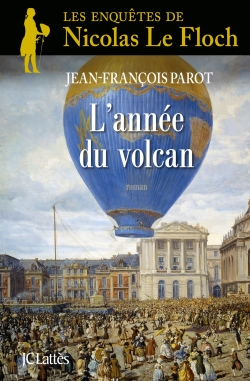
Il est aidé par son fidèle et efficace Bourdeau, toujours aussi critique au regard de la Cour. Il est ici l'expression d'un peuple qui gronde et auquel il appartient, même si ses fonctions policières l'amènent à protéger la royauté ! Certains de ses propos prennent dans ce récit une dimension prémonitoire. Plus les investigations avancent autour du vicomte de Trabard , plus le secret s'étend, d'autant que cette époque est troublée, que le roi a de moins en moins de pouvoirs, que les bases de la société se délitent, que des scandales éclatent, que l’État est en faillite à cause notamment des dettes faramineuses de la reine dans le remboursement desquelles le vicomte aurait pu jouer un rôle peu catholique, que le peuple fait de plus en plus entendre sa voix et ses revendications, menaçant l'ordre public, que circulent des pamphlets et des libelles, bref une atmosphère de fin de règne qu'un policier intègre ne peut que redouter ! Tout s'y met, même la terre qui ne cesse de trembler et ce volcan islandais qui répand ses vapeurs nocives jusque sur le royaume de France !
Lors des investigations de Le Floch, le lecteur croise une franc-maçonnerie de plus en plus influente, l’énigmatique comte de Cagliostro, Restif de le Bretonne toujours aussi inattendu et insaisissable, l'ombre de Sartine, ancien ministre retiré des affaires mais toujours attentif aux choses de l’État, des faux-monnayeurs, des trafics en tout genre, des spéculations immobilières de la part d’ordres religieux qui ont pourtant fait vœux de pauvreté, des coteries où la galanterie le dispute à la corruption et à la volonté de nuire...
Cette enquête est passionnante du début à la fin. Elle nous entraîne sous le règne de Louis XVI et nous dirige dans ce Paris du XVIIIème siècle plein de mystères. Comme toujours je note les recettes de cuisine qui émaillent le récit, si détaillées et goûteuses que le lecteur a l'impression d'être invité parmi le commensaux. Comme toujours le texte est érudit et on y gagne toujours quelque chose qui ressemble à la connaissance de cette période passionnante et des gens qui y vivaient, petits ou grands !
Un détail, et non des moindres cependant : je veux redire ici combien j'apprécie le style de Jean-François Parot, riche en tournures et en vocabulaire un peu surannés mais ô combien musicaux et distingués. C'est d'autant plus important à mes yeux qu'il est devenu presque banal d'écorcher au quotidien notre belle langue jusque dans les « sms » et que nombre de professionnels de la parole et de l'écrit qui sont censés en faire un usage correct ne cherchent même plus à la respecter. C'est plus fort que moi, mais j'aime qu'on serve correctement le français et c'est toujours pour moi un plaisir de lire de tels romans.
Hervé GAUTIER - N° 657 – Juillet 2013
L'oubli est la ruse du diable Max Gallo (XO Éditions)
En cette trente troisième année d’existence de « La Feuille Volante », j'écris ici avec plaisir, puisqu'il s'agit d'un ouvrage de Max Gallo, ce qui en sera probablement un des derniers articles.
Cette autobiographie, puisque c'en est une, dédiée comme il se doit à la mémoire des siens, s'ouvre sur la citation de Rigord, un moine de l'abbaye de St Denis en 1207 qui nous rappelle que seuls meurent et vont en enfer ceux que les vivants oublient. C'est une tentation bien grande, surtout quand on a réussi, de retracer son itinéraire intime pour sa famille ; son cas a évidemment valeur d'exemple pour la communauté. Que Max Gallo s'attelle à ce travail a au moins l'avantage d'offrir au lecteur un témoignage sans fard puisqu'il prend la peine de nous parler de lui-même, enfin ! Il nous avait habitués aux vastes fresques historiques, à l'évocation des grands hommes et même à des fictions remarquables mais il se cachait habilement derrière sa plume alerte. Ici, à plus de 80 ans, après une impressionnante bibliographie, il accepte de se livrer simplement et son écriture devient pour lui catharsis. Fils d'ouvrier immigré italien, il ne pouvait qu'être promis à un métier manuel ; il sera agrégé d'histoire, député de Nice, sa ville natale, ministre de François Mitterrand, éditeur, écrivain à succès, académicien... Une véritable ascension sociale, un authentique destin, un pur produit de la République qu'on aime donner en exemple, une vraie volonté de s'affranchir d'un certain déterminisme social [« Et pourquoi pas d'Académie française? » lui avait répondu un Haut-fonctionnaire à qui il venait d'avouer son ambition pour l'agrégation et pour l'écriture, lui le modeste salarié, fils d'un immigré italien]. Un beau parcours en tout cas ! Cela autoriserait sans doute que l'auteur fît son propre panégyrique, sculptât sa propre statue, devînt son propre thuriféraire ! Eh bien pas du tout et même au contraire.
Ce fut une enfance heureuse dans une famille prolétaire où on parlait encore l'italien, entre une mère attentive et parfois un peu abusive et un père animé d'idées révolutionnaires, au milieu d'un racisme ordinaire, mais marquée par une extraordinaire volonté d'être français. Il mêle à son quotidien des moments de la grande histoire, la guerre, l'occupation, la Libération, fait vivre dans son récit des quidams qui jettent à leur tour un regard critique sur leur temps. Fils d'ouvrier, on le destinait naturellement au cambouis et à la sueur mais il y préféra l'odeur des livres et l'amour de l'étude. Avec une écriture simple, sans fioriture, fluide et agréable à lire, Max Gallo déroule sa vie pour son lecteur devenu confident, raconte ses illusions, ses échecs, ses envies, ses éveils, ses prises de conscience, ses convictions, son parcours politique loin du dogmatisme et de l'ambition calculatrice, sa volonté de ne jamais rien tenir pour acquis. Son mariage fut un échec et se termina par une séparation dont il se remit mal. Il n'oublie pas ses fêlures et ses failles, les événements qui bouleversèrent sa vie... Quand pour lui le succès commençait à se manifester, qu'il se construisait peut-être des châteaux en Espagne, qu'il était tout disposé à se laisser griser par le succès, aveugler par la réussite, dévorer par l’égoïsme, sa fille Mathilde se suicide. Elle avait 17 ans ! Il est impossible de vraiment survivre à un tel événement, on y perd souvent sa vie, sa raison, sa foi et pas mal de ses certitudes. Il trouva sans doute dans cette mort qui aurait pu l’anéantir et au-delà de cette culpabilisation judéo-chrétienne, une raison supplémentaire de poursuivre une vie prometteuse. L'abondance et la richesse de ses œuvres sont sans doute un hommage à cette jeune fille morte, l'écriture, une thérapie dans ce qui devenait de jour en jour un mal de vivre de plus en plus prégnant.
J'ai souvent dit dans cette chronique combien j'aime lire les biographies. Celle-ci, peut-être plus intime que les autres m'a passionné. J'ai découvert un homme qui, malgré sa réussite, ne cache rien de ses fragilités ni de ses contradictions et le fait simplement, mène son chemin en gardant à l'esprit autant l'exemple de sa parentèle modeste que les maximes de grands penseurs, avec cette belle et émouvante écriture que j'ai toujours appréciée. J'aime aussi qu'il ne soit pas naïf et porte sur la politique, sur la gauche en particulier et même sur l'espèce humaine, un regard critique et sans indulgence.
Max Gallo qui, avec ses mots rend hommages à ses morts, sa fille, sa mère, son père, craint peut-être qu'on l'oublie après sa disparition. Homme de lettres qui la pratique si heureusement et qui a si bien servi notre belle langue, il sait mieux que personne que l'écriture est un extraordinaire support de la mémoire, plus sûr en tout cas que l'habit vert d'Immortel qu'il porte désormais. Dans son cas, il n'y a donc aucun danger.
© Hervé GAUTIER - N° 650 Juin 2013
Le chapeau de Mitterrand Antoine LAURAIN (Flammarion)
Le hasard fait bien plus souvent partie de notre vie que nous voulons bien l'admettre. Prenez par exemple une soirée de novembre 1986, un lieu, une brasserie parisienne et un homme, Daniel, un parfait quidam qui s'offre un délice gustatif en solitaire. Quoi de plus banal ? Ce qui l'est peut-être moins est qu'il voit s'installer à la table voisine François Mitterrand, le Président de la République soi-même qui vient, lui aussi, avec deux collaborateurs, faire une petite pause dîner. Au début, Daniel n'en croit pas ses yeux, regarde, écoute et surtout fantasme, le Président n’est pas un homme du commun, surtout celui-là, même si ce dernier ne fait pas de cas des autres commensaux. Las, le charme prend fin et Mitterrand finit par quitter les lieux, mais en oubliant son célèbre chapeau. Après avoir hésité, Daniel s'en empare. Cela tombe bien, il est à sa taille ! Et ce larcin va changer sa vie comme si ce couvre-chef présidentiel avait des pouvoirs surnaturels bénéfiques pour qui le porte. Sauf qu'il le perd à son tour et que, passant de mains en mains et de tête en tête, cet accessoire des hommes d'âge, devenu entre-temps anonyme, va donner à tous ceux qui vont le coiffer l'audace de sortir de la routine quotidienne où ils étaient quelque peu engoncés et qu'ils avaient peur de rompre, une « force tranquille » en quelque sorte ! A travers tous ceux qui en ont été les possesseurs successifs, de la secrétaire en mal de rupture amoureuse et d'inspiration artistique, au « nez » dépressif pour cause et sécheresse créative, en passant par un aristocrate classique et légèrement guindé qui va soudain avoir le courage de rompre avec son milieu, ce feutre noir va voyager, au moins dans l'imagination de l'auteur, de Paris à Venise pour le plus grand plaisir du lecteur.
Tout au long de cette fiction bien écrite, agréable à lire et pleine d'humour, l'auteur promène son lecteur dans la société française des années 1980 autant qu'il l'invite à visiter une galerie de célèbres portraits. Ce qu'on a du mal à nommer « un simple galure » va donc faire partie de la vie d'humains que le destin ou le hasard vont choisir, à moins bien sûr qu'il ne soit lui-même animé de sa propre liberté et choisisse ses temporaires inventeurs. Cela se termine par une évocation un peu énigmatique et émouvante de François Mitterrand, présent en filigranes dans tout ce récit.
J'ai bien aimé cette fable peut-être parce qu'elle met en évidence un des fantasmes secrets de tout être humain, celui de vouloir que les choses se réalisent parce simplement il le souhaite. Il laisse aller son imagination et se laisse porter par elle. Elle le transforme et le fait sortir de sa médiocrité. Bien sûr cela ne marche jamais et chacun se retrouve face à sa petitesse ordinaire et son morne quotidien qu'il a, l’espace d'un instant, tenté d'enjoliver. C'est une illustration de cette facette de la condition humaine qui m'a bien plu.
©Hervé GAUTIER - N°599 Novembre 2012
CELINE Henri GODARD (Ed. Gallimard)
Louis-Ferdinand Céline [1894-1961] est parmi les hommes de lettres quelqu'un qui, cinquante ans après sa mort, fait encore parler de lui. De son vivant déjà, il avait, par ses écrits et par ses prises de positions politiques, déchaîné les passions. 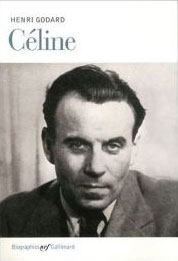
Son œuvre est indissociable de sa vie, de son parcours et de ses opinions politiques. Du point de vue strictement littéraire, il a indubitablement incarné une révolution, renouvelant le style romanesque traditionnel, y instillant des sonorités et des rythmes empruntés au langage parlé et à l'argot. Il doit sans doute cet aspect de son écriture à sa grand-mère maternelle à qui il rendra hommage en faisant de son prénom son nom de plume. Ses phrases semées de ponctuations exclamatives et suspensives cherchent à provoquer l'émotion et la réaction... et y parviennent. Son œuvre est un cri pessimiste poussé face à la nature humaine qu'il exècre et même si parfois il y mêle de l'humour et de la tendresse, il reste marqué par un désespoir définitif et une volonté de choquer. Il reste un pamphlétaire, un polémiste, un marginal, un homme révolté, ambigu, contradictoire parfois, paranoïaque même, un homme écorché-vif, outrancier voire injurieux et parfois ordurier dans ses propos, un auteur qui se définit lui-même comme « paradoxale, burlesque, effervescent ». Il ne laissera jamais indifférent !
Si Céline est à l'évidence un grand auteur et un poète, il reste marqué du point de vue politique par un antisémitisme incontestable hérité à la fois de son père et de son époque et il se servira de sa notoriété pour affirmer cette opposition avec détermination et violence. Il ira même jusqu'à tenir des propos ignobles et des condamnations tonitruantes. Cette phobie du juif tourne carrément à la folie puisqu'il étend cette judéité à tous ceux qu'il n'aime pas … Et ils sont nombreux ! Avec Robert Brasillach et Pierre Drieu La Rochelle qui eux ont connu un sort différent, il a été parmi les écrivains maudits de la Libération. Condamné, il a cependant été amnistié et a ainsi pu rentrer en France. Il reste quand même un personnage controversé et par bien des côtés contradictoire. Son parcours a été un long chemin et un long combat. Ce que j'ai trouvé personnellement le plus émouvant, ce sont les derniers chapitres consacrés à sa fin de vie, à la fois pitoyable et définitivement solitaire, même si, à cette période il a semblé sortir d'un long purgatoire.
L'auteur de cette biographie passionnante du début à la fin nous le présente sous ses différentes facettes, comme un adepte de la pornographie, ce qui n'est pas essentiel, comme l’auteur de ballets qui met la danse au centre de sa vie, un amoureux des animaux, de son chat Bébert, compagnon d'infortune au Danemark puis de ses chiens à Meudon, et, ce qui est sans doute pour le plus inattendu, comme un séducteur qui ne pouvait se passer des femmes !
L'auteur Henri Godard, professeur de littérature à la Sorbonne et spécialiste de l’œuvre célinienne est également, dans la bibliothèque de la Pléiade, l'éditeur de Céline. Ce livre est l'occasion de faire connaissance de cet écrivain majeur du XX° siècle et de lire ou de relire ses nombreux romans.
Hervé GAUTIER – n° 598 novembre 2012
GALA - Dominique BONA (Flammarion 1995)
Qui était donc cette femme qui fut l'égérie d'un poète et de deux peintres? Quand elle entre en scène, elle s'appelle encore Elena Dimitrievna Diakonovane, elle a reçu une bonne éducation en Russie où elle est née en 1894. C'est une jeune fille de 18 ans qui, après avoir parcouru toute l'Europe de l'Est, débarque dans un sanatorium suisse où elle vient soigner une tuberculose. Elle va y rencontrer, Paul-Eugène Grindel, le fils d'une famille bourgeoise, plus tourné vers la poésie que vers une carrière traditionnelle, malade lui aussi, et en tombe éperdument amoureuse. Il deviendra, grâce à elle, Paul Eluard et elle adopte le pseudonyme de Gala qu'elle gardera toute sa vie. Elle n'est peut-être pas très belle mais est une véritable présence fascinante, sait ce qu'elle veut, et malgré leur jeune âge, la famille de Paul qui se méfie de cette étrangère, la guerre, l'avenir incertain de son fiancé, elle l'épouse en février 1917. Le conflit mondial favorise la rencontre de Paul avec Louis Aragon, Philippe Soupault et André Breton puis, la paix revenue, c'est le mouvement Dada et ses excentricités artistiques qui leur révéla l'existence de Max Ernst vers qui Gala se sent irrémédiablement attirée, avec une certaine complicité tolérante du côté de Paul. Gala a 27 ans et son nouvel amant, sensiblement du même âge qu’elle, vient s'installer chez eux et va même vivre à leurs crochets. Ainsi commence un "ménage à trois" que Paul ne condamne pas mais dont il souffre quand même. Ni lui ni elle n'en sortiront indemnes et cela durera, plus ou moins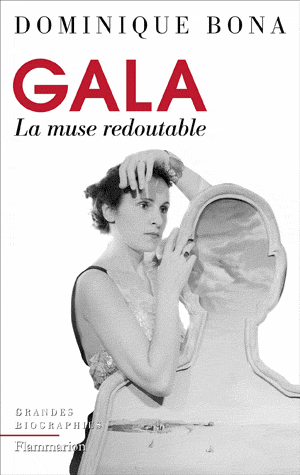 en pointillés, jusqu'à ce qu'arrive un peintre catalan inconnu, Salvador Dalí. Nous sommes en 1929. Là aussi ce sera le coup de foudre. Pourtant tout les opposent, elle a 10 ans de plus que lui, c'est un inconnu sans fortune mais ils vivront ensemble une passion exubérante, sauvagement pauvre au début et s'épouseront en 1934. Dalí est maladivement timide mais aussi excentrique, facétieux, original, fantaisiste, débordant de créativité... Elle sera son unique modèle, sa source principale d’inspiration et l'icône qu'il célébrera comme une véritable idole jusqu'à sa mort en 1982. Elle restera aux côtés de Dalí, toujours dans l'ombre, l'assistera, le soignera, l'encouragera, l'accompagnera dans ses déplacements internationaux et mondains qui conditionnent sa notoriété et le mécénat qu'elle va susciter. Elle sera non seulement son épouse attentive mais aussi la gestionnaire de sa fortune, son agent artistique, efficace et discret. En réalité, ils se ressemblent beaucoup et sont avant tout individualistes. Politiquement, le groupe des surréalistes dont il fait partie est tourné vers le communisme mais Dalí, sans doute par provocation au début, fait devant ses membres l'apologie d'Hitler, comme il se tournera plus tard vers Franco. De plus, il fréquente les puissants et les riches et n'a cure du peuple. La rupture ne pouvait qu'être consommée, mais Gala sera toujours avec lui et dans l'ombre lui tiendra la main. Il le sait et ne peut plus se passer d'elle et quand après différentes manières de penser et de vivre il devient mystique, il la divinisera dans ses tableaux.
en pointillés, jusqu'à ce qu'arrive un peintre catalan inconnu, Salvador Dalí. Nous sommes en 1929. Là aussi ce sera le coup de foudre. Pourtant tout les opposent, elle a 10 ans de plus que lui, c'est un inconnu sans fortune mais ils vivront ensemble une passion exubérante, sauvagement pauvre au début et s'épouseront en 1934. Dalí est maladivement timide mais aussi excentrique, facétieux, original, fantaisiste, débordant de créativité... Elle sera son unique modèle, sa source principale d’inspiration et l'icône qu'il célébrera comme une véritable idole jusqu'à sa mort en 1982. Elle restera aux côtés de Dalí, toujours dans l'ombre, l'assistera, le soignera, l'encouragera, l'accompagnera dans ses déplacements internationaux et mondains qui conditionnent sa notoriété et le mécénat qu'elle va susciter. Elle sera non seulement son épouse attentive mais aussi la gestionnaire de sa fortune, son agent artistique, efficace et discret. En réalité, ils se ressemblent beaucoup et sont avant tout individualistes. Politiquement, le groupe des surréalistes dont il fait partie est tourné vers le communisme mais Dalí, sans doute par provocation au début, fait devant ses membres l'apologie d'Hitler, comme il se tournera plus tard vers Franco. De plus, il fréquente les puissants et les riches et n'a cure du peuple. La rupture ne pouvait qu'être consommée, mais Gala sera toujours avec lui et dans l'ombre lui tiendra la main. Il le sait et ne peut plus se passer d'elle et quand après différentes manières de penser et de vivre il devient mystique, il la divinisera dans ses tableaux.
C'est étonnant mais l'amour que lui porte Paul Eluard est sans borne et aussi assez original. Certes, elle le trompe, et lui ne manque pas de l’imiter, mais pour autant, et bien que les amants connus de Gala soient à ce point différents de Paul, ce dernier non seulement les accepte mais leur porte de l'intérêt et même une certaine forme d'amitié, un peu comme si seul comptait à ses yeux le bonheur de sa femme qu'il n'était plus capable de lui procurer. Paul sera même bienveillant avec Dalí quand il fera, avec Gala, ses premiers pas dans le monde et quand les surréalistes l’expulseront de leur groupe. Il restera amoureux d'elle jusqu'à la fin, malgré tous les bouleversements de sa vie et leur divorce prononcé en 1930 après 15 ans d'un mariage mouvementé. Cet ouvrage consacré à Gala est en réalité non pas une mais trois biographies, la sienne mais aussi celles de Paul Eluard et de Dalí à qui elle fut si intimement liée. Si on en croit Dominique Bona, il semblerait que Gala, bien que dévoreuse d'hommes, ait recherché la virginité originelle chez Eluard et Dalí et ait poursuivi ses amours de contrebande, avec une prédilection pour les hommes plus jeunes qu'elle, et ce même pendant son union pourtant hautement amoureuse avec Salvador Dalí. Lui aussi ferma les yeux sur ses écarts, pourvu qu’elle reste avec lui !
Gala est volontaire, tenace, passionnée, mais aussi coquette, dépensière, valétudinaire, mélancolique, tourmentée et volontairement solitaire. Elle a peu d'amis et ceux qui la connaissent, notamment au sein du groupe des surréalistes, l'affublent de sobriquets peu sympathiques. L’avenir la fait rêver mais le mariage, la maternité, la vie rangée d'une femme mariée la déçoivent. Par peur de manquer, mais aussi par addiction au jeu, elle devient responsable du galvaudage du talent de son mari. Contrairement à l'anagramme inventé par Breton, "Avida dollars" ne s'applique pas à Dalí mais à Gala ! Puis tout cela dérape et, au nom de l'argent, la signature de Dalí ne s'appose plus sur des tableaux mais sur des bijoux, des parfums. Gala, pourtant attentive à la gestion de la fortune de son génial époux ne contrôle plus rien et ce sont des feuilles blanches en nombre incalculable qu'il signe. Elles serviront de support à autant de faux qui porteront atteinte à son crédit sur la marché de l'art. Dès lors, les secrétaires se succèdent et une cour se forme autour du couple, vivant des richesses qu'il génère. On a pu voir en elle une aventurière calculatrice, séductrice et avide d'argent qui sait rester dans l'ombre mais tirer le meilleur parti des hommes qu'elle croise, qu'elle séduit et dont elle favorise l'ascension. Étrange destin que celui de cette femme énigmatique et apparemment froide qui a su par son charme s'attacher des hommes d'exception qui en furent éperdument amoureux. Si elle est une intellectuelle, elle n'est cependant pas une artiste mais saura révéler chez tous les hommes dont elle fut la compagne, un élan créatif exceptionnel. Ils ont tous laissé dans le domaine de l'art une marque pérenne. Sans elle, ils ne se seraient assurément pas révélés au monde et seraient restés anonymes. Gala vieillie et malade meurt en 1982. Son mari lui survivra 7 ans mais c'est un fantôme qui s'éteint en 1989. Les deux époux ne sont même pas enterrés ensemble !
Comme toujours dans ses biographies, Dominique Bona est précise, très documentée, donne des détails et ses remarques personnelles, ses analyses et ses citations sont pertinentes. Cette chronique s'en est peu fait l'écho, mais j'aime lire les biographies, surtout, comme c'est le cas ici, quand elle sont denses et passionnantes. Grâce à son style fluide et poétique (notamment quand elle décrit des paysages catalans que ses origines familiales lui rendent sans doute plus attractifs), à ses courts chapitres, elle s'attache son lecteur attentif jusqu'à la fin. C'est donc un récit passionnant que nous livre l'auteur d'"Argentina" et nous fait découvrir la personnalité exceptionnelle de cette femme. Personnellement, j'avais des idées toutes faites sur Gala qui restait pour moi bien mystérieuse, la lecture de cet ouvrage m'a donné d'elle une image plus précise et surtout plus lumineuse.
© Hervé GAUTIER - n° 646 - mai 2013
Amour - Michael HANAKE - Palme d'Or Cannes 2012
Ce film dont il faut évoquer brièvement l'intrigue tourne auteur de deux personnages. C'est une histoire simple, presque banale de fin de vie, celle d'Anne ( Emmanuelle Rivas) et de Georges (Jean-Louis Trintignant), deux octogénaires qui mènent une vie tranquille de retraités. On les voit au début assister à un concert d'un des élèves d'Anne, ancienne professeur de musique classique. La musique justement, celle de Schubert, de Beethoven, de Bach, les tableaux accrochés aux murs et les livres qui tapissent les bibliothèques, tout indique que nous sommes ici chez des gens aisés et cultivés. Puis soudain, Anne a une attaque qui la laisse paralysée du côté droit. Courageusement elle s'adapte à sa nouvelle situation comme on fait face à l'adversité. La vie s'organise autour de son infirmité nouvelle et Georges l'accompagne patiemment, s'improvise infirmier, accompagnateur de vie, homme au foyer de cette femme qui peu à peu va perdre toutes ses facultés pour ne plus mener qu'une vie végétative et aphasique et entrer de plain-pied dans l'agonie. Il le fait avec courage, abnégation et même héroïsme au point de se charger seul, contre les médecins, les soignants et l'inévitable bon sens qui commanderait qu'il se déchargeât un peu du poids de plus en plus lourd qu'elle représente. Pour cela, il n'a que son impuissance grandissante face à cette situation qui se complique de jour en jour et même si elle fait l'admiration des gens autour de lui et l'inquiétude légitime mais à ses yeux inutile de sa fille Eva (Isabelle Huppert), il veut continuer à cacher aux autres cette réalité et peut-être se la cacher à lui-même.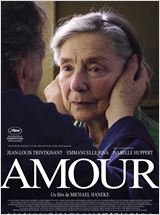
Le couple attend la mort et Georges fait preuve de résignation [« ça va aller de mal en pis et puis ce sera fini »] , mais pas de désespérance, elle ne viendra qu'à la fin parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, entre photos jaunies et souvenirs qui peu à peu s'effacent, un huis-clos qui se déroule dans une sorte d'unité de lieu de leur appartement qui jadis était plein de vie mais qui peu à peu se vide.
Il n'y a pas de voyeurisme dans ces scènes quotidiennes, tout juste un compte rendu exact de ce qu'est le rôle que Georges a choisi depuis le début et qui va petit à petit le dépasser, un compte à rebours aussi ! A mesure que les facultés d'Anne disparaissent, qu'elle entre progressivement dans la mort, on le voit lui, si plein de bonne volonté au départ, perdre pied au point de la gifler parce qu'elle refuse de s'alimenter, battre en retraite pour ne plus dormir que dans un petite chambre loin d'elle au point que, sa propre déchéance à lui va être suscitée pour le spectateur par la résurrection symbolique de son épouse et qu'il va prendre une dimension quasi spectrale. On voit leurs rides, leurs corps affaiblis, leurs cheveux, blancs et ternes pour elle qu'un reste de coquetterie veut masquer, épars et hirsutes pour lui qui marquent, comme la barbe qu'il néglige de raser chaque jour, le désintérêt qu'il porte à sa propre personne pour ne plus se consacrer qu'à Anne. Il respecte la parole donnée de ne pas ne pas l’envoyer à l'hôpital puis, plus tard, dans l'inévitable maison de retraite qui serait pour elle comme un mouroir puisqu'elle serait séparée de Georges.
Le jeu des acteurs et bouleversant de vérité et ce film nous rappelle une évidence, celle que nous sommes tous mortels, que tout à une fin et que la vieillesse est une déchéance. Le cinéma d'ordinaire se fait plus volontiers l'écho de la beauté, de la jeunesse, de la réussite, de la sensualité... La palette d'Haneke est grande et talentueuse. On sent qu'il ne craint pas de déranger, de bouleverser les codes et les idées reçues et, pour cela d'être, peut-être, désagréable au spectateur qui attend volontiers un « happy end ». J'aime personnellement qu'on ne cache rien, qu'on ne donne pas une image idyllique de cette société qui ne le mérite pas et qu'on en montre les travers et les failles. Dans ce film intimiste et plein de sensibilité, c'est la mort qui nous est montrée parce qu'elle est non seulement la fin de la vie et que, même si elle a été taboue pendant toute notre existence, si on a vécu sans y penser comme il convient dans nos sociétés occidentales, elle guette chacun d'entre nous et nous surprend au moment où nous y pensons le moins. Qu'on le veuille ou non, la condition humaine est ainsi faite et les règles de notre société paraissent immuables. Quelles que soient les fonctions qu'on y ait exercé, quand la retraite sonne on n'est plus rien et quand la mort nous frappe on est oublié définitivement.
Je retiens aussi de ce film une écriture cinématographique originale portée par des acteurs d'exception. Elle est à la fois intense, juste et économe en mots, comporte des plans parfois longs et silencieux, une bande sonore faite ici opportunément de musique classique, des scènes plus suscitées qu'effectivement montrées, des bruits apparemment anodins, tel celui du robinet qui coule constamment et qui brusquement s'arrête, suggérant un rebondissement.
L’amour existe certes, mais il y a quand même quelque chose d'irréel dans cette œuvre. Cet homme et cette femme s'aiment d'un amour authentique et fidèle que traduisent des regard et les gestes tendres du début. Ils se sont choisis pour partager les joies et maintenant ils connaissent les peines mais leur complicité est complète. Ils aimaient la vie ensemble parce qu'elle ne pouvait être que commune et elle a été longue [« C'est beau la vie , si longtemps »]. Je crains que cela ne reflètent cependant pas la réalité quand un mariage sur deux se termine actuellement par un divorce et que cela affecte, et c'est nouveau, les seniors. Même si les couples qui restent ensemble le font pour des questions de morale, de religion, de convenances ou de finances, ce choix cache bien souvent une vie où l'hypocrisie le dispute à l'indifférence ou pire encore. Ils se terminent parfois par une séparation que le concept moderne de « famille recomposée » peine à masquer. Quand Eva, à la vie sentimentale agitée, donne de ses nouvelles à ses parents, on a du mal à imaginer que lorsqu'elle sera vieille à son tour, elle connaîtra pareille complicité avec son mari. Mais c'est sans doute un autre débat ? Quand elle apparaît pour s'émouvoir de la maladie évolutive d'Anne, il est difficile de voir dans ses larmes autre chose qu'une posture de circonstance. Elle disparaîtra bientôt pour laisser la place à Georges qui ira au bout de sa démarche, seul, comme il le souhaite.
Ce film qui est un jalon supplémentaire dans la démarche d'Haneke est le onzième long métrage et le deuxième couronné par une prestigieuse palme d'or à Cannes. Il est bouleversant à bien des titres. Il est en tout cas une invite à la prise de conscience, un rappel des réalités de cette vie, il lève un tabou dont on se demande bien pourquoi il est, dans notre société, si savamment entretenu.
N° 597 - Octobre 2012
©Hervé GAUTIER – Octobre 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
Le Rapport de Brodeck Philippe CLAUDEL (Stock)
Prix Goncourt des Lycéens 2007
C'est une bien curieuse histoire que celle de ce Brodeck. C'est un enfante trouvé, un enfant de la guerre, recueilli dans un village perdu en montagne par Fédorine, une vielle femme. Lui, c'est plutôt quelqu’un d'ouvert mais, même s'il est arrivé ici très jeune, il restera pour les gens d'ici un étranger, quelqu'un de peu d'importance. Pourtant on lui offrira des études au cours desquelles il rencontrera Emélia qu'il épousera et qui lui donnera la petite Poupchette. Elle est sa raison de vivre bien qu'elle soit née du viol de sa femme par des soldats. Il deviendra même un fonctionnaire chargé de rédiger des rapports sur la nature. Ses travaux n’intéressent personne mais lui permettent de survivre avec sa famille grâce à ses maigres appointements. Il n'a jamais été accepté au sein de ce microcosme villageois au point d'être livré par eux à l'ennemi, pendant la seconde guerre mondiale. Quand on leur a demandé de « purifier » le village, c'est à dire de dénoncer les indésirables, c'est son nom et celui d'un simple d'esprit qui ont été donnés. Pourtant il résistera à la déportation, aux humiliations et à la malnutrition grâce au seul espoir de retrouver Emélia. Quand il est revenu au village, son épouse n'est plus la même, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, brisée par un viol d'où naîtra une petite fille que pourtant Brodeck adore. 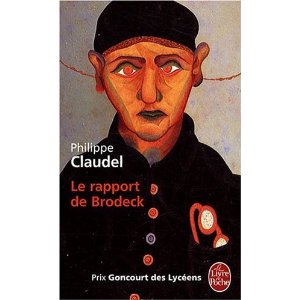
Quand il est revenu, à la fin de le guerre, un autre étranger, aussitôt baptisé « l'Autre », est arrivé au village. Il est délicat, cultivé, parle peu et a un réel talent de dessinateur. On l'observe comme une bête curieuse, tellement différent des autres habitants frustes de ce village. On commence par l'accueillir en grande pompe pour éviter de dire qu'on se méfie de lui mais rapidement on le marginalise, on l'ignore. Pas rancunier cependant, il décide de donner une petite fête pour remercier le village de l'avoir accueilli. Lors de cette fête, il expose les portraits des villageois qu'il a réalisés mais ceux-ci les trouvent tellement réalistes et surtout tellement mystérieux qu'ils les supposent accusateurs et s'en prennent à lui, déchirent ses cartons et tuent son cheval et son âne qu'il considérait comme des personnes. Ces portraits étaient comme des miroirs qui révélaient la face cachée de chacun. Certains y ont vu une allusion à peine voilée aux faits qui s'étaient déroulés pendant la guerre, le viol et le meurtre de trois jeunes filles, étrangères elles aussi, l'aventure fatale de Cathor, un villageois qui avait refusé de livrer un vieux fusil, et qui a été décapité devant tout le village ; c'est cet événement qui avait motivé la dénonciation et la déportation de Brodeck. Mais au lieu de quitter le village, « l'Autre » y erre pendant trois jours en criant sa souffrance. Il finira par en mourir au terme d'une sorte d’assassinat collectif. Ainsi, sous le masque de la respectabilité, de la bienséance et de l'hypocrisie, les habitants de ce village perdu sont-il devenus des meurtriers, révélant ainsi leur véritable image.
Un soir, Brodeck se rend au village pour acheter du beurre et se voit, lui le petit fonctionnaire sans importance, chargé de relater ces faits, c'est à dire d'en faire un rapport écrit. Il devient donc leur « scribe » pour que « celui qui lira le rapport comprenne et pardonne ». Obéissant, il s'exécutera, mais en réalité il n'y croit pas et les villageois non plus. Effectivement, le rapport une fois rédigé et lu par le maire est jeté au feu au motif que le passé appartient à la mort et qu'il faut aller de l'avant au nom de la vie.
A la suite de cela Brodeck décide de quitter enfin le village avec femme et enfant.
C'est étonnant le roman, les personnages tissent leur histoire et le lecteur en est le témoin, s'y identifie ou pas. Moi, je me suis senti très proche de ce Brodeck. Il est l'image de l'homme de bonne volonté aux prises avec les autres qui lui veulent du mal, gratuitement, pour se prouver sans doute qu'ils existent et qu'ils ont de l'importance. Il est assailli par la malchance mais tente de s'en sortir. Le malheur s'acharne sur lui sans qu'il y puisse rien et ne peut opposer à cela que sa seule vie minuscule et sans intérêt. Il est l'éternel guignon mais aussi le souffre-douleur de tous ces petits potentats qui certes le tiennent pour rien, ce dont il est persuadé, mais qui se croient tout permis. Ce roman est dérangeant parce qu'il traite de l’intolérance, de la noirceur de l'âme humaine, de la trahison, rappelle que la race des hommes n'est pas fréquentable, que « l'enfer c'est les autres »...et que tout cela est le quotidien de chacun d'entre nous. Le récit, même s'il est une fiction, est aussi là pour montrer les choses dans toute leur cruauté et l'eau de rose n'est pas ce qui l'irrigue forcément. Et d'ailleurs, ce Brodeck se révèle aussi mauvais que ceux qui l'ont persécuté, et la relation qu'il fait des événements dans son rapport entraîne une confession intime dont il ne sort pas grandi.
Un autre personnage ne m'a pas laissé indifférent, c'est le curé Peiper, un vieil ivrogne qui ne croit même plus en Dieu mais accepte, pour quelques bigotes, de rejouer inlassablement la même comédie du rituel religieux. Il ne trouve sa consolation que dans le vin qui l'aide à oublier toutes les fautes des villageois qu'au nom de Dieu il pardonne, mais aussi la folie destructrice des hommes, leur volonté de trahir avec la bonne conscience de ceux qui veulent se persuader qu'ils agissent justement. A cause de lui, de son message religieux d'un autre âge et des vieilles croyances populaires qui puisent leur existence dans une peur ancestrale, « l'Autre » prend une dimension diabolique qui justifie son élimination. Il symbolise lui aussi la solitude, la peur de l'homme face à ce qui ne lui ressemble pas, face à la mort aussi après laquelle il n'y a rien, ni paradis ni enfer, rien que le néant et que Dieu n'est peu-être rien d'autre que l’inspirateur des bassesses humaines.
C'est aussi un ouvrage sur la culpabilité « Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien ». Ce sont les premiers mots du narrateur, comme une excuse de tout ce qui va suivre et que va apprendre le lecteur. Pour tous ces gens qui le méprisent, il ne sera qu’un scribe, qu'un témoin, celui qu’ils ont chargé d'écrire ce meurtre dans son fameux rapport parce, ayant fait des études, il est seul à pouvoir le faire. Ils pensent sans doute qu'ils trouveront dans ses mots le pardon, pour ce qu'ils ont fait mais, devant son travail de tabellion méthodique, seules les flammes sont une réponse, comme si les phrases faisaient peur aux villageois, les désignant comme coupables pour l'avenir, pour l'Histoire peut-être ? Une des fonctions de l'écriture est de fixer le passé, d'en être la mémoire pour, peut-être, faire naître une certaine forme de compréhension voire de pardon. Ici, le rapport de Brodeck révèle la perfidie humaine et aux yeux du maire manque son but ce qui motive sa destruction. [« Il est temps d'oublier Brodeck, les hommes ont besoin d’oublier »]
J'ai déjà dit dans cette chronique que j'apprécie le style de Philippe Claudel, fluide et agréable à lire, plus spécialement peut-être dans les descriptions où l'attention portée aux détails les rend plus vraies encore. Même si ce roman est quelque peu dérangeant, il a représenté pour moi un bon moment de lecture.
N° 623 – Janvier 2013.
La dactylographe de Mr James Michel Heyns (Ed. Ph Rey)
Le grand écrivain américain Henry James (1843-1916) engagea en 1907 Theodora Bosanquet (1880-1961) en qualité de secrétaire. Elle le restera jusqu'à la mort de l'écrivain. Son travail consistait à taper à la machine sous la dictée de James. Elle ne se contenta pas de ce travail assez ingrat et écrivit elle-même « Henry James à l'ouvrage »(1924) où elle porte témoignage à la fois de l'homme et de l'écrivain. D'autre part elle publia également son journal ce qui fit d'elle un auteur reconnu.
L'auteur, Michel Heyns, s'empare de cette relation professionnelle authentique pour faire de Theodora, rebaptisée Frieda Worth, alors âgée de 23 ans, un personnage de roman. Tel est le prétexte de ce récit bien documenté, fort bien écrit, plein d'humour délicat, de descriptions agréables, d'analyses psychologiques. Il est en tout cas fort bien traduit (notamment avec un grand souci du mot juste). Il mêle la fiction à la réalité, créant lui-même pour les besoins de son récit des faits qui n'ont pas existé où qu'il déplace dans le temps et dans l'espace, s'inspirant de théories qui nourrissent son écriture, comme il s'en explique dans une note à la fin de l'ouvrage. Le texte distille une musique qui plonge le lecteur dans une ambiance surannée et un dépaysement agréable.
Sous la forme d'un récit chronologique qui va de novembre 1907 à juillet 1909, le narrateur décrit une époque où la femme est un citoyen de seconde zone dans un monde d'hommes mais où se développent cependant des mouvements d'émancipation. Frieda, jeune femme cultivée, discrète et vive d'esprit, promise à un avenir de mère de famille traditionnelle, cherche cependant à s'émanciper par le travail. Elle est toute disposée à se mettre au service de M. James avec compétence et réserve, même si elle considère que, pour gagner sa vie, elle mérite mieux que cet emploi subalterne. Elle s'installe donc à Ry, petite ville guindée du Sussex et s’acquitte de sa tâche. Il s'agit de préparer une édition complète, corrigée et commentée de l’œuvre de James. Dans cette maison de « Lamb house » vivent, autour de M. James des domestiques discrets, des invités parfois exubérants et extravagants et même le chien Max qui complète agréablement le tableau. Frieda y rencontr e a romancière américaine Edith Warthon (1862-1937), Morton Fullerton, journaliste américain, correspondant du Times à Paris, amant de cette dernière et ami de M. James. Avec lui elle noue une relation cordiale et respectueuse au début, la promesse d'une future vie commune et même une relation amoureuse même si cette dernière, par sa rapidité, est quelque peu en contradiction avec le puritanisme de l'époque. En réalité c'est plutôt un marché autour de lettres jugées compromettantes pour lui qu'elle est chargée de récupérer, même si pour cela, et contrairement à l'éducation qu'elle a reçue de sa mère, elle doit trahir le naïf M. James. Elle le fera par amour mais le déroulement des événements lui révélera le cynisme de M. Fullerton et finalement orientera sa vie future.
e a romancière américaine Edith Warthon (1862-1937), Morton Fullerton, journaliste américain, correspondant du Times à Paris, amant de cette dernière et ami de M. James. Avec lui elle noue une relation cordiale et respectueuse au début, la promesse d'une future vie commune et même une relation amoureuse même si cette dernière, par sa rapidité, est quelque peu en contradiction avec le puritanisme de l'époque. En réalité c'est plutôt un marché autour de lettres jugées compromettantes pour lui qu'elle est chargée de récupérer, même si pour cela, et contrairement à l'éducation qu'elle a reçue de sa mère, elle doit trahir le naïf M. James. Elle le fera par amour mais le déroulement des événements lui révélera le cynisme de M. Fullerton et finalement orientera sa vie future.
De son propre aveu, l'auteur précise qu'il prend des libertés avec la personnalité de Miss Worth, encore qu'on peut aisément imaginer qu'elle ait pu obéir à l'invitation de M. James de profiter de la vie[« Profitez de la vie autant que vous le pouvez, c'est une erreur de ne pas le faire »]. Ce qui est sûr en revanche c'est que Theodora Bosanquet a eu après la mort de M. James des communications avec lui par le biais du spiritisme, ce qui, en quelques sortes prolongea la fonction de dactylographe de cette dernière. L'auteur la rend également réceptive à la télépathie pratiquée, par l’intermédiaire de sa Remington, avec le même M. Fullerton ! Cela peut paraître un peu fantaisiste mais Heynz a choisi de rendre compte, par ce biais de l'intérêt que portait Thoedora Bosanquet aux phénomènes paranormaux. En réalité, Frieda prend de plus en plus d'importance au sein même de cette famille puisque, au départ, on considérait qu'une simple dactylographe ne fournissait qu'une prestation, n'était pas obligée de comprendre ce qu'elle tapait et n'était que le simple prolongement de sa machine. Au fur et à mesure du récit, et notamment à l'invitation de la nièce de M. James, elle s'impose également, loin des esprits frappeurs, des guéridons et autres séances d'invocation, comme une sorte de médium entre cette dernière et une tante décédée. Sa machine va donc devenir une sorte d'instrument de « l'écriture automatique » et Frieda un truchement indispensable dans ce phénomène. Aux yeux de M. James, elle prend aussi une autre dimension qui décide de sa vie future. En revanche, elle ne va pas tarder à s'apercevoir de la duplicité, de l'hypocrisie et de la trahison qui animent les différents membres de ce microcosme comme toutes les sociétés humaines qui en sont friandes. M. James, lui, semble à part, comme dans une bulle, uniquement préoccupé par son écriture.
Ainsi l'auteur en profite-t-il pour parler de la mort, de la vie, de la notoriété, de la renonciation, en les relativisant (« La vie nous trahit, seul l'art ne déçoit pas »). Dans ce lieu un peu à part, le lecteur voit peu à peu apparaître des thèmes consacrés aux suffragettes, au spiritisme et aux techniques nouvelles, traduisant des préoccupations en vogue à l'époque victorienne mais aussi des comparaisons entre l'ancien et le nouveau monde, William James, le frère d'Henry résidant avec sa famille aux États-Unis.
Miss Worth est donc le témoin privilégié d'un monde auquel elle n'appartenait pas au début mais qu'elle parvient cependant à maîtriser. La scène finale, dans le brasier qui se consume est révélatrice et Frieda n'est plus une simple secrétaire, elle devient l'égal de James face à la vie. C'est un peu comme s'il lui passait un relais de l'écriture. Quant à Heyns, sans tomber dans le plagiat, il rend fort bien l'ambiance des œuvres de James. L'hommage qu'ainsi il lui rend est de qualité.
J'avoue volontiers que, malgré quelques remarques sur la vraisemblance de certains épisodes, ce roman m'a procuré un bon moment de lecture.
Traduit de l'anglais (Afrique du sud) par Françoise Adelstain
N°619– Janvier 2013.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
Chien du Heaume - Justine NIOGRET (Mnémos éditions)
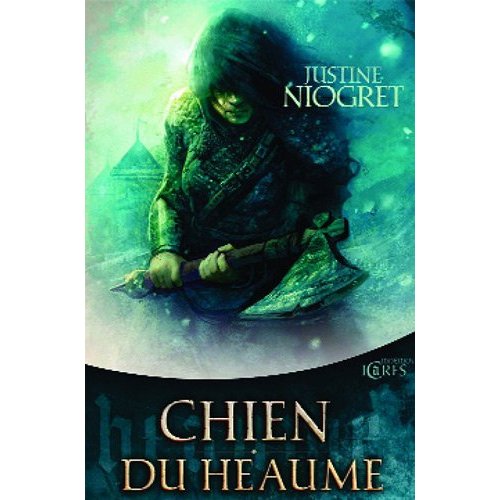 Nous sommes au Moyen-Age et Chien de Heaume est le nom d'une jeune femme, pas vraiment belle et même plutôt laide, devenue mercenaire par amour de la liberté. Elle n'échappe pas aux clichés convenus et n'est pas la dernière pour tuer et semer la terreur autour d'elle. En réalité, le lecteur apprend très tôt que l'objet de sa véritable motivation est seulement... son nom, qu'elle dit avoir perdu depuis son enfance. Elle n'a pour richesse qu'un médaillon et ses armes et plus spécialement une hache sur laquelle apparaît un décor de serpent. Elle les tient de son père et sa hache est semblable à celle que possède le Chevalier Sanglier mais ce dernier ne sait pas la renseigner. Pourtant elle est détentrice d'un secret. Elle a vu mourir son père dans un combat simulé qu'il avait lui-même provoqué avec sa fille. Ainsi, il a voulu l'initier à l'art de la lutte, comme un rite de passage, lui transmettre un savoir qui garantirait sa vie dans un monde hostile. Il a aussi choisi sa mort, volontairement, en préférant la hache qu'il allait lui léguer parce que la vie lui était devenue insupportable. Il a voulu entrer dans le néant en intronisant sa fille à une existence qu'il menait lui-même, celle d'un mercenaire, avide de sang et de batailles et qui serait dorénavant la sienne !
Nous sommes au Moyen-Age et Chien de Heaume est le nom d'une jeune femme, pas vraiment belle et même plutôt laide, devenue mercenaire par amour de la liberté. Elle n'échappe pas aux clichés convenus et n'est pas la dernière pour tuer et semer la terreur autour d'elle. En réalité, le lecteur apprend très tôt que l'objet de sa véritable motivation est seulement... son nom, qu'elle dit avoir perdu depuis son enfance. Elle n'a pour richesse qu'un médaillon et ses armes et plus spécialement une hache sur laquelle apparaît un décor de serpent. Elle les tient de son père et sa hache est semblable à celle que possède le Chevalier Sanglier mais ce dernier ne sait pas la renseigner. Pourtant elle est détentrice d'un secret. Elle a vu mourir son père dans un combat simulé qu'il avait lui-même provoqué avec sa fille. Ainsi, il a voulu l'initier à l'art de la lutte, comme un rite de passage, lui transmettre un savoir qui garantirait sa vie dans un monde hostile. Il a aussi choisi sa mort, volontairement, en préférant la hache qu'il allait lui léguer parce que la vie lui était devenue insupportable. Il a voulu entrer dans le néant en intronisant sa fille à une existence qu'il menait lui-même, celle d'un mercenaire, avide de sang et de batailles et qui serait dorénavant la sienne !
Dans sa quête qui la mène de château en château, elle va croiser des personnages tels qu'on se les imagine, batailleurs, violents, durs, à cent lieux de l'amour courtois et des troubadours. Le seigneur Bruec, le chevalier Sanglier, est l'un d'eux et une amitié va naître qui les aidera à se découvrir l'un l'autre.
L'auteur se livre ici à une véritable reconstitution historique où se mêle l'imaginaire. Elle transporte le lecteur dans un autre temps, une autre ambiance, dans un climat glacial, une terre inhospitalière, des châteaux froids et sombres. Rien ne manque dans ce décor que les mots accompagnent, les campagnes désolées et brumeuses, les paysans pauvres et superstitieux, les famines, les forêts mystérieuses qui abritent des enfants-fées et des necrebestes, les combats sans merci, les légendes et les monastères perdus, les champs de bataille et les animaux fabuleux, les morts violentes, l'exil, l'errance, la magie... En revanche, il n'y a pas d'érotisme comme on pourrait s'y attendre, même pas d'amours entre Chien et Sanglier, le peu d'appas de l'héroïne ne les suscite pas. Il y a en revanche beaucoup de sang et de violence.
Le narrateur qui est en fait un conteur, comme au Moyen-Age, raconte cette histoire, intervient parfois dans le récit pour une explication. Elle nous averti d'ailleurs « Les conteurs sont une race étrange... leur langue ne sait jamais se taire. On les aime... mais on les craint ... Eux peuvent couper les âmes avec un seul mot... (Ils) sont à la frontière de notre monde et de l'autre, celui où dorment merveilles et monstres et de là vient tout leur pouvoir. ».
Chien de Heaume est un personnage tourmenté, solitaire, désespéré même. Sa quête se décline à travers divers personnages qu'elle rencontre, du chevalier Sanglier à Orains et au forgeron Rehegir et le temps qui passe s'égrène à travers les saisons. On songe un peu à un personnage d'un BD « fantasie » (suivant la définition officielle : genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique qui prend ses sources dans l'histoire, les mythe, les contes et la science-fiction ») comme la couverture le suscite.
Le livre se lit rapidement et l'intrigue est passionnante. On a cependant l'impression qu'elle pourrait ainsi durer plus longtemps. Le thème de la quête, très en vogue à cette époque, entretient le suspense même si le lecteur reste un peu sur sa faim et si on peut déplorer le côté un peu trop gore.
©Hervé GAUTIER – n° 512 - mars 2011
CODE 1879 - Dan WADDELL (Éditions Rouergue noir)
Cela commence plutôt mal en ce matin d'hiver pour l'inspecteur principal Grant Foster et pour son assistante, le lieutenant Heather Jenkins : on vient de trouver, près d'un cimetière londonien, le cadavre d'un homme poignardé et qui, apparemment, a eu les mains amputées avant de mourir. De plus, le meurtrier a pris la précaution de graver sur le corps de sa victime une inscription énigmatique faite de chiffres et de lettres dont notre limier ne tarde pas à s'apercevoir qu'elle fait référence à la généalogie. De plus, sur son portable, le dernier numéro composé est : 1879. Il n'y a pourtant pas de mobile apparent mais les recherches menées à partir de l'indication tailladée sur la peau du mort font entrer en scène Nigel Barnes, un généalogiste professionnel, personnage étonnant et surtout désargenté ! Peu de temps après, d'autres meurtres tout aussi mystérieux et rituels donnent à penser qu'ils sont le fait du même assassin et qu'ils en évoquent cinq autres également mystérieux, perpétrés dans les bas-fonds du Londres victorien de 1879. On songe à un remake de Jack L'éventreur !
A force de dépouiller les archives et les journaux de l'époque, ce qui ne fut pas un mince travail puisque les premières étaient imprécises et les seconds trop marqués par leur époque, les enquêteurs en arrivent à la conclusion que, par delà le temps, non seulement le meurtrier leur lance un défi mais surtout un avertissement : D'autres meurtres sont à venir et la police, pour peu que ses investigations et ses raisonnements soient pertinents, détient la clé de l'énigme ! Un peu comme s'il avait lui-même enclenché un compte à rebours macabre. Pire peut-être puisque peu à peu l'idée selon laquelle « le passé explique le présent » s'impose. Ainsi établit-on que la police de l'époque a, pour masquer son incompétence, largement contribué à faire condamner et exécuter un innocent par la justice victorienne pour les cinq crimes non élucidés. Il se pourrait donc bien qu'un descendant du condamné revienne pour le venger en s'en prenant aux membres actuels de la famille de ceux qui, à l'époque, avaient contribué à cette erreur judiciaire ! D'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet, le meurtrier prend bien soin d'évoquer par des similitudes les meurtres de 1879. Une vengeance hors du temps en quelque sorte !
seconds trop marqués par leur époque, les enquêteurs en arrivent à la conclusion que, par delà le temps, non seulement le meurtrier leur lance un défi mais surtout un avertissement : D'autres meurtres sont à venir et la police, pour peu que ses investigations et ses raisonnements soient pertinents, détient la clé de l'énigme ! Un peu comme s'il avait lui-même enclenché un compte à rebours macabre. Pire peut-être puisque peu à peu l'idée selon laquelle « le passé explique le présent » s'impose. Ainsi établit-on que la police de l'époque a, pour masquer son incompétence, largement contribué à faire condamner et exécuter un innocent par la justice victorienne pour les cinq crimes non élucidés. Il se pourrait donc bien qu'un descendant du condamné revienne pour le venger en s'en prenant aux membres actuels de la famille de ceux qui, à l'époque, avaient contribué à cette erreur judiciaire ! D'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet, le meurtrier prend bien soin d'évoquer par des similitudes les meurtres de 1879. Une vengeance hors du temps en quelque sorte !
Foster ne pouvait guère s'imaginer, au début de cette enquête, qu'il y serait mêlé de si près.
Je dois bien admettre que l'écriture est quelconque et proche des romans de ce genre, mais peu importe puisque le suspens est bien au rendez-vous de ce polar palpitant. Les personnages ressemblent sans doute à ceux qu'on s'attend à rencontrer dans un roman policier, flic un peu marginal à l'histoire personnelle mouvementée et même accro à l'alcool et au tabac, jeune femme délurée, généalogiste fauché mais érudit ... Cependant l'originalité de cette œuvre tient sans aucun doute à l'introduction de la généalogie alors que, aujourd'hui, on s'attend davantage à rencontrer des méthodes de police scientifique. Elles existent certes au cours de cette enquête, comme existe la drogue (le GHB pour être précis) mais la généalogie y tient une place à part.
Entre les atermoiements, les difficultés et même les erreurs des policiers londoniens contemporains, le lecteur entre facilement dans ce jeu où on lui propose des allers et retours entre le XIX° siècle et aujourd'hui autant qu'une plongée dans cette Angleterre victorienne des bas-fonds. Je songe aussi au travail sans doute long et difficile que l'auteur a dû accomplir non seulement pour réunir de la documentation mais aussi pour distiller ainsi le suspens et retenir, jusqu'à la fin, l'attention de son lecteur.
Traduit de l'anglais par Jean-René Dastugue.
J'ai bien aimé cette œuvre, la première traduite en français, d'un auteur que je ne connaissais pas mais dont je lirai assurément les suivantes.
© Hervé GAUTIER - N° 555 – Février 2012
La vie est belle - Un film de et avec Roberto BENIGNI (1997)
Nous sommes en 1938 en Italie. Ce film met en scène Guido (Roberto Benigni), un serveur juif-italien excentrique, plein de joie de vivre, un peu  dragueur et gaffeur qui souhaite ouvrir une librairie et passe son temps à deviner des rébus que lui propose un client de l'hôtel où il travaille. Il est d'autant plus extravagant qu'il tombe amoureux de Dora (Nicoletta Braschi), une jeune institutrice et cherche toutes les occasions de se faire remarquer. C'est plutôt mal engagé pour lui puisqu'elle est fiancée à un notable fasciste, mais Guido finit par l'épouser et à avoir avec elle un petit garçon, Giosué (Giorgio Cantarini). Malheureusement le régime de Mussolini persécute les juifs et, quelques années plus tard toute la famille est envoyée dans un camp d'extermination. Resté avec son fils, Guido va lui faire croire que tout ce qu'il voit n'est qu'un jeu où il faut accumuler des points pour gagner le premier prix qui est un vrai char d'assaut.
dragueur et gaffeur qui souhaite ouvrir une librairie et passe son temps à deviner des rébus que lui propose un client de l'hôtel où il travaille. Il est d'autant plus extravagant qu'il tombe amoureux de Dora (Nicoletta Braschi), une jeune institutrice et cherche toutes les occasions de se faire remarquer. C'est plutôt mal engagé pour lui puisqu'elle est fiancée à un notable fasciste, mais Guido finit par l'épouser et à avoir avec elle un petit garçon, Giosué (Giorgio Cantarini). Malheureusement le régime de Mussolini persécute les juifs et, quelques années plus tard toute la famille est envoyée dans un camp d'extermination. Resté avec son fils, Guido va lui faire croire que tout ce qu'il voit n'est qu'un jeu où il faut accumuler des points pour gagner le premier prix qui est un vrai char d'assaut.
Il est convenu de dire que ce film est une fable, une sorte de conte pour enfant. Benigni lui-même l'a prétendu. Il n'y a en effet rien de vraiment réaliste dans ce décor. Dans Arrezo où il habite, Guido semble étranger à la traque des juifs et ce film n'a rien de rigoureusement historique. Le camp est tout à fait fictif et Giosué a beau se cacher, on a du mal à croire à la réalité de ce que l'on voit. Malgré le travail forcé des prisonniers, le camp semble quelque peu surréaliste et tout ce qu'on sait de l'univers concentrationnaire ne se retrouve pas ici.[« Et si tout cela n'était qu'un rêve »]. Au début la magie opère dans les yeux de l'enfant qui croit l'histoire que son père lui raconte même si, à un certain moment il est le témoin d'une révélation sur le véritable but des nazis qui est l'élimination des juifs. Pourtant, Giosué semble avoir tout compris mais continue de faire semblant, même si cette histoire de char d'assaut qu'il avait fini par oublier, se transforme, à son grand étonnement, en réalité par la libération du camp par les troupes américaines. Guido lui-même se prend au jeu, surtout quand il s'improvise traducteur de l'allemand qu'il ne parle pas et quand il découvre le monceau d'ossements, il est complètement ébahi et semble prendre enfin conscience de l'évidence. Même la mort de Guido ne parvient pas à être triste parce qu'on songe, malgré nous peut-être à celle d'un clown de cirque à laquelle on ne croit pas et non à celle d'un déporté juif.
Benigni donne ici toute sa mesure. Il réussit à nous faire sourire sur le thème de la mort, sur celui de l’extermination des êtres humains par d'autres hommes, sur celui de la Shoah. L'auteur semble nous dire que l'humour sauve de tout, même des pires choses, que c'est une bonne manière de résister à la noirceur, à l'oppression. Non seulement ce n'est pas faux puisque l'humour juif existe mais il a bien dû aider ce peuple dans son long combat pour l'existence.
J'y ai vu une fabuleuse histoire d'amour, celle de Guido et de Dora : Il fait tout pour la conquérir et elle qui n'est pas juive exige de suivre son mari et son fils dans le train de déportés. Malgré la séparation du camp, Guido lui fait constamment des signes qu'elle comprend et il mourra en tentant de la retrouver. C'est un peu comme si lui aussi cherchait à se jouer une comédie et à se convaincre que tout ce camp n'est qu'un décor et qu'il va la rejoindre. C'est aussi une histoire d'amour d'un père pour son fils à qui il cherche à cacher la vérité. Même si ce film est tragique par le thème traité, par l’éclatement de cette famille qui ne demandait qu'à être heureuse et par la mort qui rôde, il ne faut pas oublier que ces faits, même s'ils sont imaginaires, même s'ils sont présentés avec humour et surréalité, peuvent parfaitement se reproduire de nos jours et le nazisme peut prendre des formes inattendues mais bien réelles.
De nombreux prix qui ont couronné ce film (César du meilleur film étranger – Oscar du meilleur film étranger – Oscar du meilleur acteur pour Roberto Benigni – Oscar de la meilleure musique de film)... Pour ma part, une fois l'écran devenu noir j'ai eu la certitude d'avoir assisté à une histoire poétique et pleine d'émotion.
[Cine + famiz – Mercredi 1° août 20h40.]
Hervé GAUTIER - n° 591 - Août 2012.
Rien ne s'oppose à la nuit - Delphine de VIGAN - JC LATTES
Au départ les paroles d'une chanson d'Alain Bashung, un roman dont j'avais beaucoup entendu parler, couronné par un prix [Prix du roman Fnac 2011], un auteur qui commençait à accéder à la notoriété et la couverture, avec ce beau visage de femme aux faux-airs de Jeanne Moreau jeune qui se trouve être celui de Lucile, la mère de l'auteur.
2011], un auteur qui commençait à accéder à la notoriété et la couverture, avec ce beau visage de femme aux faux-airs de Jeanne Moreau jeune qui se trouve être celui de Lucile, la mère de l'auteur.
Ce roman, puisque c'en est un, s'ouvre sur la mort de Lucile, cette femme, qui, à 61 ans semble avoir choisi cette issue, pas vraiment un suicide mais quelque chose comme un refus de vivre, de vieillir et de souffrir. C'est donc un hommage à cette mère autant qu'une quête, qu'un travail de deuil qu'elle entreprend, une façon de rompre le silence qui l'entourait, de comprendre cette femme qui avait été sa mère, une sorte d'inconnue... [« Lucile était un rempart de silence autour du bruit »]. Pourtant l'auteur butte sur une sorte d'impossibilité [« Lucile avait édifié les murs d'un territoire retiré qui n'appartenait qu'à elle, un territoire où le bruit et le regard des autres n'existaient pas »] au point qu'elle demande des informations à ses oncles et tantes. Elle veut comprendre pourquoi cette femme belle, intelligente mais triste, immature et dépressive, a pu en arriver là. Qui était donc cette Lucile, cette fille pas très intéressée par l'école, rêveuse mais intelligente et déterminée dont le charme (déjà) en faisait l'enfant préférée de Georges, son père ? Elle était la troisième d'une grande famille dont trois garçons étaient décédés par suicide, ce qui lui a donné très tôt l'image de la mort, de la tristesse, du silence, de l'absence définitive. Dans sa parentèle, parmi ses amis ou les hommes qui ont fait un temps partie de sa vie, beaucoup ont ainsi choisi leur mort.
On ne peut parler de sa mère sans la rattacher à l'univers familial. C'est en effet quelque chose qu'on ne manie pas facilement parce que, plus que d'autres sans doute, c'est un registre difficile à cause de la mémoire qui fait défaut par moments alors que parfois elle est étonnamment vive et précise. Dans un tel travail d'écriture, on est tenté d'être opportunément oublieux, voire de mauvaise foi, de régler des comptes ou de se livrer à une entreprise de thuriféraire, autant d'actions contradictoires qui sont aussi des d'écueils. C'est que ce livre est un univers douloureux et quand on décide d'explorer les arcanes de l'histoire intime d'une fratrie on finit par côtoyer l'envie, la jalousie, l'admiration, la vengeance. Le fantasme aussi s'installe quand les choses ne sont pas sûres mais au fur et à mesure qu'on avance dans l’introspection ou la découverte, les êtres auparavant flous ou simplement idéalisés prennent de la netteté et leurs contours se précisent. Georges, le mari de Lucile, sous des dehors respectables était « un père nocif, destructeur et humiliant », à l'attitude ambiguë vis à vis de ses filles, Lucile, sa propre mère lui échappe peu à peu. [« J'étais devenue son ennemie...je ne comptais plus. »] puis le mystère lève son voile sur d'autres facettes imprévues. Dès lors, le lecteur s’aperçoit que dans cette famille, comme dans bien d'autres, on cultive le non-dit, l'hypocrisie et le tabou. C'est que, écrire un tel livre qui ressemble beaucoup à une autobiographie, est un exercice délicat. C'est, sous couvert du classique devoir de mémoire ou d'une catharsis, faire resurgir des souvenirs qu'on voulait oublier, redessiner la lente descente de cette femme vers la mort, à travers une vie de couple difficile conclue par un divorce, des silences, des amours malheureuses et plurielles, des fragilités, des failles, son mal de vivre, un cheminement avec la drogue et l'alcool, ses erreurs, ses délires, ses engagements, ses désespoirs, ses hospitalisations en service psychiatrique et anticancéreux, ses guérisons et ses rechutes, sa rupture progressive avec la vie sociale et avec sa famille, son refus des traitements...
Celui qui tient le stylo est, en principe maître du jeu, il a le droit d'exercer son art, le devoir aussi sans doute et c'est ce qui motive l'auteur pour faire à sa mère « ce cercueil de papier ». Mais je note aussi que, durant tout le récit, l'auteur, à plusieurs reprises, s'interroge sur sa propre démarche au point de s'impliquer directement [« Sans doute m'a-t-il semblé que le « je » pouvait s'intégrer dans le récit lui-même... C'est un leurre, bien entendu... L'écriture ne donne accès à rien »] ou simplement, à cause de la perturbation qu'il lui cause, d'en arrêter la rédaction. Dès lors se pose la question de l'écriture, de son impossibilité, des doutes qui la paralyse, des personnages qui échappent à l'auteur, les interrogations jaillies de la lecture d'un journal intime ou d'une confidence, d'un souvenir. C'est un thème fascinant que celui de l'écriture et je ne perds jamais de vue l'opinion de Simenon qui juge que le métier d'écrivain s'inscrit dans le malheur parce que, lorsqu'on entreprend un tel travail, on n'en ressort pas indemne. On laisse dans cette démarche toujours un peu de ses illusions et de ses certitudes, on rêve de revenir à la facilité d'une fiction, d'avancer masqué derrière un personnage, on n'est pas sûr d'arriver au bout de sa démarche mais malgré tout on en a un extraordinaire besoin. Il est convenu de dire que l'écriture libère... Je n'en suis pas certain. Au contraire peut-être ? Sous des dehors salvateurs et parfois exorcistes, elle a toutes les chances de brouiller un peu plus les cartes, d'engendrer des ruptures, des interrogations douloureuses qui resteront à jamais sans réponse.
Et puis les choses se précisent et l'auteur prend conscience autant qu'elle la craint, de l'hérédité, de la folie, de cette certitude qu'elle peut parfaitement la transmettre à son tour à ses enfants, l'intuition d'une sorte de destinée malsaine où l'on répète, sans le vouloir, l'exemple délétère donné par les générations précédentes. Elle se rappelle avoir été victime d'anorexie qui est une manière de s’autodétruire
Que m'est-il resté, le livre refermé ? D'abord une impressionnante somme de notes destinées à rédiger cette chronique, preuve que ce livre ne m'a pas laissé indifférent et même m'a interpellé. Puis une impression de malaise, que ce que je viens de lire est en réalité un témoignage poignant et plein d'amour, écrit non comme un roman mais avec la spontanéité d'une femme qui cherche des réponses avec, en contre-point, une sorte de fascination de la mort autant qu'un amour de sa mère et de la vie.
Hervé GAUTIER - n° 585 – Juillet 2012
Maman - Un film d'Alexandra LECLERE
Alexandra Leclère s'attaque encore une fois au drame de la famille. Déjà, avec « les sœurs fâchées » (la Feuille Volante n° 554) elle avait mis en scène deux femmes que tout opposait. Ici, ce sont également deux sœurs, Sandrine (Mathilde Seigner) et Alice (Marina Foïs), la quarantaine, parisiennes, mais bien différentes l'une de l'autre qui voient, tout d'un coup, leur mère, Pauline, divorcée (Josiane Balasko) dont elles n'avaient pas de nouvelles depuis vingt ans, débarquer dans la capitale parce qu'elle a été abandonnée par l'homme avec qui elle vivait. Cette mère acariâtre, excessive et égoïste compte sur ses filles pour la seconder, l'aider dans sa nouvelle vie et peut-être aussi lui faire oublier son échec sentimental. C'est surtout l'occasion pour elles de régler avec leur mère un vieux compte. Elle ne les a jamais aimées, elle n'a jamais su être maternelle bref elle n'a été pour ses filles qu'une véritable étrangère. Elles vont donc la kidnapper le temps d'un week-end dans un manoir breton pour lui faire prendre conscience de ses carences affectives et l'obliger enfin à les aimer.
Au début c'est Sandrine qui ouvre le bal et s'oppose ouvertement à sa mère alors que sa sœur paraît vouloir rechercher un compromis. Alice, plus docile, semble même être à la traîne de sa  sœur, mais, tout d'un coup, elle prend conscience que l'occasion est trop belle et sort de ses gonds. C'est à cause de cette mère indigne que ses filles ont manqué d'amour, que Alice passe son temps à refuser la maternité en se faisant avortée et que Sandrine a une vie sentimentale décousue. Des claques volent en même temps que des mots durs mais aussi des menaces de mort... Alice et Sandrine veulent faire payer à Pauline tout ce temps perdu, toutes ces occasions manquées. Chacun finit par s'expliquer et il n'y a rien de manichéen dans cette situation. Il y a une opposition entre le calme de la mer et la violence des scènes de ce film préfigurant peut-être la réconciliation du dénouement qui se conclue par une sorte de « happy end », si on veut le voir comme cela, dans le fait que Sandrine qui était la plus remontée contre sa mère, à tel point qu'elle ne pouvait même pas l'appeler « maman », lui donne enfin ce titre.
sœur, mais, tout d'un coup, elle prend conscience que l'occasion est trop belle et sort de ses gonds. C'est à cause de cette mère indigne que ses filles ont manqué d'amour, que Alice passe son temps à refuser la maternité en se faisant avortée et que Sandrine a une vie sentimentale décousue. Des claques volent en même temps que des mots durs mais aussi des menaces de mort... Alice et Sandrine veulent faire payer à Pauline tout ce temps perdu, toutes ces occasions manquées. Chacun finit par s'expliquer et il n'y a rien de manichéen dans cette situation. Il y a une opposition entre le calme de la mer et la violence des scènes de ce film préfigurant peut-être la réconciliation du dénouement qui se conclue par une sorte de « happy end », si on veut le voir comme cela, dans le fait que Sandrine qui était la plus remontée contre sa mère, à tel point qu'elle ne pouvait même pas l'appeler « maman », lui donne enfin ce titre.
Il y a sans doute de l'autobiographie dans ce film, mais nous sommes nombreux sans doute à avoir souffert de l'abandon ou de l'indifférence de nos parents. L'amour maternel est une sorte de fantasme que nombre d'écrivains et de poètes ont célébré et qui a été, en quelque sorte, sanctifiée par une fête annuelle, même si celle-ci nous vient des temps contestés du pétainisme. A mes yeux, c'est plutôt bien d'avoir montré que toutes les femmes ne sont pas maternelles, et pourquoi le seraient-elles d’ailleurs ? Nous avons tous vécu avec cette sorte d'image d’Épinal où la femme devenue mère se sacrifiait pour ses enfants. Il suffit de promener son regard sur notre société, d'écouter parler les gens, de recueillir leur témoignage pour se persuader que toutes les grandes idées qu'on peut avoir sur la famille en général et sur les mères en particulier se révèlent souvent être des idées fausses mais qu'on transforme rapidement en tabou pour éviter de les évoquer. Après tout, toutes les petites filles n'ont pas joué à la poupée au sortir du berceau et si, mariées, elles ont donné la vie, ce n'était pas forcément par désir mais on peut imaginer qu'elles l'ont fait par hasard, par erreur, par accident ou pour satisfaire à un besoin de descendance de leur famille. L'amour n'est pas forcément au rendez-vous et elles ne sont pas, dans ces conditions, tenues d'aimer leur rejetons. Tant pis pour eux, il faudra qu'ils s'y fassent, qu'ils vivent avec ce manque toute leur vie et qu'ils parviennent, peut-être à le surmonter !
Ce film, même s'il comporte des longueurs inévitables compte tenu du thème traité n'est pas une fable, pas une fiction, bien au contraire, c'est un drame, une histoire banale mais douloureuse qui malheureusement se reproduit trop souvent et génère injustices et traumatismes pour les enfants qui sont, bien souvent, les seuls à payer.
Hervé GAUTIER - n° 577 - Mai 2012
Le crabe-tambour Un film de Pierre SHOENDOERFFER (1977)
Le 14 mars 2012, Pierre Shœndœrffer nous quittait à l'âge de 83 ans. La République et l'armée ont rendu un hommage solennel aux Invalides, en présence du Premier ministre et du ministre de la culture à celui qui s'était engagé dans le service cinématographique des armées en Indochine jusqu'à la défaite de Diên Biên Phu. Il avait continué sa vie en tant que photographe de presse, cinéaste et romancier, se situant dans la lignée prestigieuse des écrivains de marine.
la culture à celui qui s'était engagé dans le service cinématographique des armées en Indochine jusqu'à la défaite de Diên Biên Phu. Il avait continué sa vie en tant que photographe de presse, cinéaste et romancier, se situant dans la lignée prestigieuse des écrivains de marine.
L'histoire tout d'abord. Elle est suggérée par un roman éponyme de Shœndœrffer paru chez Grasset (Grand prix du roman de l'Académie Française), inspiré par la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume. Il retrace la dernière mission d'un capitaine de vaisseau, homme austère, dévoré par un cancer, (Jean Rochefort dit « le vieux ») qui reprend un commandement à la mer sur l'escorteur d'escadre « Jauréguiberry » dont c'est le dernier voyage avant sa réforme définitive. Il s'agit d'assurer une mission de surveillance et d'assistance aux chalutiers français pêchant sur les bancs de Terre-Neuve.
Pourtant c'est un peu plus que cela, c'est un retour dans le passé puisque « le vieux » veut revoir une dernière fois son ami et compagnon d'armes, l'ancien lieutenant de vaisseau Willsdorff, dit « le crabe-tambour » (Jacques Perrin) devenu capitaine de chalutier dans ce Grand Nord désolé, fuyant ainsi l'espère humaine avec, comme toujours, un chat noir sur l'épaule. C'est Pierre (Claude Rich), le médecin du bord, qui en a parlé le premier sur la passerelle « Vous connaissez Willsdorff ?». Lui était son ami en Indochine et souhaite le revoir une dernière fois. C'est la vraie raison de son rengagement et de sa présence à bord. Après la défaite française, il est resté là-bas pour soigner ses anciens ennemis. Il a pourtant été expulsé du Viet-Nam. Le commandant, habile manœuvrier, confie au médecin son corps meurtri par la maladie mais aussi son âme tourmentée d'homme « déjà mort » en l'invitant chaque jour à sa table. Il est évidemment question de Willsdorff, ce mythique soldat perdu qu'ils ont connu séparément. Pourtant, cette rencontre n'aura lieu qu'en filigrane, avec une grande économie de mots, comme si, malgré son ultime démarche, le commandant ne pouvait plus parler à cet ami, comme si c'était trop tard, comme s'il n'avait plus rien de commun avec lui, comme s'ils n'étaient plus l'un pour l'autre que deux fantômes. Cette idée est suggérée dans la scène du transfert du courrier où les deux bâtiments se côtoient, une trace sur l'écran radar, la radio qui grésille, rien que quelques mots convenus trop lourds de passé, un salut de sirène, une page qui se tourne, définitivement ! « Adieu » ne cesse de répéter Willsdorff, « Aperçu » fait simplement répondre le commandant par le timonier. Seul Pierre échangera quelques mots amicaux et complices avec Willsdorff et le chalutier s'éloignera.
Cette quête est alimentée en flash-back par des évocations de gens qui l'ont également connu, le commandant puis Pierre, le narrateur de ce récit, mais aussi le chef mécanicien, dit « le chef », alcoolique et catholique pratiquant (Jacques Dufilho) et ses histoires loufoques du pays bigouden, chacun apportant témoignages et souvenirs de cet homme hors du commun ayant combattu en Indochine. Ils évoquent, chacun à leur manière et avec des anecdotes, le parcours militaire de cet officier fidèle à son engagement et à lui-même, à son sens de l'honneur, qui est exclu de l'armée, jugé pour désobéissance et rébellion. (« une histoire de mer et de discipline poussée jusqu'à l'absurde ») Cela sonne comme un hommage, comme un remerciement à quelqu'un qui a refusé la compromission face à un choix.
Dans ce film il y aussi un questionnement chrétien et même profondément humain qui m'interpelle, même s'il passe quelque peu au second plan. C'est celui qui est évoqué par « La parabole des talents », texte de l'Évangile qui invite chaque homme à s'interroger sur le sens de son passage sur terre et sur l'usage qu'il a fait des facultés qu'il a reçues à sa naissance, sur la fidélité aussi. « Qu'as-tu fait de ton talent ? », « Celui qui ne fait pas fructifier ce qu'il a reçu du Seigneur sera jeté dans les ténèbres extérieurs », rappelle « le chef ». C'est aussi l'occasion pour l'auteur d'asséner des aphorismes : « Qui êtes-vous pour le juger ? » de rappeler que le choix de l'homme « n'est pas forcément entre le bien et le mal, mais entre un bien et un autre bien ».
Le nom même de Pierre Shœndœrffer évoque des films devenus mythiques qu'il a réalisés « La 317° section » (1964), « L'honneur d'un capitaine » (1982) qui s'interrogent tous sur les guerres coloniales françaises, sur les militaires eux-mêmes Plus que « Ramutcho »(1958) et « Pêcheurs d'Islande »(1959) qui sont des adaptations des romans de Pierre Loti et qui ne rencontrèrent guère le succès, Pierre Shœndœrffer s'attacha toujours à évoquer l'aventure humaine, témoin « La passe du diable » (1956) qui est une adaptation du roman de son ami Joseph Kessel mais aussi la dure réalité de la guerre, sur les questions qu'elles posent, les personnalités qu'elles révèlent [ « Diên Biên Phu »(1992)]. C'est que les personnages de ces films s'inspirent tous d'hommes ayant réellement existé, témoignent de leur parcours personnel, de leurs questionnements intimes sur leur mission, sur leur vie. Chacun à sa manière, ils ont nourri l'œuvre de Shœndœrffer.
C'est pour moi un film émouvant. Il ne s' agit pas ici de polémiquer sur la guerre mais de porter un regard, mais pas un jugement, sur les hommes de tout grade qui l'ont faite, de l'engagement de ces soldats perdus, de leur courage, de leur abnégation, de leur obligation d'obéir aux ordres face à leur conscience, valeurs aujourd'hui contestées, et même regardées comme désuètes dans une société sans boussole. L'auteur porte témoignage de ces conflits décriés, volontairement oubliés et parfois même injustement rejetés par la communauté nationale, de ces soldats oubliés.
© Hervé GAUTIER - n° 562 – Mars 2012
Un magistrat en guerre contre le nazisme - D TANTIN
1939–1945 Delphin DEBENEST, Un magistrat en guerre contre le nazisme - Dominique Tantin – Geste Editions.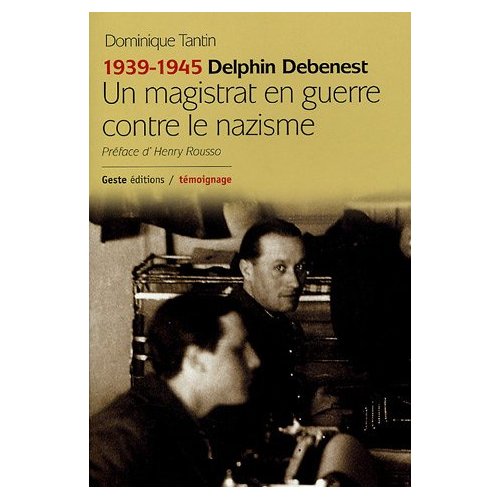
Lorsqu'il m'arrivait d'aller « Aux Iles » d'Echiré, cette splendide demeure qui donne sur la Sèvre et qui fut naguère la maison d'un poète, j'y entendais évoquer Ernest Perrochon par la bouche de sa fille. Elle entretenait vivant le souvenir de ce père, écrivain et Prix Goncourt 1920, qui avait, entre autre, refusé de cautionner le régime de Vichy et avait fini par succomber aux harcèlements de l'occupant.
J'y rencontrais aussi son gendre, Delphin Debenest, qui s'occupait plus volontiers de son jardin. Il était cet homme tranquille qui ne parlait jamais de lui, souhaitait rester simple et donner l'image d'un retraité. Comme tout le monde, je savais qu'il avait été magistrat, que sa carrière, commencée à Niort comme substitut, avait été interrompue par la guerre, pour se terminer comme Président de chambre à la cour d'appel de Paris. C'était à peu près tout, et pour tous, il était un citoyen comme les autres... Il était pourtant bien plus que cela et sa frêle silhouette cachait un parcours hors du commun.
Mobilisé en 1939 comme homme du rang, il tiendra un journal de cette « drôle de guerre », décrivant la débâcle de l'armée, dénonçant l'attitude désastreuse du commandement, la défection des officiers... Il y a beaucoup de lucidité dans ses propos. Après sa démobilisation, en 1941, il retrouve ses fonctions de substitut dans une France vaincue et occupée et s'engage dans la Résistance. Il sera un agent de renseignements de la résistance franco-belge, communiquant des informations d'ordre administratives aux réseaux de la Vienne et des Deux-Sèvres, profitant de ses fonctions de magistrat en place pour combattre un régime qu'il désapprouvait mais dont il était pourtant le représentant, permettant à de nombreux Français, traqués par la police française et par la Gestapo, de leur échapper, disqualifiant des délits pour permettre aux prévenus d'échapper à la justice et de fuir ... C'est qu'un dilemme important se posait à lui. Il se mettait ainsi hors la loi, lui qui était censé l'incarner, alors qu'humaniste convaincu, il était animé d'une « certaine idée des droits de l'homme » et que, chrétien fervent, il puisait dans l'Évangile les raisons de son engagement et de son action. Il sut faire un choix qui n'était pas sans grandeur, entre l'accomplissement de son travail, et donc courir le risque de se faire à lui-même des reproches, et pratiquer la désobéissance civique et ainsi mettre sa vie et celle de sa famille en danger. Resté en poste, il rendit à la Résistance plus de services que s'il avait choisi la clandestinité ou le maquis. Ils furent en effet peu nombreux, les membres de la magistrature qui, à cette époque, acceptèrent cette « dissidence ».
Arrêté en juillet 1944, il est déporté à Buchenvald puis au commando d'Holzen d'où il s'échappe, profitant de la débandade des nazis. Choisi pour faire partie de la délégation au procès de Nuremberg en qualité de procureur adjoint, il aura le privilège « d'être le juge de ses bourreaux ».
Pendant toute cette période il prend des notes « au jour le jour » qui montrent le quotidien dans ce camp de concentration où tout devient banal, la faim, la souffrance, la mort ! Plus tard, lors du procès, il sera plus précis dans la relation qu'il en fait, plus critique aussi au regard des arguments développés par la défense, sans cependant se départir de son humanité et soucieux de ne pas obtenir vengeance à tout prix mais qu'une justice équitable soit rendue.
De retour en France, il devint un militant de la mémoire pour que tout cela ne se reproduise plus.
Il s'agit d'un témoignage écrit, non destiné à la publication, uniquement appelé à garder pour lui seul, le souvenir personnel de toute cette période dont « il veut (en) conserver seul le souvenir et aussi les traces ineffaçables » et « ne pas attirer l'attention sur lui ». Le lecteur y rencontre un narrateur qui veut, dans le camp, garder sa dignité et conserver intacte sa foi en la vie et en l'espoir de rentrer chez lui. On songe bien sûr à Jorge Semprun. Il continuera, pendant toute cette période, de transcrire pour lui-même, ses impressions et ses remarques, sous forme d'un simple témoignage. En fait, c'est beaucoup plus que cela, et il ne se fait aucune illusion sur l'intérêt que pourront montrer ses contemporains, et encore moins de la compassion qu'ils pourront éprouver.
Sur son action de Résistant, il reste discret et se qualifie lui-même de « modeste agent de renseignements d'un réseau » dont « l'action n'eut rien de spectaculaire ».
Ces écrits n'ont été exhumés après sa mort survenue en 1997, que grâce à la complicité de sa famille et publiés en marge d'un travail universitaire de Dominique Tantin dans le cadre de la soutenance d'une thèse de doctorat. Ce travail reste pédagogique puisque les écrits de Delphin Debenest ont été scrupuleusement retranscrits, annotés de commentaires et enrichis de citation d'historiens. Son histoire individuelle rejoint donc l'Histoire.
Pourtant, la mémoire collective n'a pas conservé le souvenir de cet « authentique résistant » qui regardait sa période de sa vie comme « malheureuse aventure » qu'il souhaitait oublier. Il avait seulement fait son devoir, c'est à dire agi conformément à sa conscience et son destin fut exceptionnel. De ce parcours, nulle trace officielle, simplement des décorations prestigieuses simplement rangées de son vivant et qui attestaient cet engagement. Il eut même la désagréable occasion de constater que sa carrière eut à pâtir de son action patriotique et que d'autres collègues, moins soucieux que lui de leur devoir et plus attentifs à leurs intérêts personnels, ont su tirer partie des événements à leur profit. C'est là un autre débat sur l'opportunisme et l'ingratitude.
Il faut remercier Dominique Tantin d'avoir ainsi mis en lumière la mémoire de cet homme d'exception que sa modestie rendait plus grand encore.
sous forme d'un simple témoignage. En fait, c'est beaucoup plus que cela, et il ne se fait aucune illusion sur l'intérêt que pourront montrer ses contemporains, et encore moins de la compassion qu'ils pourront éprouver.
Sur son action de Résistant, il reste discret et se qualifie lui-même de « modeste agent de renseignements d'un réseau » dont « l'action n'eut rien de spectaculaire ».
Ces écrits n'ont été exhumés après sa mort survenue en 1997, que grâce à la complicité de sa famille et publiés en marge d'un travail universitaire de Dominique Tantin dans le cadre de la soutenance d'une thèse de doctorat. Ce travail reste pédagogique puisque les écrits de Delphin Debenest ont été scrupuleusement retranscrits, annotés de commentaires et enrichis de citation d'historiens. Son histoire individuelle rejoint donc l'Histoire.
Pourtant, la mémoire collective n'a pas conservé le souvenir de cet « authentique résistant » qui regardait sa période de sa vie comme « malheureuse aventure » qu'il souhaitait oublier. Il avait seulement fait son devoir, c'est à dire agi conformément à sa conscience et son destin fut exceptionnel. De ce parcours, nulle trace officielle, simplement des décorations prestigieuses simplement rangées de son vivant et qui attestaient cet engagement. Il eut même la désagréable occasion de constater que sa carrière eut à pâtir de son action patriotique et que d'autres collègues, moins soucieux que lui de leur devoir et plus attentifs à leurs intérêts personnels, ont su tirer partie des événements à leur profit. C'est là un autre débat sur l'opportunisme et l'ingratitude.
Il faut remercier Dominique Tantin d'avoir ainsi mis en lumière la mémoire de cet homme d'exception que sa modestie rendait plus grand encore.
Hervé GAUTIER - n° 323 – Février 2009
Les Enfants du Marais Un film de Jean BECKER (1999)
Il est des films qui s'inscrivent dans notre mémoire à cause des distinctions qu'ils reçoivent, de la notoriété qu'ils obtiennent grâce à la médiatisation au moment de leur sortie en salles, de l'histoire qu'ils évoquent, des acteurs qui servent leur scénario, des paysages qu'ils offrent...Il en est d'autres, au contraire, dont nous nous souvenons avec précision sans trop savoir pourquoi, peut-être parce qu'ils nous ressemblent et évoquent une partie de notre parcours. « les enfants du marais » est de ceux-là.
 Pourtant, il raconte une histoire bien banale, celle d'une rencontre de deux hommes devenus amis presque par hasard. Garris[Jacques Gamblin], un homme encore jeune, sans famille, sans attache ni fortune qui revient de cette grande boucherie de 14-18 qui l'a profondément marqué. Il croise un vieil homme[Jacques Dufilho] qui habite dans une pauvre masure près d'un étang en Bourgogne et qui l'y invite. Rapidement, il meurt en lui laissant tout ce qu'il possède, cette cabane en planches et quelques lignes pour la pêche à la grenouille. Il s'installe donc ici et rencontre Riton [Jacques Villeret] qui vit ici depuis toujours avec sa deuxième femme et ses trois enfants. Autant le premier est généreux et courageux, autant le second est paresseux, roublard et alcoolique. Garris l'entraine pourtant à travailler pour survivre. Une véritable amitié nait entre eux et ensemble, ils se font, au rythme de l'année, chanteurs de rues, marchands d'un peu de tout, fournisseurs de grenouilles ou d'escargots pour les restaurants de la ville d'à côté. Après tout, ils ne possèdent que leur vie dans ce coin de France où l'eau et la terre se conjuguent, qui ressemble à un paradis à l'écart de la ville et où la liberté semble être la règle. Pourtant, ils ne sont pas à la charge d'une société en marge de laquelle ils vivent volontiers « On est des gagne-misère, mais on n'est pas des peigne-culs »!
Pourtant, il raconte une histoire bien banale, celle d'une rencontre de deux hommes devenus amis presque par hasard. Garris[Jacques Gamblin], un homme encore jeune, sans famille, sans attache ni fortune qui revient de cette grande boucherie de 14-18 qui l'a profondément marqué. Il croise un vieil homme[Jacques Dufilho] qui habite dans une pauvre masure près d'un étang en Bourgogne et qui l'y invite. Rapidement, il meurt en lui laissant tout ce qu'il possède, cette cabane en planches et quelques lignes pour la pêche à la grenouille. Il s'installe donc ici et rencontre Riton [Jacques Villeret] qui vit ici depuis toujours avec sa deuxième femme et ses trois enfants. Autant le premier est généreux et courageux, autant le second est paresseux, roublard et alcoolique. Garris l'entraine pourtant à travailler pour survivre. Une véritable amitié nait entre eux et ensemble, ils se font, au rythme de l'année, chanteurs de rues, marchands d'un peu de tout, fournisseurs de grenouilles ou d'escargots pour les restaurants de la ville d'à côté. Après tout, ils ne possèdent que leur vie dans ce coin de France où l'eau et la terre se conjuguent, qui ressemble à un paradis à l'écart de la ville et où la liberté semble être la règle. Pourtant, ils ne sont pas à la charge d'une société en marge de laquelle ils vivent volontiers « On est des gagne-misère, mais on n'est pas des peigne-culs »!
Cette amitié est partagée avec Amédée [André Dussolier], sorte d'intellectuel féru de lecture et de musique, sympathique et oisif mais qui épouse parfaitement ce mode de vie tout en différence. Elle l'est aussi par un veuf illettré, Hyacinthe Richard, dit « Pépé la Rainette » [Michel Serrault] qui a jadis habité au bord de cet étang et à qui la vie a souri. De ramasseur de ferraille il est devenu un riche patron de fonderie ce qui lui a permis de devenir notable et de marier sa fille à un arriviste qui le l'aime guère. Sa famille devenue bourgeoise et méprisante lui interdit de revenir au marais, mais il brave volontiers cette défense, ce qui lui sera fatal.
Eric Cantona signe ici avec talent un rôle de boxeur à sa mesure, victime lui aussi des femmes autant que de son caractère impulsif. Il complète avec bonheur ce panel de comédiens d'exception.
Il n'y a pas que cette connivence entre eux. Riton se remet mal du départ de sa première femme, Paméla, et Garris croisera le regard claire de Marie, domestique dans une grande maison. Il apprendra à ses dépens que ses amours ancillaires seront contrariées et que celle qu'il aimait a suivi dans le sud un homme plus âgé qu'elle, plus riche aussi sans doute parce qu'il représente sa sécurité et son avenir.
La morale de ce film tient en ces quelques mots de la conteuse qui illustrent bien ce qu'est la condition humaine "Il y a des moments dans la vie où l'on voudrait que rien ne change jamais plus".
Il est cependant un personnage qui m'interpelle, celui qu'incarne le regretté Jacques Villeret [1951-2005]. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans cette chronique (La Feuille Volante n° 157) tout le bien que je pensais de cet acteur emblématique, à la filmographie prestigieuse, au palmarès impressionnant, notamment oscar du meilleur second rôle en 1999 pour « Le dîner de cons », dont le talent se déclinait au théâtre comme au cinéma, disparu trop tôt à près de 54 ans, à la fois discret et représentatif du « Français moyen », gentil, rondouillard, raciste, maladroit, froussard, naïf et souffre-douleur des autres. Jamais vraiment star et même plutôt discret, il était l'archétype de l'acteur populaire et son apparition sur les écrans, même dans un rôle secondaire, était toujours pour le public un gage de qualité.
Gamblin, Dussolier et Villeret forment ensemble dans ce film à la fois drôle, poétique et profondémlent humain, un trio amical, émouvant et complice.
© Hervé GAUTIER - n° 552 – Février 2012
Valentine Pacquault Gaston CHERAU (Plon, 1921)
Pas très chanceux François Pacquault ! Orphelin de père de bonne heure, c'est à la mort de sa mère, âgée de 27 ans qu'il fut confié, encore enfant, au « ménage » de trois vieille filles, Solange, Célina et Amélie Carignan qui tenaient un pensionnat à Argenton (Creuse). C'est dans ce gynécée un peu étouffant de province que François, leur neveu, va vivre jusqu'à son baccalauréat parce que c'est tout ce qui lui restait de sa famille. Elles l'ont littéralement couvé mais arrive le temps de son service militaire qu'il doit accomplir, pendant 3 ans, à Saint-Léger, une ville de garnison dans le département des Deux-Sèvres. Mais les choses se précipitent et, à cause de la banqueroute frauduleuse d'un notaire d'Argenton, les demoiselles Carignan doivent réduire leur train de vie... et marier François au plus vite, de préférence à un beau parti. Leur choix se porte sur Valentine Delpérrier, ancienne pensionnaire de l'établissement Carignan et François en tombe tout naturellement amoureux. Les voilà donc mariés et lui affecté, comme 2° classe dans ce régiment d'infanterie.
Amélie Carignan qui tenaient un pensionnat à Argenton (Creuse). C'est dans ce gynécée un peu étouffant de province que François, leur neveu, va vivre jusqu'à son baccalauréat parce que c'est tout ce qui lui restait de sa famille. Elles l'ont littéralement couvé mais arrive le temps de son service militaire qu'il doit accomplir, pendant 3 ans, à Saint-Léger, une ville de garnison dans le département des Deux-Sèvres. Mais les choses se précipitent et, à cause de la banqueroute frauduleuse d'un notaire d'Argenton, les demoiselles Carignan doivent réduire leur train de vie... et marier François au plus vite, de préférence à un beau parti. Leur choix se porte sur Valentine Delpérrier, ancienne pensionnaire de l'établissement Carignan et François en tombe tout naturellement amoureux. Les voilà donc mariés et lui affecté, comme 2° classe dans ce régiment d'infanterie.
Sitôt arrivée dans cette ville de province, Valentine qui déjà s'y ennuyait, veut faire la grande dame, dépense sans compter, veut être entourée d'officiers, être la reine des fêtes qu'on donne, des bals de garnison où elle se rend seule, à cause du grade de son mari. De son côté, François qui manifeste peu de goût pour la vie militaire doit se tenir en retrait des plaisirs de son épouse, est cependant en butte aux critiques et aux moqueries des hommes du rang dont il fait partie. Sans peut-être que François s'en rende compte, le fossé se creuse entre Valentine et lui, sa jalousie s'installe, durable. De son côté, Valentine se laisse entrainée dans une passade amoureuse dévastatrice avec le lieutenant Tassard, un compatriote de la Creuse, un rustre qui pourtant séduira Valentine et détruira son ménage. Elle ne l'aime pas mais c'est lui qui lui fait découvrir ce qu'elle ne connaissait pas avec son mari : le plaisir des sens ! Elle souhaite donner le change pour le monde extérieur mais c'est vers lui qu'elle se sent attirée, c'est lui qui lui permet de se révéler comme une femme sensuelle qui aimait les hommes et l'amour, une femme mariée qui aimait « avoir un amant »... pour son malheur ! Cette liaison donne l'occasion à l'auteur de se livrer à une analyse psychologique très fine des personnages. Il se révèle encore une fois comme « le brillant analyste de l'âme féminine ». L'indélicatesse du notaire, la mort de son mari, le départ de Tassard la précipitent dans la la précarité, la solitude et la prostitution.
Valentine Pacquault est un roman majeur dans l'œuvre de Chérau, un roman dur aussi, axé sur cette femme gourmande de vie, amoureuse éperdue de son amant, une sotte qui voulait s'élever dans l'échelle sociale, dût-elle pour cela détruire tout ce qui était bien autour d' elle , une égoïste détachée de François qu'elle n'aime plus et qu'elle considère presque comme son ennemi personnel. C'est un peu comme si elle voulait lui faire payer ces années de réclusion à la pension Carignan, sa jeunesse sacrifiée... François est quant à lui un peu naïf, niais, comme un enfant, peu préparé à ce mariage trop hâtif, mais surtout follement amoureux de son épouse pour qui rien n'est trop beau. Il ne voit rien de son propre malheur et submergé par la peine né de la trahison de Valentine ne trouve son salut que dans la mort. Son épouse, veuve à 22 ans l'oubliera vite, quêtera une consolation passagère et inefficace dans la religion, mais ce qu'elle recherchera surtout ce sera une relation avec les hommes qui pourrait lui procurer une forme de réussite sociale.
Il y a un personnage qui retient mon attention : c'est le capitaine de Millau. Il est à la fois protecteur du couple et paternel, un peu marginal, humain, philosophe, solitaire et érudit sous des apparences peu flatteuses... Il a beaucoup d'amitié pour François. Au fil des pages son portrait s'affine pour donner de lui, à la fin, sa véritable image. C'est par son entremise que François échappe à l'opprobre du suicide et peut être enterré en terre consacrée, c'est aussi grâce à lui, et malgré l'énorme différence d'âge, que Valentine reprend pied dans la vie quand les portes de Saint-Léger se referment devant elle, c'est aussi lui qui, bravant la morale et aussi sa propre conception des choses, l'arrache à la mort.
Le style de Chérau, ce sont des analyses pertinentes de ses personnages, des évocations agréablement poétiques, un zeste d'humour, une phrase toujours sobre et précise, finement ciselée et agréable à l'oreille, une musique....
J'ai vraiment pris plaisir à relire ce roman passionnant du début à la fin et qui évoque « Mme Bovary ». Il y a beaucoup de « parentés » entre ce roman et celui de Gustave Flaubert à commencer sans doute par l'analyse psychologique des personnages menée par l'auteur. Valentine est peut-être plus inhumaine qu'Emma, mais toutes les deux sont romantiques et s'ennuient dans cette province reculée. Elles ne trouvent leur salut que dans la relation avec un amant. Valentine, comme Emma, aime s'étourdir dans les soirées[ le bal du colonel ressemble à la réception chez le marquis dela Vaubyessard], toutes le deux ont épousé un mari falot qui est pourtant éperdument amoureux de sa femme et dans les deux ouvrages il y a un suicide [à celui d'Emma répond celui de François et Valentine y songe sans pouvoir le faire]. Le médecin-major du régiment s'exprime un peu comme Homais, mais le bon capitaine de Millaud assure par son humanité et l'amour qu'il porte à Valentine, une fin sinon heureuse, à tout le moins apaisée à cette triste histoire.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire dans cette chronique [la Feuille Volanten° 280-282-457], Chérau [1872-1937] reste malheureusement de nos jours un écrivain méconnu et injustement oublié, même dans sa ville natale.
© Hervé GAUTIER
La Feuille volante n° 549 - Décembre 2011
L'île des chasseurs d'oiseaux (Peter MAY Rouergue NOIR)
Le décor est celui de l'île Lewis au nord de l'Écosse. C'est l'île natale de l'inspecteur Fin Macleod qu'il a quittée voilà bien des années. Il fallait bien faire quelque chose, entrer dans la vie active puisqu'il avait abandonné ses études et était sans diplôme. Alors la police, pourquoi pas ? Il avait donc été affecté à Edimbourg et y poursuivait sa carrière. Il se serait bien passé de ce retour au pays mais l'ordinateur ou le hasard l'ont désigné pour cette mission à cause des similitudes entre un meurtre qui s'était déroulé sur cette île et une affaire dont il s'était occupé antérieurement à Edimbourg. Mais c'est un autre monde que cette contrée perdue entre un ciel plombé et un décor lunaire. Il est fait de landes battues par les vents et les embruns, on s'y chauffe à la tourbe, on y pratique le sabbat chrétien, on y parle encore le gaélique et les pubs sont la seule distraction... Pas la seule cependant car il existe une coutume barbare qui consiste à escalader des falaises d'un caillou perdu au large pour y tuer des poussins de fous de Bassan qui y nichent... C'est une tradition, une sorte de rite de passage, unique et incontournable, surtout pour les jeunes. 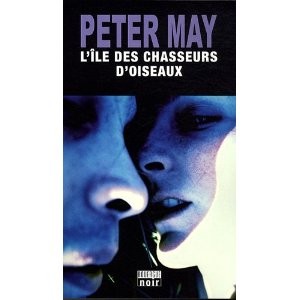
Oui, il s'en serait bien passé et pas seulement pour ce triste décor. Il vient, dans un accident de la circulation de perdre son fis unique, Robbie, ce qui fait de lui un être définitivement à part. On ne se remet jamais d'une telle épreuve, entre silence et larmes, révolte et culpabilité, regrets et absence... Et chacun l'évite par respect, par crainte d'évoquer cette épreuve, par incompréhension, par volonté de se protéger d'un malheur qui peut arriver à chacun d'entre nous. Cela fait de lui un homme seul, tenté peut-être de rejoindre dans la mort ce fils qu'il ne reverra plus. Parce que, même si une vie qui lui est chère s'est arrêtée, la sienne poursuit son cours. Elle est devenue soudain un fardeau plus lourd chaque jour, un chemin de croix au quotidien. Face à cela, il y le deuil qu'on vit toujours seul et qu'on ne fait jamais complètement, les cautères qu'on invente pour nous aider à supporter le quotidien maintenant hanté par le fantôme d'un enfant qu'on ne verra pas vieillir, qui n'aura pas lui-même d'enfants. Le travail est l'un d'eux. Il permet de penser à autre chose, de s'occuper un peu l'esprit, de faire semblant, même si cela n'est et ne sera jamais qu'un décor fragile, une sorte de château de cartes édifié dans un courant d'air... Il part donc pour son île malgré son chagrin, l'attitude compassée de ses collègues et son épouse, Monna, qui lui déclare que s'il part, elle ne sera plus là à son retour...
Fin revient aussi sur les traces de son enfance. Il y retrouve évidemment ceux qui étaient ses copains alors, ceux qui sont restés au pays. Au premier de ceux-ci, Ange, le chef d'une bande dont le policier a fait jadis partie. C'est lui qui a été assassiné selon le même « modus operandi » que dans l'affaire dont l'inspecteur s'est occupé à Edimbourg. Cet Ange était un homme tyrannique, cruel, alcoolique, dealer, magouilleur, bagarreur et même fortement soupçonné de viol et convaincu d'avoir agressé un défenseur des oiseaux... Il ne manquait pas d'ennemis qui voulaient sa mort, mais pourtant, il pouvait être attachant, amical... Et c'est lui, Fin, qui est chargé de retrouver son assassin, c'est lui qui est à la fois un enfant du pays mais aussi un policier, le représentant de l'ordre, qui devra dénouer les fils de cette histoire compliquée, percer les secrets qui unissent ces gens qu'il connait. Dans ce coin perdu des Hébrides, il va aller, un peu malgré lui, au devant des souvenirs personnels et pas toujours bons qu'il a avec chacun. En quittant l'île, il avait choisi de les oublier et avec eux son cortège de regrets, de remords... A l'occasion de cette enquête, c'est aussi son passé, la mort accidentelle de ses parents qui lui reviennent en pleine figure ! Tout cela ne va pas faciliter son enquête d'autant que ceux qu'il interroge ont déjà déposé auprès de la police locale.
Il retrouve tous ses copains mais surtout Artair dont le père, M. Maccines, a perdu la vie en sauvant celle de Fin lors d'une expédition contre les oiseaux. Il a épousé Marsaili, le premier amour de Fin, celui qu'on n'oublie pas. Il la rencontre à nouveau, se demande si elle pense encore à lui, fait connaissance de son fils qui porte le même prénom que lui, sympathise avec lui, refait à l'envers un chemin qu'il croyait définitivement oublié, se demande dans son for intérieur si ce garçon n'a pas quelque chose de lui, une parenté jusque là inconnue... Cela aussi risque de bouleverser les choses établies depuis tant d'années... Mais le temps a passé, les choses se sont figées dans un quotidien apparemment immuable, irréversible, violent aussi... Cette enquête remettra en cause bien des vérités établies, bien des certitudes et il faudra que Fin accepte d'entendre et d'admettre ce qui n'était pas pour lui des évidences, qu'il aille au devant de lui-même, assume ses souvenirs personnels, ses attachements, ses certitudes... Pourtant, iI n'est pas venu là par hasard mais est victime d'un règlement de compte personnel, manipulé par le tueur qui s'apprêtait à nouveau à tuer...
Il est bien des gens pour affirmer que la littérature policière tient un rang mineur dans la création littéraire qu'on écrirait volontiers avec une majuscule. Pourtant si le roman policier plait, c'est sans doute parce qu'il endosse un tas de fantasmes et de tabous humains. L'écriture en est parfois moins étudiée, moins ciselée, plus populaire, on y met souvent du sexe, de la violence, du sang, probablement pour marquer la différence avec des fictions plus intellectuelles... J'ai toujours pensé que, plus que d'autres forme d'arts peut-être, la fiction policière nous rappelle que nous sommes mortels, que les hommes ne sont ni aussi bons ni aussi humains que des générations de philosophes ont tenté de nous le faire croire. Elle est, au moins autant que les autres, et malgré le fait qu'on la relègue volontiers au rang de lecture estivale, le miroir de la condition humaine.
Dans un style agréable à lire, plein d'émotions et d'évocations de ce coin de terre un peu perdu et désolé, l'auteur, malgré de nombreuses digressions, retient l'attention de son lecteur jusqu'à la fin, avec un sens consommé du suspense.
Ce roman a été pour moi un bon moment de lecture.
Traduit de l'anglais par Jean-René Dastugue.
Prix des lecteurs Cezam Poitou-Charentes 2011
La Feuille volante n°511 – Mars 2011.
©Hervé GAUTIER
Meurtres sur le fleuve jaune - Frédéric LENORMAND (Fayard)
Les nouvelles enquêtes du juge TI.
Scène ordinaire à la cour des Tang. Dame Wu, la toute puissante impératrice, vient de signer l'arrêt de mort d'un homme. Malgré les tortures, le condamné n'a pas donné le nom de ses complices et surtout celui de ses chefs qu'on soupçonne être des courtisans, toujours volontiers comploteurs et corrompus. Pour déjouer les tentatives d'insurrection, il faut quelqu'un capable d'efficacité autant que d'une fidélité sans faille au Fils du Ciel. C'est ainsi qu'entre en scène un jeune et obscur sous-Préfet en poste dans la petite ville de Peng-Lai, à l'embouchure du Fleuve Jaune. Son nom: Ti Jen-tsié.
Voilà donc notre magistrat convoqué dans la capitale. Mais il craint le pire puisqu'il vient de démanteler, dans un monastère bouddhiste, un trafic d'or préjudiciable aux finances de l'État. Il s'attend en effet à devoir se justifier devant un empereur sans véritable autorité et à répondre de son zèle face aux religieux très influents à la cour. Ce voyage en bateau sur le fleuve Jaune qui le mènera jusqu'à la capitale, a donc pour Ti des accents d'humiliation. Il ne tarde pas cependant à s'apercevoir que ses craintes sont infondées et à peine embarqué, il reçoit, en grand secret, l'ordre d'assurer la sécurité d'un témoin, le mystérieux Lai Junchen, instamment attendu à " la Cité interdite ", sans qu'on ait pris la peine de le lui désigner parmi les passagers. Jusqu'à la fin, il restera insaisissable. Dans le même temps, des crimes et tentatives d'assassinats sont perpétrés autour de lui et parfois contre lui-même, transformant en périlleux parcours ce qui aurait dû être un paisible voyage, le fleuve Jaune méritant une nouvelle fois son surnom de " Chemin des enfers ". Du coup, notre magistrat, désireux de faire régner l'ordre dont il est garant, rompt l'anonymat dont il entourait sa personne pour reprendre ses habits de mandarin. Dès lors la jonque, ou plus exactement les jonques sur lesquelles il accomplit son périple mouvementé, deviennent un microcosme, une société en raccourci qui ressemble à celle de sa circonscription. Il doit y étendre son autorité et mener son enquête. Ti est un intellectuel, un lettré que ses fonctions mettent cependant en situation de côtoyer l'espèce humaine la plus dépravée, assassins, voleurs, délinquants, membres de sociétés secrètes qu'il a soin de combattre et de démasquer avec autant de finesse que d'efficacité. Il se révèle, comme toujours, non seulement un fin limier mais aussi un habile négociateur qui obtient ce qu'il désire. Ses investigations sont pour lui l'occasion de porter sur ses contemporains un regard critique. Tout pétri de confucianisme ainsi qu'il sied à un haut-fonctionnaire de l'Empire, il ne manque jamais de se laisser aller à des remarques parfois acerbes en direction des religieux, bouddhistes et taoïstes. Il n'en est cependant pas moins homme et n'est pas insensible à la vision fugace et fragile des femmes qu'il croise. Les femmes justement lui réserveront au cours de cette traversée de bien curieuses surprises !
Comme souvent dans cette série consacrée à Ti, l'eau revient sous la forme de thème récurrent [" Le château du lac Tchou-An ", " Le mystère du jardin chinois "].
Comme je l'ai tant de fois dit dans cette chronique, j'aime lire Frédérique Lenormand. J'apprécie son humour alternativement subtil, caustique et jubilatoire qui doit beaucoup à l'euphémisme, la façon qu'il a de dépayser son lecteur, le plongeant dans cet univers inconnu de la Chine, non seulement grâce à des descriptions poétiques mais aussi à des apostilles culinaires, culturelles ou religieuses.
Le récit est divisé en courts chapitres introduits par quelques mots qui les résument, la phrase est agréable et le suspense entier. J'ajoute une chose que je considère essentielle chez un écrivain. En effet, Lenormand a cette faculté d'intéresser son lecteur dès la première ligne d'un livre et de ne l'abandonner qu'à la fin sans que l'ennui s'insinue dans sa lecture.
Qu'il mette en scène le XVIII° siècle dont il est un éminent spécialiste, qu'il nous parle de Voltaire pour qui il a une tendresse particulière ou qu'il nous fasse profiter avec bonheur des aventures réelles du Juge Ti dont il s'approprie la personne et à qui il prête, le temps d'un récit, ses remarques personnelles, la lecture d'un roman de notre auteur est toujours pour moi un grand moment de plaisir.
N° 544 – Novembre 2011.
©Hervé GAUTIER
Le cadavre anglais Jean-François PAROT JC LATTES
Nous sommes à Paris en 1777, sous le règne de Louis XVI, pendant la période du carnaval. Le temps froid et la neige n'avaient, malgré tout, pas empêché le commissaire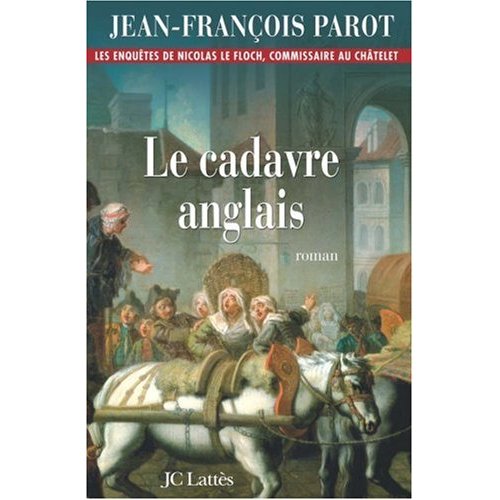 Nicolas Le Floch, Marquis de Ranreuil, de quitter, par hasard, sa permanence du Châtelet pour faire quelques pas à proximité de la prison de Fort-L'évêque où il avait trouvé la rue étrangement sombre et croisé un personnage énigmatique. Un prisonnier dont nul, même le directeur de l'établissement, ne savait rien, venait de se tuer en tentant de s'évader de cette geôle où il était emprisonné sur lettre de cachet. Les investigations du commissaire révélèrent rapidement que la victime n'était guère un quidam, qu'il avait en réalité été achevé d'un coup d'épée après une chute qui l'avait assommé et qu'il pouvait bien être anglais ! Voilà donc notre Marquis une nouvelle fois confronté à une énigme sur fond de combats pour l'indépendance américaine que soutient la couronne de France... et de fuite un peu précipitée du gouverneur de la prison !
Nicolas Le Floch, Marquis de Ranreuil, de quitter, par hasard, sa permanence du Châtelet pour faire quelques pas à proximité de la prison de Fort-L'évêque où il avait trouvé la rue étrangement sombre et croisé un personnage énigmatique. Un prisonnier dont nul, même le directeur de l'établissement, ne savait rien, venait de se tuer en tentant de s'évader de cette geôle où il était emprisonné sur lettre de cachet. Les investigations du commissaire révélèrent rapidement que la victime n'était guère un quidam, qu'il avait en réalité été achevé d'un coup d'épée après une chute qui l'avait assommé et qu'il pouvait bien être anglais ! Voilà donc notre Marquis une nouvelle fois confronté à une énigme sur fond de combats pour l'indépendance américaine que soutient la couronne de France... et de fuite un peu précipitée du gouverneur de la prison !
Cette affaire s'égare un peu avec pour décor les dettes de Marie-Antoinette, un cadeau original fait à la reine et qui est en réalité un objet volé dans un cabinet de curiosités de Frédéric, roi de Prusse, les intrigues de Cour, un phénomène atmosphérique à la fois bizarre et extraordinaire, le passé parfois tumultueux du commissaire... De dissimulations de cadavre en assassinat de témoin, de signature contrefaite en recherche d'un bouton d'uniforme perdu puis retrouvé, notre commissaire n'a pas trop de son adjoint et de ses traditionnels amis pour dénouer l'écheveau compliqué de cette affaire où se mêlent rebondissements et enlèvements. Au fur et à mesure du déroulement de ce roman, l'identité de cet Anglais mort semble une énigme de plus en plus indéchiffrable. Il y a aussi ce message sibyllin qu'il faut impérativement décrypter et cette histoire de montre et d'horloger qui pourrait bien ressembler à de l'espionnage industriel ou à une histoire d'agent-double... C'est que Sartine, alors ministre de la Marine souhaite faire résoudre l'épineux problème des longitudes qui permet de positionner correctement les navires en mer. En cela la France est bien entendu en concurrence avec l'Angleterre et les deux pays n'ont jamais entretenu de très bonnes relations ... Au bout du compte, le lecteur, tenu en haleine jusqu'à la fin par un sens consommé du suspense, verra que cet imbroglio se révèle petit à petit comme une affaire d'État où Éros danse avec Thanatos et où le mystère le dispute à la mystification.
Sous forme d'éphéméride, l' auteur nous conte par le menu le déroulement de cette histoire un peu rocambolesque qui aurait parfaitement pu passer inaperçue mais que le hasard et le dévouement à la Couronne du Marquis ont suffi à compliquer.
Je n'y peux rien, je suis amoureux du Siècle des Lumières et de Paris et j'apprécie d'avoir, dans chaque roman, des informations sur la vie de cette époque, qu'elles évoquent le potins, l 'histoire ou la vie des quartiers. J'aime aussi les expressions populaires, même si on ne les emploie plus aujourd'hui, les recettes de cuisine qui enrichissent le récit...
Encore une fois, ce roman a été un bon moment de lecture.
N°542 – Octobre 2011
© Hervé GAUTIER
La fête des pères - Hervé GAUTIER
Autant qu'il m'en souvienne, mon frère et moi aimions passionnément notre père. Mariés tard à cause de la guerre, nos parents avaient fait de nous des enfants de vieux.
Mon père travaillait " aux Chemins de Fer " et était responsable d'une petite gare de campagne. Comme beaucoup de cheminots de cette époque, son métier était toute sa vie. Elle était rythmée par les horaires des trains et ce d'autant plus que nous habitions sur place, dans la gare même. Je me souviens de notre terrain de jeu à mon frère et à moi. C'était l'unique voie de garage et la lampisterie puisque les quais de la voie principale nous étaient interdits. Ce n'était pas une grande gare. Mon père vendait les billets et signalait le passage des express qui ne s'arrêtaient jamais... On les voyait filer indifférents à notre petite station, vers une ville inconnue.
En fait, nous étions fascinés par les rails qui de chaque côté de la gare se perdaient dans un infini que nous avions du mal à imaginer. La plaine à cet endroit avait facilité la pose de voies parfaitement rectilignes. En été quand nous nous tournions alternativement vers le nord et vers le sud nous avions la même vision de deux lignes parfaitement droites et luisantes qui se rejoignaient dans un horizon indistinct, brouillé par la chaleur.
Il nous était interdit aussi de marcher le long des voies principales, le danger était trop grand. Nous le fîmes pourtant une fois au grand dam de notre mère, morte de peur.
Il nous semblait que cette petite gare de campagne, coincée entre deux horizons était le centre du monde, pourtant ce monde là n'était visité, le matin et le soir que par un omnibus qui desservait des gares analogues à la nôtre.
La multiplication des automobiles menaçait pourtant leur existence. Il y avait de moins en moins de gens dans la micheline aux couleurs passées qui annonçait son arrivée à grands coups de klaxon. A ce moment, mon père se transformait en guichetier, en aiguilleur, en garde-barrière et agitait son drapeau rouge pour faire partir l'autorail. Le sifflet et la casquette étaient ses attributs et cela faisait longtemps que les rares clients ne demandaient plus les horaires des trains. Il serrait la main du contrôleur et du mécanicien, échangeait quelques mots avec eux, aidait à charger ou à décharger quelques rares marchandises puis l'omnibus repartait. A ce moment seulement les passagers étaient autorisés à traverser les voies. Mais ils étaient de moins en moins nombreux. Puis mon père manœuvrait les aiguillages et tout redevenait calme... Ah, le poste d'aiguillage ! Il nous était interdit, bien sûr, mais quelle invitation au rêve et au voyage !
Parfois, en pleine nuit mon frère et moi nous penchions par la fenêtre de notre chambre pour regarder passer le train, l'express qui filait sans s'arrêter et dont on n'apercevait qu'un bref ruban de lumière souligné par un bruit rapide et sourd et par la vapeur blanche de la locomotive. C'était là le seul spectacle de nos nuits d'insomnie et l'invite au départ et au dépaysement était forte à ce moment là.
Notre univers à nous c'était seulement la plaque d'émail rouge et blanc de notre gare oubliée dans un coin de la campagne française, ces voies qui disparaissaient à l'horizon et dont nous ne voyions jamais le bout. Il nous arrivait parfois, avec notre mère de prendre, l'omnibus pour aller à la ville voisine, mais c'était tout. Le reste de l'année, c'était l'école du village et les vacances à la campagne...
Puis un jour on a fermé la gare. Elle n'était pas assez rentable, disait-on. On avait supprimé l'express de nuit et d'autres voies avaient été crées ailleurs pour des trains plus rapides. Parce qu'il avait travaillé assez longtemps notre père prit sa retraite et acheta dans le village même une maison qui devint notre nouveau foyer. Il aurait bien voulu acquérir la gare, mais c'était bien trop cher pour nous. Les bâtiments et les annexes restèrent longtemps vacants et finirent par être vendus.
Mon père devint un jeune retraité mais n'avait même plus pour se distraire les allées et venues des trains, comme jadis. Sans eux, il s'ennuyait et vieillissait chaque jour davantage. Chaque matin il allait jusqu'au passage à niveau et revenait bouleversé parce que la rouille mangeait les rails et que le ballast peu à peu se couvrait d'herbe. Il ne supportait pas que le Chemin de Fer ait disparu et que les voies soient restées en friche. Le passage à niveau lui-même ne servait plus et les longues barrières rouges et blanches à fanons métalliques avaient été enlevées.
Le village peu à peu se dépeuplait. Les plus anciens mourraient et on parlait de fermer l'école, comme au village voisin on avait déjà supprimé la petite perception. Il y avait encore une unique boîte aux lettres qu'un jeune facteur pressé venait, en voiture, vider de son contenu, une fois par jour. Même le vieux curé n'avait pas été remplacé, la crise des vocations disait-on, et l'unique cloche de l'église n'appelait plus à la messe, comme naguère. Il n'y avait que les enterrements pour que ses portes s'ouvrent, le temps d'une bénédiction, dirigée par un laïc... Seuls quelques commerçants faisaient encore leur tournée pour que le bourg ne meure pas complètement et l'unique café servait de dépôt d'épicerie, de bureau de tabac, de poste à essence...
- Quand le vieux Marcel fermera ses portes, ce sera la mort du village, prophétisait mon père.
Il ne restait plus que quelques vieux pour aller, autour d'un verre, jouer aux cartes et parler du passé.
Mon père tomba malade et sa surdité congénitale s'aggrava.
Mon frère et moi, à la descente du car qui nous ramenait du collège, avions chaque soir le spectacle d'un homme encore jeune, prostré sur le pas de sa porte, transformé en vieillard, qui somnolait et parfois soliloquait. Cela nous était d'autant plus désagréable que nous l'avions, peu d'années auparavant, connu comme un homme plein d'entrain et heureux de vivre. Malgré toute notre bonne volonté, nous ne pouvions rien faire pour lui. Parfois, dans son délire, revenait comme un symbole cette obsession de la rouille qui recouvrait "ses" rails. On eut dit que sa vie était partie avec son métier ! Il n'avait même plus la force de faire son jardin !
Alors, mon frère et moi eûmes une idée folle, comme toutes celles qui germent dans la tête des gamins. Pour rendre son sourire à ce jeune vieillard, nous imaginâmes de faire à nouveau passer le train chez nous devant les yeux de notre père, de faire comme avant, quand sa raison de vivre s'appelait "Indicateur des Chemins de Fer", aiguillages, horaires, correspondances ... Mais que peuvent deux enfants dans un village qui meurt contre des décisions prises ailleurs au nom de la rentabilité, de la productivité, de la gestion ? Pourtant notre volonté de rendre à papa son sourire était la plus forte et pour cela mon frère et moi aurions révolutionné le monde entier !
Son état empirait. Le médecin du village d'à côté passait de plus en plus souvent. Il prenait notre mère à part, lui parlait. Elle était de plus en plus soucieuse à propos de papa. On ne savait pas ce qu'il avait exactement et le docteur qui le connaissait bien, disait qu'il ne souffrait pas mais que son mal était de nature psychologique. Il essaya bien quelques médicaments nouveaux pour l'époque... Il y eut un léger mieux mais il ne fut que de courte durée. On eut dit qu'il luttait contre un mal inconnu mais que son combat était sans espoir. Il perdit même l'habitude des longues marches dans la campagne et des parties de pêche, comme au début. Maintenant, son vieux vélo se couvrait de poussière.
La fête des pères approchait. Nous avions toujours eu à cœur, mon frère et moi, de marquer ce jour par un geste parfois puéril mais par lequel nous lui disions, à notre manière, tout l'amour que nous lui portions. Nous bénéficiions bien sûr, de la complicité de notre mère comme celle de notre père nous était acquise à l'occasion de sa fête à elle. Ce jour là était simple, seulement marqué par un cadeau, simple lui aussi, mais c'était ainsi. Un paquet, un bouquet, un gâteau, un sourire, des embrassades, quelques mots tressés en poèmes... Cela suffisait à nos parents pour recevoir l'hommage de leurs enfants. Puis la journée se déroulait comme d'habitude, seulement marquée par un souvenir plus fort que les autres.
Cette année là, nous étions convenus que la maladie de papa ne devait pas assombrir cette journée presque estivale, qu'il fallait faire comme si le mal n'existait pas, comme si la vieillesse ne l'avait pas prématurément diminué... D'avance nous avions renoncé à la traditionnelle pipe accompagnée d'un paquet de tabac gris qui maintenant lui était interdit. Nous savions que son état empirait de jour en jour et parfois maman interrompait son travail pour pleurer. A notre retour de l'école, nous la trouvions parfois les yeux rougis, seule arme contre ce mal inexorable qui rongeait son mari.
A sa dernière visite, le médecin n'avait guère été encourageant et ma mère avait lu sur le visage de son époux une mort prochaine. Nous nous devions donc de célébrer cette fête des pères qui serait sans doute, pour lui la dernière. Nous nous interrogions sur le cadeau à offrir, un cadeau qui lui ferait tout particulièrement plaisir. C'est alors que mon frère et moi eûmes la même idée. Nous mîmes comme toujours notre mère dans la confidence. Elle accepta de nous aider avec cependant quelques réticences.
Ainsi nous absentions-nous de plus en plus le soir après l'école pour préparer ce cadeau uniquement fait pour lui. Notre idée, d'abord secrète s'était répandue dans tout le village et chacun se mit spontanément à nous aider pour que la fête soit complète et réussie. Tout le monde aimait notre père et avait à cœur que ce cadeau lui redonne vie et espoir.
Chacun nous aida de son mieux et le jour de sa fête, en plus du cadeau traditionnel, un voisin obligeant transporta notre pauvre père dans sa voiture jusqu'à l'ancien passage à niveau. Il n'y allait plus depuis de nombreux mois, devenu presque impotent. Il ne fut pas nécessaire d'écrire pour lui sur le carnet de conversation qu'il avait toujours à portée de sa main. Quand on réussit à l'extraire du véhicule, son visage s'éclaira d'un sourire aussi radieux que ce dimanche de printemps. Nous étions convenus que cette fête resterait familiale mais beaucoup vinrent observer de loin la joie de notre père...
Toute ma vie je me souviendrai de son sourire enfin retrouvé et de ses lèvres qui balbutiaient pour lui-même des mots indistincts. Il resta longtemps à observer l'horizon qui brasillait de chaleur. On eut dit que la santé lui était revenue.
On dut à grand peine le remonter dans la voiture... L'heure du repas approchait. On promit de le ramener.
La nuit suivante il mourut, mais ce fut une mort douce, presque naturelle et au matin il portait sur son visage une sorte d'apaisement.
Tout ce qui restait du village le conduisit en terre et le cortège fit un détour par le passage à niveau pour que symboliquement la cérémonie soit marquée par la dernière image qu'il avait dû emporter avec lui et qui avait adouci ses derniers moments.
On déposa quelques instants le cercueil sur les voies débarrassées de leur rouille. Tout le village nous avait aidés à frotter les rails, à désherber le ballast, à remonter les barrières, pour lui montrer que le train était revenu.
Hervé GAUTIER - Juillet 2011
Récit sélectionné par l'ATSCAF 79 pour participer au Prix ATSCAF de la Nouvelle 2011
« E nascondi i patin »
(Et cache les patins)
Paolo Conte – La nostagia del Mocambo
En écoutant une chanson italienne un peu nostalgique, il me revient un souvenir.
A l’époque de mon enfance, quand on pénétrait dans une maison où tout, même de sol, était ciré, il fallait prendre les patins !
Leur usage n’était pas obligatoire, mais était de bon ton.
A la porte de chaque pièce, sur le parquet brillant,
Il y avait, par paires, des morceaux de feutre ou de chiffe,
Souvent taillés en forme de « huit », qui attendaient le visiteur…
L’aspect du plancher et souvent l’odeur qui s’en dégageait évoquaient le confort et la propreté.
Ils étaient une invitation à laquelle la politesse, l’habitude ou le respect commandaient qu’on n’y résistât pas.
Alors, quel que soit l’état de ses semelles, on posait chaque pied sur un patin.
La marche se transformait ainsi en une sorte de pas glissé,
silencieux, inhabituel et incommode,
mais apprécié de la maîtresse de maison.
Le bruit des chaussures en était étouffé et,
par ce geste, l’hôte participait involontairement
à l’ambiance ouatée du lieu où il se trouvait.
Ils faisaient partie du décor, mais on les cachait parfois
quand l’invité était important, pour ne pas le froisser,
Comme si, soudain, ils n’avaient plus le même rôle…
Puis ils disparurent comme ils étaient venus… en silence !
Hervé GAUTIER
Juillet 2011
Poème présenté par l'ATSCAF 79 au Concours de Poésie ATSCAF 2011
La baronne meurt à cinq heures - F. LENORMAND - JC. LATTÈS
Pauvre Voltaire, en cet été 1731, voilà que meurt M. de Maison qui était son protecteur. Notre écrivain qui n'est jamais aussi bien chez lui que chez les autres, se met en quête d'un nouveau mécène qu'il trouve en la personne de la baronne Fontaine-Martel qui a le bon goût de l'héberger et de le nourrir pendant près de deux années. Las, cette dernière meurt sauvagement assassinée et aux yeux de René Herault, lieutenant général de police, Voltaire, philosophe controversé, fait figure de suspect idéal. Il va donc devoir se défendre en cherchant à qui profite le crime ! Pourtant, on imagine mal notre philosophe en auxiliaire de la maréchaussée, mais, ce défenseur du bon droit et de la liberté est surtout attentif à la sienne. Il va mener sa propre enquête non seulement parce qu'il ne souhaite pas retourner à la rue, et encore moins à la Bastille, mais aussi parce qu'il espère tirer quelque bénéfice des dernières volontés de la défunte. C'est donc à une chasse au testament plus ou moins falsifié qu'il va consacrer son temps et son énergie. L'estime qu'a de sa propre personne cet « empêcheur de penser en rond » l'amène à supposer qu'on en veut aussi à sa vie et ce d'autant plus qu'il est l'ennemi de tout ce qui porte soutane, jésuites et jansénistes.
Dans sa quête, il sera aidé brillamment par Mme du Châtelet, femme de sciences et d'esprit, délaissée par un mari qui préfère les champs de bataille, et présentement enceinte jusqu'aux oreilles. Ses qualités ne seront pas de trop pour affronter tous ces héritiers avides, ces abbés ridicules, ces spadassins aux mystérieux codes, ces assassins qui « connaissent la musique »... et pour tenir tête à cet écrivain, certes génial, mais un peu trop envahissant. Heureusement son intuition féminine prendra le pas sur la philosophie et nos deux limiers feront, à cette occasion, de surprenantes découvertes sur la nature humaine et sur l'hypocrisie qui va avec, la volonté de s'enrichir et les secrets d'alcôves !
Estimant qu'une enquête est quand même comparable à un raisonnement philosophique, et ne perdant pas de vue son intérêt personnel, notre homme mène donc des investigations attentives en même temps qu'une activité littéraire et mondaine en n'oubliant pas d'échapper à la censure et de lorgner vers l'Académie. Malheureusement pour lui, tout le monde prend « Ériphyle », la tragédie qu'il est en train d'écrire et dont il ne cesse de parler, pour une maladie de peau ! Mais, éternel valétudinaire à l'article de la mort malgré ses trente neuf ans, il n'omet pas non plus d'exploiter ceux qui ont l'imprudence de faire appel à ses qualités de comédien-usurier, ce qui, à ses yeux, n'est pas incompatible !
Je ne dirai jamais assez le plaisir que j'ai à lire Frédéric Lenormand [Cette chronique lui a déjà consacré de nombreux articles depuis quelques années]. J'aime son humour [J'ai beaucoup ri pendant ces trois cents pages], son érudition rigoureuse, sa maîtrise jubilatoire de la langue française, sa délicate pratique de la syntaxe, ses saillies aussi inattendues que pertinentes. Il est vrai que le sujet, Voltaire, dont il est un éminent spécialiste, s'y prête particulièrement. L'auteur des « Lettres philosophiques anglaises » avait déjà été mis en scène par Lenormand dans « La jeune fille et le philosophe » [La feuille volante n° 240]. L'auteur ne se contente pas d'être l'heureux chroniqueur des enquêtes du « juge Ti », il est aussi un grand connaisseur du XVIII° siècle. A ce titre, il promène son lecteur dans les rues de ce Paris hivernal qui n'est pas toujours celui des philosophes et y fait déambuler notre « propagateur d'idées impies » d'autant plus volontiers que sa liberté est en jeu.
Avec de courts chapitres au style alerte, annoncés d'une manière quasiment théâtrale, Lenormand s'attache l'attention de son lecteur dont il suscite l'intérêt dès la première ligne de ce roman sans que l'ennui s'insinue dans sa lecture. Il le régale de la silhouette de Voltaire autant que de son esprit et lui prête des propos et des attitudes que n'eût pas désavoués l'auteur de « Candide ».
Comme je l'ai souvent écrit, un roman de Frédéric Lenormand est pour moi un bon moment de lecture et, comme toujours... j'attends le prochain.
Prix Arsène Lupin 2011
Hervé GAUTIER
La Feuille Volante n°534 – Juillet 2011
Ni à vendre ni à louer Un film de Pascal RABATÉ
Il est des œuvres dont on parle beaucoup à leur sortie, qu'on rattache à une parenté parfois prestigieuse ou originale mais qui, au bout du compte, sans vraiment décevoir, laissent un goût d'autant plus amer qu'on s'attendait à mieux.
Qu'avons nous ? Une petite station balnéaire un peu quelconque de Loire-Atlantique où vont se retrouver, l'espace d'un week-end des personnages aussi hétéroclites que cette période des vacances peut mettre en situation : un couple de retraités qui regagne sa « maisonnette » en bord de mer, deux familles qui campent, un supermarché vide dont les codes-barres sont le seul intérêt, un couple de punk avec chiens, un enterrement, un cadre en mosaïque à demi terminé par le défunt, une histoire de cerf-volant perdu qui provoque un adultère, un épisode sado-maso dans une chambre d'hôtel, un lapin à contre-emploi, deux golfeurs un peu imposteurs et, pour finir un spectacle franchement minable où un chanteur nous répète que « les vacances à la mer, c'est super ! ». Le tout sans vraiment de dialogue, avec seulement des bruits de fond ou des onomatopées et sur une musique entrainante et épisodique. C'est donc une mosaïque de personnages qui ne se rencontrent pratiquement pas, une succession de saynètes indépendantes les unes des autres où les gags fleurissent sans, à mon sens, jamais convaincre vraiment.
Le décor, les personnages, le scénario (s'il y en a un), l'absence de dialogue (ce qui n'en fait pas pour autant un film muet), évoquent Jacques Tati[« Les vacances de M. Hulot » (1953)]. C'est sans doute pour cela qu'on a qualifié ce film de génial, même si de son vivant Jacques Tati n'a pas vraiment convaincu dans ce domaine et qu'on a attendu qu'il soit mort pour s'intéresser à son œuvre cinématographique et pour lui trouver du génie ! Tati s'était approprié un phénomène récent, les vacances populaires, l'avait traité avec cet humour décalé qui faisait son originalité. Mais ici, il me semble que, malgré une touche de tendresse, les gags sont parfois un peu trop forcés et caricaturaux, parfois un peu trop répétitifs aussi. Le comique existe pourtant, c'est indéniable, mais c'est plutôt une succession de cartes postales animées, burlesques et dérisoires, mais sans la poésie que la spectateur était en droit d'attendre eu égard à la filiation annoncée de ce film. Pascal Rabaté se différencie de Tati en ce sens qu'il actualise son message par la prise en compte de l'échangisme, genre amour de vacances, le phénomène sado-maso, le camp de nudistes ou l'homosexualité punk. Pourtant je m'attendais à une sorte de fresque sociologique, une peinture de la société française comme aimait à le faire l'auteur de « Mon oncle ». Seule peut-être l'émotion prévaut autour de la mort de l'époux ou de la prise en compte un peu furtive de la fuite du temps à travers le dessin de la petite fille qui a grandi et qui est maintenant devenue une femme.
Le film est cependant servi par un choix d'artistes dont le talent n'est pas assez mis en valeur par le parti-pris de l'absence de dialogue. On pouvait s'attendre à ce que le comique, voire l'émotion, naissent de de l'expression ou de la seule situation. C'était une volonté louable, mais cela ne fonctionne pas toujours, malheureusement. J'ai assisté à une sorte d'exercice de style un peu décevant et sans réel rythme où le comique que j'aime tant chez Tati n'était pas vraiment au rendez-vous.
Hervé GAUTIER
La Feuille Volante n°532 – Juillet 2011
Les Clés de Saint-Pierre - Roger PEYREFITTE (Flammarion)
Mon hypothétique lecteur se souviendra peut-être que cet auteur avait déjà retenu mon attention pour un roman quelque peu iconoclaste de la même veine que celui-ci et qui avait donné lieu à un échange épistolaire éphémère avec Roger Peyrefitte. [La Feuille Volante n° 37 de janvier 1990 à propos de « La soutane rouge »]. Des lectures toujours aussi délicieuses précédèrent et suivirent celle de cette intrigue « policière » vaticane. Comme je l'ai déjà écrit dans cette chronique, la nouveauté n'est pas le seul critère de la valeur d'un livre, tant s'en faut, surtout quand il s'agit de l'œuvre d'un auteur majeur. Ce roman, publié en 1955 (c'est la date de mon édition qui est si vieille que j'ai même dû en couper les pages et Dieu sait combien j'aime séparer les feuillets d'un livre avant de le lire !), me paraît illustrer parfaitement cette manière de voir d'autant qu'il ne me semble pas que l'œuvre de notre auteur soit rééditée.
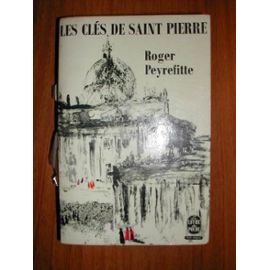 Quand il fut publié, ce roman fit scandale parce que François Mauriac avait condamné ce livre qui présentait Pie XII comme un homosexuel. [Je dois dire que cette lecture m'a laissé dubitatif sur ce point]. Peyrefitte avait répondu par une lettre ouverte dénonçant la tartuferie de son détracteur...et sa possible homosexualité (il semblerait d'ailleurs que Peyrefitte ait été quelque peu visionnaire puisque, actuellement, la question de l'homosexualité de Mauriac est officiellement abordée).
Quand il fut publié, ce roman fit scandale parce que François Mauriac avait condamné ce livre qui présentait Pie XII comme un homosexuel. [Je dois dire que cette lecture m'a laissé dubitatif sur ce point]. Peyrefitte avait répondu par une lettre ouverte dénonçant la tartuferie de son détracteur...et sa possible homosexualité (il semblerait d'ailleurs que Peyrefitte ait été quelque peu visionnaire puisque, actuellement, la question de l'homosexualité de Mauriac est officiellement abordée).
L'histoire qui sert de prétexte à ce roman est par ailleurs bien simple : un jeune séminariste français, l'abbé Victor Mas, séjourne pour une année à Rome chez le vieux cardinal-chapelain Belloro, dont il devient le secrétaire, pour parfaire sa formation. Pour corser un peu le récit, l'auteur fait intervenir une jeune et belle Romaine, Paola, nièce du chapelain. L'auteur ajoute « un valet de chambre cynique » qui ne manque pas de faire des remarques parfois croustillantes à l'intention du jeune ecclésiastique.
Ce roman est surtout l'occasion de mettre en exergue l'érudition de son auteur. Les choses de la religion catholique ne lui sont pas étrangères au point qu'il livre à son lecteur un inventaire complet (et savoureux) des richesses vaticanes, de l'histoire des saints et de leurs pouvoirs, évoque « le saint prépuce » et les querelles byzantines qu'il a suscité, se fait l'écho des pouvoirs supposés des médailles votives, du chapelet, du scapulaire et des eaux miraculeuses, vantés par chaque ordre religieux... On sent bien sa volonté de railler un peu le Vatican dont il connaît bien les travers, témoin cette savoureuse relation de la canonisation de Pie X. Il n'oublie pas non plus son anticléricalisme coutumier et sa volonté de pourfendre l'hypocrisie. Son humour, ses bons mots sont irrésistibles et il laisse libre cours à sa verve dont ses fidèles lecteurs sont friands. Il s'en donne d'ailleurs à cœur-joie sur ce thème, maniant le calembour et donnant à penser que l'argent tient une grande place dans cette Église qui est bien loin des pauvres et du message de l'Évangile. « Les clés de Saint Pierre ouvrent les portes du ciel, mais il faut graisser la serrure », « Le Vatican doit louvoyer sans cesse entre le temporel et le spirituel pour ne pas les compromettre l'un par l'autre. Certains le disent dénué de courage, d'autres dénué de scrupules.», « Les clés de St Pierre sont les clés de la caisse »... Il écorne au passage les jésuites, « La soutane des jésuites étant sans boutons, elle se retourne plus vite ». Il s'établit entre le vieux prélat et le jeune séminariste un dialogue un peu surréaliste pour le profane à propos des symboles, des reliques miraculeuses, de leur multiplication inquiétante, de leur extravagance parfois, du rituel un peu compliqué des cérémonie religieuses ainsi que sur l'efficacité des indulgences et la manière de les gagner. Elles pleuvent maintenant gracieusement sur les fidèles d'aujourd'hui alors qu'elles furent l'objet, dans le passé de sordides transactions. Quant aux canonisations, elles ne seraient pas, selon lui, exactement et uniquement affaire de mérite ...
Entre eux, deux conceptions de l'Église s'affrontent. D'un côté le prélat prétend que « seule l'Église de Rome a le sens de l'universel », affirmant par là sa prééminence et sa supériorité tandis que son jeune confrère plaide volontiers en faveur des prêtres-ouvriers et une conception plus moderne, plus française peut-être et ouverte sur le monde...
La présence de la nièce du cardinal, Paola, ajoute à la confusion du séminariste. Comme on peut s'y attendre, l'abbé succombera, parce que la chasteté n'est attachée qu'aux ordres majeurs qu'il n'a pas encore reçus, que la femme est considérée par l'Église comme une tentatrice, et que Victor n'est qu'un homme, beau de surcroît ! Il en oubliera pour un temps la théologie, le dogme, la discipline... ce qui ne sera pas sans lui poser de cas de conscience. Paola finira même par mettre notre jeune prêtre en demeure de choisir entre elle et Dieu ! Heureusement les choses reviendront à leur vraie place...
Peyrefitte ne serait pas lui-même s'il ne parlait de la pédérastie de certains membres du clergé, même si notre abbé y reste complètement imperméable, s'il ne se faisait l'écho des ragots et des mesquineries qu'il prête aux prélats et aux ordres religieux et qui sont loin de la charité chrétienne. On sent bien que l'auteur, ancien élève des jésuites, est à son affaire dans le domaine des comptes qu'il entend régler avec l'Église. Que ce soit la chasteté « C'est Saint Paul qui a plongé le christianisme dans cette continence furieuse pour se venger de n'avoir pu lui-même l'observer », la foi « la foi du charbonnier exige au moins du charbon », le rituel exagérément symbolique ou le prétendu pouvoir des amulettes religieuses qui confine à la superstition. Et pour être plus convainquant, il mêle adroitement les personnages fictifs aux personnages réels au point que le lecteur reste dans une heureuse confusion. Ce roman est aussi l'occasion d'un parcours jubilatoire dans la Rome catholique.
Il reste que Roger Peyrefitte, quel que soit ce qu'il était par ailleurs au regard d'une morale d'un autre âge, a été un grand serviteur de la langue française par la richesse de son vocabulaire, par la distinction de son style, par son érudition, par la pertinence et aussi l'impertinence de ses propos. Il sont certes un peu malveillants et emprunts d'un parti-pris indubitable, mais après tout, cela fait son charme.
Pour moi, lire un de ses romans a toujours été, de la première à la dernière page (il y en a quand même 436 !) un bon moment de lecture.
Hervé GAUTIER
La Feuille Volante n° 515 – Avril 2011
Le Marin à l'ancre - Bernard GIRAUDEAU (Ed. Métailié)
D'abord l'histoire sans laquelle un roman n'en est probablement pas un. Deux personnages principaux, l'un d'eux, Roland est tétraplégique, " ancré " sur un fauteuil roulant, sa " galère à roulettes " et Bernard a été ce marin de dix-sept ans, sur la Jeanne d'Arc, naviguant sur les mers du globe, puis est devenu comédien, réalisateur... Pour lui il sera " témoin "... Entre eux, des lettres écrites par Bernard pour Roland, pendant dix années... Il y raconte ses souvenirs, ses aventures, une sorte de voyage par procuration dans les ports et sur les lieux de tournage, dans des pays lointains que son ami ne verra jamais, qu'il ne connaîtra que par la force de ses mots... Il lui offre avec pudeur des paysages magnifiques, comme ceux des cartes postales mais aussi des images de ports parfois crasseux, avec leurs relents de graisse, d'alcool et de vomissures. Il lui livre aussi ses réflexions personnelles sur la vie, sur ceux qu'il croise, note que l'homme n'est pas aussi bon que les philosophes du Siècle des Lumières ont voulu nous le faire croire, met ses pas dans ceux de René Caillié, de Pierre Loti, de Francisco Colloane ou d'Antoine de Saint-Exupery. Il mêle dans son récit ses souvenirs de jeune matelot embarqué, d'élève de l'école des mécaniciens de la marine à St Mandrier où à quinze ans les rêves d'enfant s'effondrent dans des odeurs de cuisine, d'équipages ou de salles des machines, que naissent les fantasmes et les fanfaronnades d'une adolescence à peine entamée... Il y ajoute ses expériences d'homme, d'écrivain-voyageur, retrace la découverte des femmes et de leur fragrance, celle de lui-même aussi, de son destin qui peu à peu se tisse, une chronique à la fois nomade et intime, livrée à travers un texte parfois intensément poétique, parfois, trivial, brut et sans artifice... Cela aussi j'aime bien !
Des femmes, il dit " qu'elles naviguent dans le vent comme l'algue sur l'océan, (qu') elles bougent comme la houle ", mais sous chaque mot qui les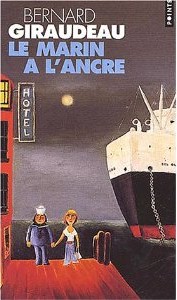 évoque, je choisis de voir leur beauté à laquelle nul ne peut être indifférent. Il parle simplement de " la douceur des femmes du sud ", des vahinés de Gauguin, des femmes à la peau ambrée et en paréos bleus des Marquises, des filles de Manille dont "( les) rires s'éparpillent sur la pierre chaude ", de cette irréelle et sensuelle dame de Balboa dont un quartier-maître de la Jeanne fut l'éphémère amant, de cet Iva " qui avait du satin au creux des cuisses "... Il parle aussi des bordels tristes, des étreintes fugaces et sans joie, des prostituées qui se vendent aux marins en escale pour manger parce que la misère est leur quotidien. Il évoque tout aussi bien ces épouses adultères qui trompent leur conjoint pour un peu de jouissance, pour le plaisir d'enfreindre l'interdit ou de cultiver la trahison. Pour cet interlocuteur lointain resté à terre, il se fait tour à tour guide, témoin d'exception, érudit, historien même, respectueux des coutumes et des traditions, mais aussi simple étranger de passage quelque fois pressé de partir, pour qu'à l'immobilité de l'un réponde le mouvement de l'autre. C'est la marque d'une amitié tissée à travers des mots confiés au papier messager, l'ambiance des ports, de La Rochelle à Dakar de Diego Suarès à Marseille ou Valparaiso, autant de lieux mythiques où le dépaysement le dispute à l'invitation au voyage, où l'écriture de l'auteur suscite l'émotion et l'imaginaire du lecteur. Bernard et Roland voulait partir ensemble aux Marquises. Ils n'en ont pas eu le temps, Roland qui n'a connu que l'île de Ré et les pertuis a été rejoint par la mort en décembre 1997, a " décidé de voyager libre comme un papillon du silence ".
évoque, je choisis de voir leur beauté à laquelle nul ne peut être indifférent. Il parle simplement de " la douceur des femmes du sud ", des vahinés de Gauguin, des femmes à la peau ambrée et en paréos bleus des Marquises, des filles de Manille dont "( les) rires s'éparpillent sur la pierre chaude ", de cette irréelle et sensuelle dame de Balboa dont un quartier-maître de la Jeanne fut l'éphémère amant, de cet Iva " qui avait du satin au creux des cuisses "... Il parle aussi des bordels tristes, des étreintes fugaces et sans joie, des prostituées qui se vendent aux marins en escale pour manger parce que la misère est leur quotidien. Il évoque tout aussi bien ces épouses adultères qui trompent leur conjoint pour un peu de jouissance, pour le plaisir d'enfreindre l'interdit ou de cultiver la trahison. Pour cet interlocuteur lointain resté à terre, il se fait tour à tour guide, témoin d'exception, érudit, historien même, respectueux des coutumes et des traditions, mais aussi simple étranger de passage quelque fois pressé de partir, pour qu'à l'immobilité de l'un réponde le mouvement de l'autre. C'est la marque d'une amitié tissée à travers des mots confiés au papier messager, l'ambiance des ports, de La Rochelle à Dakar de Diego Suarès à Marseille ou Valparaiso, autant de lieux mythiques où le dépaysement le dispute à l'invitation au voyage, où l'écriture de l'auteur suscite l'émotion et l'imaginaire du lecteur. Bernard et Roland voulait partir ensemble aux Marquises. Ils n'en ont pas eu le temps, Roland qui n'a connu que l'île de Ré et les pertuis a été rejoint par la mort en décembre 1997, a " décidé de voyager libre comme un papillon du silence ".
Ce roman a été publié en 2001 et a sans doute consacré la naissance d'un auteur. Il fut suivi d'autres qui ne laissèrent pas cette revue indifférente (La Feuille Volante n°316 - 373) Pour moi, simple lecteur, je ne considérerai jamais que la valeur d'un livre réside dans sa seule nouveauté, il reste un témoignage pérenne. Au delà de ce premier ouvrage, du regard bleu de l'acteur et de son charisme, de sa lutte désespérée contre la souffrance et contre la mort, de son témoignage et de l'émotion qui a suivi sa disparition brutale (La Feuille Volante n° 438), Bernard Giraudeau avait ce talent d'écrivain qui, de livre en livre, allait s'affirmant. Je ne me lasserai jamais de dire que la mort est un gâchis et, si elle ne l'avait pas fauché, il serait assurément devenu un écrivain majeur, apprécié à la fois pour son message et pour la façon originale qu'il avait de l'exprimer. Sa démarche créatrice n'était pas différente de celle formulée par Victor Segalen, un autre marin-écrivain, [" Voir le monde et, l'ayant vu, dire sa vision "], de redessiner pour son lecteur un décor, de l'y inviter et de susciter le rêve.
J'ai lu ce livre comme je l'aurais fait d'un roman d'Alvaro Mutis, d'Henri de Monfreid ou de Jack London. J'ai suivi Bernard dans le désert et sur les mers, j'ai imaginé le sac de l'éternel errant, du marin perpétuellement en partance, moi qui ne suis qu'un terrien pantouflard ! [je dois probablement à mes origines charentaises le goût du port des chaussons du même nom ].
J'ai surtout lu ce roman avec émotion à cause du message, certes mais aussi parce que celui qui en a tracé les lignes a maintenant rejoint le néant, que son destin s'est soudain brisé et qu'il n'écrira plus.
La Feuille Volante n° 514 –Avril 2011
Je suis une force qui va ! et je serai celui-là ! - V. HUGO
A Gide à qui on demandait quel était le plus grand poètes français, il répondait " Victor Hugo ", mais ajoutait aussitôt, non sans une certaine perfidie " Hélas !", comme si, dans son esprit la quantité l’emportait sur la qualité !Susceptibilité d’auteur, peut-être ? Qu’importe… mais nous sommes nombreux, anciens élèves de l’enseignement secondaire à en vouloir un peu à ce grand homme (et à d’autres aussi d’ailleurs !) ne serait-ce que parce que l’éducation nationale, sous couvert d’éduquer notre mémoire imposait qu’on apprît de la poésie, qu’on retînt par cœur des vers sans pour autant connaître l’auteur. Victor Hugo était du lot !
Il n’empêche, la personnalité de cet homme, sa vie au quotidien vue par Max Gallo, humaniste et écrivain ne pouvait que m’intéresser et faire de moi un lecteur attentif tant Hugo fait partie de notre patrimoine national !
Dans un style simple, agréable, pédagogique même, il nous présente l’homme, nous dit que son enfance fut difficile entre un père militaire, éperdument amoureux d’une mère que pourtant il finit par délaisser au profit d’une maîtresse officielle, les absences paternelles qui lui firent connaître, aux côtés de sa mère, la solitude et sinon la pauvreté, à tout le moins la précarité !
L’enfant vécut mal la séparation finale de ses parents, leurs déchirements. Ses études en pension, sa santé fragile, la concurrence avec ce frère aîné qu’il dépassera bientôt... Il puisa dans ces épreuves prématurées le besoin d’écrire, de même que dans l’amour naissant qui deviendra une véritable passion pour Adèle qu’il épousera.
Puis ce sera le divorce de ses parents permis par le Code Napoléon et les vicissitudes financières de son père, tantôt comblé d’honneurs, tantôt en demi-solde. Il en souffrira autant que la présence de cette marâtre à qui il oppose sa mère aimante et dévouée. A travers cette femme bafouée, il fait l’apprentissage du mariage, à travers l’itinéraire du père, celui de la vie en société. Il se souviendra plus tard de ces deux exemples surtout lui dont la vie matérielle dépend déjà de sa plume, du talent, mais pas encore du génie !
La vie est une chose bien étrange. On s’y accroche, le plus souvent en jurant qu’elle est belle et qu’elle mérite d’être vécue au point qu’on la traverse comme si on était immortel alors que la mort nous guette et que le quotidien se charge de nous donner des leçons. Hugo n’échappera pas à cette condition humaine qui souvent fait qu’on suit l’exemple pourtant combattu de ses propres parents.
Le père était volage, le fils lui ressemblera, multipliant les aventures amoureuses mais conservant son épouse Adèle qu’il continue d’aimer passionnément, même s’il la délaisse au point qu’elle aille chercher dans d’autres bras cet amour que son mari dispense si largement à ses maîtresses, Juliette Drouet et combien d’autres… Ses nombreuses amours sont bourgeoises, aristocratiques, ancillaires ou vénales, mais Victor, plus que son père sans doute ne pourra jamais se passer des femmes, de leurs corps, du plaisir même fugace qu’elles lui donnent et y compris dans un âge avancé, il aime toucher, voir, pénétrer ces femmes au point qu’il note sur son carnet chaque passade en latin ou en espagnol avec des précisions sibyllines et bien peu poétiques, et parfois le prix qu’il a payé pour cet égarement. (Lui qui prétendait que ces notes étaient destinées à des ouvrages à venir, on imagine la jubilation de Gallo d’avoir, peut-être su les déchiffrer !) C’est que, l’ayant connu, il sait ce qu’est la nécessité et comprend ces femmes mais son besoin priapique le pousse parfois vers le quartier des prostituées !
C’est que l’homme attire les femmes. Il les lui faut toutes (¡Todas !) et il en aura beaucoup ! Elles s’offrent à lui, malgré leur jeune âge, leur condition d’épouses, leur rang social, leurs opinions politiques…Et dans l’ombre de son ménage officiel se tient toujours Juliette Drouet qu’il n’épousera jamais mais qui lui restera fidèle au point de risquer sa vie pour lui, de le suivre dans son exil, d’être sa copiste, son amante… Il la séquestre pour mieux l’aimer, pour mieux la garder pour lui seul et elle acceptera sans ciller la loi de cet homme. Elle sera sa chose oh combien consentante parce que simplement elle est aussi amoureuse de lui que lui d’elle ! Quand Hugo sera veuf, Juliette deviendra sa compagne " officielle ", gérante de sa fortune, mais, peut-être davantage qu’Adèle, elle sera plus prévenante, plus jalouse, plus inquisitrice même ! Elle l’aime, le sait infidèle, lui rappelle ses devoirs et même la simple décence, mais il y a entre Hugo et les femmes une envie plus forte que l’amour, un besoin charnel. Presque au pas de la mort, il ressentira cela comme une vitale nécessité !
L’épouse " officielle " ferme les yeux sur les égarements de son mari, même s’il compte et lui dispute parfois l’argent qu’il lui donne ! C’est qu’il n’oublie pas les premières années, les mansardes et les appartements exigus. Malgré la richesse et la gloire qu’il connaître ensuite, il se souviendra toujours de la condition des pauvres, les défendra, leur viendra en aide, sera, dans son œuvre le témoin de ce prolétariat que la monarchie et l’empire bafouent, humilient et à qui ils refusent la liberté !
C’est que Hugo, dont le seul métier est d’écrire veut réussir, et pas seulement en littérature. Déclarant qu’il veut " être Chateaubriand ou rien ", il mêle dans ce vœu les Lettres et la politique. Pour cela, il recherche l’appui et l’amitié des grands. Certains la lui accordent sans arrières-pensées, tel Théophile Gautier qui illumina de sa présence " la bataille d’Hernani ", d’autres seront plus tièdes comme Sainte-Beuve à qui son épouse semble accorder ses faveurs mais qui ne sera jamais vraiment un soutien pour lui ! Quand celui dont les mots coulent des mains comme l’eau d’une fontaine publie un livre, il recueille souvent des compliments mais les palinodies, les railleries, les quolibets de ceux qu’ils croyaient siens se manifestent parfois au grand jour. Dans la force de l’âge, il réagit, s’emporte, mais la vieillesse le rend fataliste. Pourtant il vit et comme le fait si justement remarqué Max Gallo, " Écrire, c’est comme respirer, quand on s’arrête on meurt ! " Il vivra longtemps, lui a qui on peut appliquer cette phrase de Voltaire. Sa seule force c’était sa plume qui " [avait] la légèreté du vent et la puissance de la foudre ".
Grâce à ce formidable don d’écrire, cette inspiration qui le réveille même la nuit, il pèse sur le cours des choses, obtient des grâces, des amnisties pour les condamnés à mort, pour les insurgés de la Commune… Mais cela ne lui suffit pas, il voudrait être Pair de France, le roi l’élèvera à cette dignité, en fera son confident, son conseiller. Un poste de ministre est à sa portée, mais l’affaire ne se fait pas. Pourtant, il sait qu’il ne fera avancer les choses que par la politique. Cela ne l’empêche pas d’hésiter un temps entre la royauté et la République mais quand c’est l’Empire qui se présente, celui de " Napoléon le petit ", il s’exile à Guernesey. Pour lui, il n’y a qu’un Napoléon, Bonaparte, qu’un Empire, le Premier ! Et quand il s’agira de se battre, il le fera avec les pauvres, avec le peuple !
Pourtant, même comblé d’honneurs, de réussite sociale, de richesses, même élu (de justesse) à l’Académie Française, il reste un homme d’action et quand le monde bouge autours de lui, il défend les pauvres mais combat l’anarchie, se fait le défenseur de l’ordre. C’est peut-être une contradiction, mais au moins il agit selon son cœur, il fait ce qui lui semble être son devoir. Comme tout homme, il est à la fois ambitieux et pusillanime. Il se veut un homme d’action, alors qu’il est surtout un homme de paroles. Il voudrait être vertueux, mais les femmes l’obsèdent. Il se voudrait généreux (il l’est parfois), mais compte comme s’il avait peur de manquer, il voudrait être socialiste et révolutionnaire mais son ambition politique le pousse souvent au conservatisme et quand il est l’élu de la droite, il n’a de cesse de réclamer une politique de gauche. Il est richissime, mais réclame le corbillard des pauvres pour son enterrement qui pourtant l’emporte au Panthéon ! Il combat l’hypocrisie, mais applique rarement ce principe à sa vie privée. C’est que l’homme ne laisse jamais indifférent, qui dénonce, déclenche la haine autant que l’admiration. Il est un homme libre !
Il est des êtres qui semblent portés leur destin sur leurs épaules au point que leur vie ne peut se dérouler en dehors d’eux. Hugo est de ceux-là. Il y a eu sa vie, longue, admirable et mouvementée, mais surtout, il y a la mort, moins la sienne que celle de ceux qui l’entourent surtout quand le cours des choses s’inverse et qu’on porte en terre un parent plus jeune, son frère, ses deux fils, sa fille, son premier petit-fils, son autre fille, morte-vivante enfermée dans un asile d’aliénés… Il va tenter d’apprivoiser cette mort qui dès lors ne lui fait plus peur. A Guernesey, il correspond avec l’au-delà. Il va la combattre par l’écriture, par le corps des femmes, par cette extraordinaire vitalité et longévité qui a non seulement fait de lui un " immortel ", mais qui, selon le mot de Malraux, a " arraché quelque chose à la mort . " Il sent la sienne s’avancer à travers des signes, des coups frappés dans la nuit et qui le réveillent…
Il est des livres qu’on oublie en les refermant. Ces deux tomes, pour moi ne sont pas de ceux-là !
Dans cette œuvre magistrale, le portrait de Hugo nous est brossé jusque dans ses moindres détails. Si Max Gallo reconnaît la grandeur et les mérites de l’homme de plume, de cœur et d’action, il n’en note pas moins ses contradictions sans oublier qu’il a été aussi un précurseur politique, demandant l’abolition de la peine de mort, rêvant des États-Unis d’Europe avec pour langue officielle le français. C’est peut-être un peu à lui à qui pensait Aragon quand plus tard il a écrit " Rien n’est jamais acquis a l’homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur… " et c’est peut-être en écho que lui a répondu. Jean Ferrat " Le poète a toujours raison, qui voit plus loin que l’horizon et l’avenir est son royaume… "
Hervé GAUTIER
LA FEUILLE VOLANTE n° 242 – Août 2002
L'écluse des inutiles - Jean-François POCENTEK
D'abord il y a le livre, un objet qu'on tient dans ses mains mais dont il faut couper les pages avant de les lire ; cette opération un peu nostalgique laisse toujours des barbes de papier sur la tranche. Au coin de chaque feuillet qui a échappé à la lame on trouve même un peu du suivant et cela rappelle l'enfance, donne l'image d'une certaine imperfection qui me plait bien quand tout aujourd'hui tend vers l'excellence... On peut donc entamer la lecture !
Le titre ensuite dans lequel figure le mot " inutiles " qui résonne bizarrement dans cette société où chacun doit être efficace et surtout étaler sa réussite sans quoi elle n'a aucune valeur !
Le décor enfin, celui du Nord de la France en novembre, un canal très ordinaire, une eau sombre avec une écluse et quatre maisons perdues. On y accède à pied et dans l'une d'elle, celle de Mathilde, on vient y partager un repas en l'honneur d'on ne sait quoi, la mort d'une chienne ou la venue de la suivante. Images d'un temps immobile, de gens plus ou moins exclus de cette société parce qu'ils sont sans travail ou infirmes, sorte de " bernard l'ermite " occupant des coquilles vides qui passent dans cette vie et finissent par mourir parce que là est la condition de tous les hommes. Que ce soit Marceau, l'ancien maître de forge, Marcial l'infirme, Marthe, Mathilde, l'enfant immobile ou le narrateur, simple employé d'un bureau d'objets trouvés près de la gare, ils sont tous porteurs d'un message, ont tous une histoire à raconter, mais le font en silence et c'est pour cela qu'ils partagent ce repas, peut-être aussi parce qu'ils se ressemblent tous, qu'ils sont tous des anonymes.
C'est une sorte de rituel autour de la cuisinière à charbon qu'on ferme avec des cercles de fonte, du tabac à fumer qu'on roule entre ses gros doigts, des odeurs domestiques, le son d'un carillon, les arômes du café, les silences et l'économie des mots qu'on prononce en hommage aux morts, le vin qu'on boit dans des verres entrechoqués... On y évoque le passage sur terre de ceux qui ne font plus partie des vivants mais qui " ont marqué la mémoire des lieux ", ont aimé cette vie parce qu'elle est un bien unique auquel on s'accroche parfois désespérément. A la fin de ce repas, on avance vers le canal, comme on mènerait une procession, pour aider à la digestion ou voir le paysage...
Puis on se quitte parce que c'est la règle et que le temps a ses exigences, avec en prime le chagrin, l'eau dans les yeux, mâtinés si on veut y croire, par l'espoir d'un retour, d'une nouvelle rencontre, avec le rituel des embrassades, des accolades, des serrements de mains et des paroles. Et puis le temps change, les maisons sont détruites, les gens meurent ou disparaissent ...
Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de ma vieille attirance pour la poésie, pour la musique des mots, pour l'ambiance que distille ce texte, mais j'ai bien aimé ce livre et j'ai eu envie de tourner les pages de ce qui n'est peut-être pas un roman. J'y ai entendu une sorte de musique un peu triste mais aussi très douce, un monde différent devant lequel on passe parfois sans le voir tant il est ordinaire. Il est question de l'éclusier, parce que l'écluse justifie sa présence [il parle aussi à la première personne, comme le narrateur] il est présent et absent à la fois, à contre-champ, à contre-jour, à la fois gardien de ce petit bout de planète, veilleur, guetteur... Comme les autres personnages il ressemble à des fantômes. Ils parlent de la petitesse du monde qui les entoure et dont il ne font même plus partie. C'est que le peuple du canal est fait de " ramasseurs de trésor ", de " cueilleurs de grenouilles ", de " coupeurs de queues de rat " autant de membres d'une communauté qui s'identifie au canal, à son chemin, à ce paysage lui-même!
Et puis il y a les mots qu'on porte en soi, parfois longtemps et qui finissent par sortir un beau jour ou une belle nuit, sans crier gare, parce que c'est l'heure, parce qu'ils en ont décidé ainsi. Les gens pressés appellent cela l'inspiration, mais on n'est pas forcé d'acquiescer à leurs allégations. Pourtant ces mots sont maintenant emprisonnés dans un livre, imprimés sur des pages qu'ils noircissent, à jamais exprimés pour des lecteurs innombrables, passionnés ou indifférents, c'est selon !
La Feuille volante n° 414 - Avril 2010
Hervé GAUTIER
Des hommes et des dieux - Xavier BEAUVAIS
Il est des films dont la projection laisse le spectateur sans voix.
Ce film est de ceux-là et l'impression première que j'ai eue, la lumière revenue, fut le silence, l'immobilité des gens, leurs larmes secrètes peut-être? On pouvait y lire à la fois l'horreur pour cette mort atroce pourtant tout juste évoquée, l'admiration pour l'abnégation de ces hommes et pour leur sacrifice consenti, la révolte contre la violence, la fascination pour le courage d'aller au-devant d'une mort certaine et acceptée, la fin d'une mission terrestre, le commencement d'une autre vie... D'évidence, ce genre d'exemple ne laisse pas indifférent !
Au-delà des événements que tout le monde a encore en mémoire [ Une communauté de huit moines trappistes qui vit en harmonie depuis longtemps à Tibhérine au Maghreb algérien en contact avec la population arabe à qui elle vient en aide, sa prise en otage en 1996 puis son assassinat dans un rituel inconnu et barbare – on ne retrouvera que leurs têtes mais pas leurs corps] mais qui reste encore aujourd'hui un mystère, il y a ce film. Même s'il est librement inspiré de faits réels, il nous rappelle encore une fois que chaque homme est mortel, même si dans nos civilisations occidentales cette évidence est encore taboue. Il parle aussi de cette propension qu'ont les hommes à s'entretuer avec pour cela l'excuse de la religion comme le rappelle cette pensée de Pascal opportunément citée, mais aussi de l'acceptation de cette mort que l'on sent rôder, sous la forme de groupes armés islamiques incontrôlés.
Dès lors se pose, pour les moines, le problème de l'abandon de cette population arabe aux exactions des islamistes ou le maintien de leur présence au monastère quoiqu'il arrive. Un monastère est constitué par un groupe d'hommes venus d'horizons différents avec des personnalités différentes, soudés par la seule force de leur foi, de leur mission et par la règle de leur ordre. Dès lors, quitter les lieux revient aussi à fissurer la cohésion de la communauté, d'accepter d'opposer à la violence extérieure la force de la prière et de l'exemple quoiqu'il puisse en coûter! Ce cheminement vers l'acceptation du martyre est bien montré dans le doute de chacun au début puis, à la fin, dans un ultime repas pris en commun (la cène!) que Frère Luc (Michael Lonsdale époustouflant de réalisme et d'humanité qui se pose avant tout en homme libre) choisit d'agrémenter de vin rouge (comme le sang du sacrifice) et de la musique profane de Tchaïkovski (Le lac des cygnes) à la place de la traditionnelle lecture de textes sacrés, comme on abandonne ce monde terrestre, les larmes vite essuyées du vieux Frère Amédée, la détermination de Frère Christian (Lambert Wilson en contemplatif déterminé), la décision de toute la communauté...
Ce n'est pas un film confessionnel au sens strict du terme puisque la vie des moines dans ce coin de l'Atlas se déroule sans la moindre volonté de prosélytisme. Ils soignent indifféremment tous ceux qui se présentent au monastère, prient pour l'âme d'un enfant assassiné autant que celle du rebelle assassin, parlent librement du monde extérieur... Il n'y a pas de message proprement évangélique (les moines citent à la fois le Coran et l'Évangile - on peut parfaitement être athée et être bouleversé par cet exemple), seulement la mise en évidence des valeurs humaines de tolérance, de charité, de fraternité entre les hommes, maintenant fortement gommées par notre mode de vie où la réussite sociale, financière, professionnelle, le paraître, sont les seuls critères. L'image donnée par le monde au quotidien en procure tous les jours l'illustration.
Ces moines sont des hommes de dieu et choisissent d'opposer leurs fragiles chants liturgiques aux vrombissements des hélicoptères de l'armée, décident, contre toute logique, de rester au monastère malgré les mises en garde des autorités incapables d'assurer l'ordre public dans un pays en totale décomposition, opposent un refus silencieux à la délation même si elle vise à livrer des terroristes et même si en jouant ce jeu, les moines se protègent indirectement. Ils rappellent d'une manière apparemment anachronique que leur vie ne vaut rien parce qu'elle est déjà offerte à dieu et qu'ils doivent accepter sa volonté sous quelque forme qu'elle se présente. Il y a quelque chose de grand dans l'acceptation de ce sacrifice.
De nos jours encore, des hommes que tout désignait pour un parcours brillant et carriériste choisissent de tout quitter, de refuser une vie de famille, d'embrasser la pauvreté, l'abnégation, le service de l'humanité et la foi en un dieu qu'ils n'ont jamais vu mais qu'ils servent aveuglément, parce que là est le véritable sens de leur vie. Le silence, la prière, la foi sont leurs seules armes. En cela ils forcent le respect, apportent un certain apaisement et un exemple de dignité. Ce n'est pas un film qui oppose l'islam et l'Évangile, ce sont toutes deux des religions révélées, des religions du Livre, qui prônent la tolérance, la charité, le respect de l'autre, ce n'est même pas un film contre les islamistes, leur vision meurtrière du monde et leur mauvaise interprétation du Coran. Les circonstances " historiques " eussent été différentes, le résultat n'en aurait pas moins été le même. Les hommes continueront de s'entretuer tant qu'ils vivront!
Le film n'apporte pas de réponse à ces exécutions, ce n'était d'ailleurs pas le sujet, même si on a pu se livrer à des supputations sans le moindre fondement, si le mystère entoure encore cette prise d'otages et le marchandage qui y a fait suite. L'important est ailleurs, au-delà du spectacle qui ne veut sans doute pas emporter l'adhésion du spectateur mais lui donner l'occasion de remettre en question des idées reçues, de réfléchir sur un monde qui devient chaque jour plus fou.
C'est assurément la mise en évidence d'un exemple bouleversant.
Prix du Jury au 63° Festival de Cannes
LA FEUILLE VOLANTE n°458 - Septembre 2010
ÓHervé GAUTIER
La carte et le territoire - Michel HOUELLEBECQ
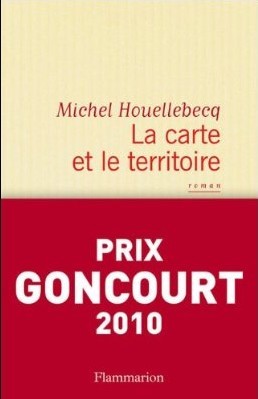 Tout commence un 15 décembre par la panne d'un chauffe-eau chez Jed Martin, peintre et ex-photographe. Son père, Jean-Luc Martin, ancien architecte et P.D.G. d'une entreprise de construction, veuf, vit actuellement dans une maison de retraite. Le père et le fils qui ne sont pas vus depuis longtemps prennent ensemble un repas de Noël. Entre eux, il n'y a jamais eu que des relations distantes. Auparavant, à l'occasion des obsèques de sa grand-mère, dans la Creuse, Jed se prend de passion pour les cartes routières Michelin qu'il photographie. De plus, il rencontre une très belle femme d'origine russe, Olga, qui justement travaille dans cette entreprise. Naturellement, ils deviennent amants et elle le lance. Avec lui, la carte, Michelin, objet éminemment utilitaire, va entrer dans le monde de l'art avec une exposition de ses œuvres intitulée "La carte est plus intéressante que le territoire". Le lecteur cherchera peut-être vainement la signification du titre de ce roman dans cette phrase. Il se souviendra opportunément que, sans faire de parallèle abusif, le génial Boris Vian a écrit une merveilleuse histoire qui, bien qu'elle s'intitule "L'automne à Pékin" ne se passe ni en automne ni à Pékin.
Tout commence un 15 décembre par la panne d'un chauffe-eau chez Jed Martin, peintre et ex-photographe. Son père, Jean-Luc Martin, ancien architecte et P.D.G. d'une entreprise de construction, veuf, vit actuellement dans une maison de retraite. Le père et le fils qui ne sont pas vus depuis longtemps prennent ensemble un repas de Noël. Entre eux, il n'y a jamais eu que des relations distantes. Auparavant, à l'occasion des obsèques de sa grand-mère, dans la Creuse, Jed se prend de passion pour les cartes routières Michelin qu'il photographie. De plus, il rencontre une très belle femme d'origine russe, Olga, qui justement travaille dans cette entreprise. Naturellement, ils deviennent amants et elle le lance. Avec lui, la carte, Michelin, objet éminemment utilitaire, va entrer dans le monde de l'art avec une exposition de ses œuvres intitulée "La carte est plus intéressante que le territoire". Le lecteur cherchera peut-être vainement la signification du titre de ce roman dans cette phrase. Il se souviendra opportunément que, sans faire de parallèle abusif, le génial Boris Vian a écrit une merveilleuse histoire qui, bien qu'elle s'intitule "L'automne à Pékin" ne se passe ni en automne ni à Pékin.
Jed s'intéresse ensuite aux "métiers simples", c'est-à-dire en voie de disparition avant de revenir à la peinture. Cela lui permet d'envisager une exposition dont il confie la rédaction du catalogue à Michel Houellebecq, soi-même ! Pourquoi ne pas admettre cette manière de mise en abyme originale ? Et ce d'autant qu'il lui propose de faire son portait ! Son exposition porte d'ailleurs sur des célébrités et cela fait de lui un véritable "artiste" international... mais surtout lui assure la richesse. Ce qu'il veut pourtant c'est être le témoin privilégié par sa peinture "des différents rouages qui concourent au fonctionnement d'une société". Cette exposition est un véritable succès et après tout ce temps passé sans Olga, il la retrouve...
La fin de l'année est pour lui l'occasion du repas de Noël avec son père, de réfléchir sur le succès qui est fragile et éphémère et sur la mort, sur la déchéance physique qui sont inéluctables, sur la relation au père aussi. Tout cela se termine en Suisse dans une clinique spécialisée dans la mort assistée.
La troisième partie du livre s'ouvre, quelques années plus tard, sur la mort de l'écrivain, un meurtre particulièrement atroce et apparemment rituel. Houellebecq a été assassiné chez lui, son corps, en même temps que celui de son chien, décapité au laser, découpé en lanières réparties dans la pièce. Jed, que la police finira par retrouver à cause du portrait qu'il avait peint de l'écrivain, donnera un avis sur le meurtre et sur sa mise en scène, en faisant référence à l'œuvre picturale de Jackson Pollock ! Le lecteur appréciera l'épilogue de cette partie policière du roman. Je ne suis pas très sûr cependant qu'elle soit à la hauteur des attentes suscitées, même si elle est rattachée, peut-être un peu artificiellement, au fameux portrait que réalisa Jed de Houellebecq !
C'est l'occasion pour l'auteur de nous donner une photo du quotidien, à la fois dans le domaine de la télévision, de l'internet mais aussi de l'univers des people ou de la jet-set, en fait tout un monde superficiel, glamour et parisien. Il y glisse des images poétiques et, pèle-mêle, des aphorismes bien sentis autant que des remarques pertinentes, et même impertinentes sur les femmes, les artistes, les universitaires, les architectes, le droit pénal, la fortune, les banquiers, le vin, le monde rural, celui de l'art et de l'argent, la fatuité des puissants qui réclament leur portrait seulement pour passer à la postérité...
Sans qu'on comprenne bien pourquoi, un exil dans le Loiret, puis dans la Creuse le fait philosopher sur sa vie qui se termine. Il mène une réflexion sur l'art en général, sur l'utopie, sur le monde ("le monde est médiocre" dit finalement Jed), sur la solitude et peut-être la vanité du succès, la fuite du temps, la mort, le suicide. La projection qu'il imagine, la France comme une sorte de paradis qui a survécu aux crises, me laisse un peu dubitatif.
Le texte se lit facilement, le style est précis avec un grand culte du détail, parfois technique, même s'il a été décrié et dénoncé comme un éventuel plagiat. Son humour à base d'apophtegmes m'a bien plu. J'ai même bien ri quand il se met lui-même en scène comme un marginal solitaire, maniacodépressif, alcoolique, misanthrope, agressif à l'occasion et détaché de toute contingence, c'est-à-dire comme quelqu'un de pas vraiment fréquentable. Le fait de n'être pas très tendre avec lui-même, au moment où il convient de s'auto-encenser, correspond à ma manière de voir les choses. Se moquer de soi me parait être une valeur ajoutée intéressante ! On peut même penser qu'il existe une grande connotation entre Jed et Houellebecq, à la mesure sans doute de leurs relations, à la fois distantes et quasi-chaleureuses. Que l'un soit le double de l'autre me paraît une évidence.
L'idée de cette fiction n'est pas mauvaise encore que son intérêt labyrinthique m'a un peu échappé.
Les deux précédents romans m'avaient laissé une impression plutôt mitigée et pour tout dire pas très bonne (La Feuille Volante, n° 354 et 358). Ce n'est pas parce que ce roman a obtenu le Prix Goncourt (mon hypothétique lecteur peut constater en lisant cette chronique que je n'ai pas toujours partagé les choix des jurys en général et de celui-ci en particulier), là j'ai pris un certain plaisir à lire, sans trop savoir si cela était dû au style, à la mélancolie de la fin ... ou à ma curiosité !
LA FEUILLE VOLANTE N° 482 – Décembre 2010
Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants M. ENARD
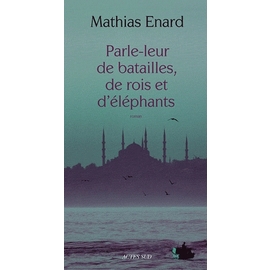 Nous sommes en 1506, Michel-Angelo Buonarroti (Michel-Ange) vient d'être éconduit par le pape Jules II, souverain pontife guerrier et avare avec qui il est engagé pour l'édification de son tombeau à Rome. Devant le refus d'une avance pour poursuivre ses travaux, le sculpteur fuit Rome, se réfugie à Florence où il reçoit une offre alléchante du sultan de Constantinople, Bajazet, de concevoir un pont sur la Corne d'Or et qui réunira les deux parties de cette ville. C'est un extraordinaire défi qu'il veut relever. L'occasion est trop belle, d'autant que Léonard de Vinci, son illustre aîné, a échoué dans ce projet et que Jules II ne se manifeste plus.
Nous sommes en 1506, Michel-Angelo Buonarroti (Michel-Ange) vient d'être éconduit par le pape Jules II, souverain pontife guerrier et avare avec qui il est engagé pour l'édification de son tombeau à Rome. Devant le refus d'une avance pour poursuivre ses travaux, le sculpteur fuit Rome, se réfugie à Florence où il reçoit une offre alléchante du sultan de Constantinople, Bajazet, de concevoir un pont sur la Corne d'Or et qui réunira les deux parties de cette ville. C'est un extraordinaire défi qu'il veut relever. L'occasion est trop belle, d'autant que Léonard de Vinci, son illustre aîné, a échoué dans ce projet et que Jules II ne se manifeste plus.
Il débarque donc à Constantinople, s'enthousiasme rapidement pour la culture turque et la vie semi-oisive qu'il mène, mais, malgré un truchement, il ne parle pas la langue... Pourtant tout ici l'intéresse, il goûte le raffinement des plaisirs, les langueurs de l'Orient, les couleurs et les senteurs du bazar, l'harmonie de l'architecture, la beauté des corps et des visages dont il se souviendra plus tard et qu'on retrouvera dans son œuvre ...Mais il est avant tout sculpteur, pas architecte ni ingénieur et ce qu'il dessine volontiers ce sont les animaux et l'anatomie humaine, pas les ponts ! Le seul spécimen dont il se souvient est celui qui enjambe d'Arno à Florence, et il ne le trouve pas beau !
Il se désintéresse même quelque peu de son travail, gagné qu'il est par tout ce qu'il découvre dans cette ville. Et puis, malgré cette invitation tentante du sultan, il s'aperçoit qu'ici comme à Rome " il faut s'humilier devant les puissants " et faire ce qu'ils attendent. Alors il rêve, pense qu'ici comme ailleurs " les hommes sont des enfants... On les conquiert en leur parlant de batailles, de rois, d'éléphants et d'êtres merveilleux... ". Tout est donc possible.
Et puis, malgré cette ville fabuleuse, mystérieuse et cosmopolite où il vit incognito, il regrette Rome et sa patrie, son travail n'avance guère et surtout il est chez les infidèles et a le sentiment d'avoir trahi tout le monde à commencer par Dieu. Et il y a cette lettre qu'il reçoit et où il comprend qu'il est découvert, que la cabale qui s'est tissée contre lui va le broyer, que Jules II va se venger de sa désertion. Pour lui ce sera la ruine, l'excommunication, la mort...Il cauchemarde, se remémore le supplice de Savonarole à Florence...Pourtant le Grand Turc est en paix avec les cités d'Italie. Il n'a donc rien à craindre. Alors, lui qui n'est pourtant pas beau et qui n'a rien de la délicatesse des ottomans, s'adonne aux plaisirs qu'offrent cette ville et bien sûr y rencontre l'amour " cette promesse d'oubli et de satiété ", mais aussi l'ambiguïté des relations entre les hommes faites de sensualité et de violence, d'infidélités, de querelles politiques inoubliées aussi, dans cette contrée au carrefour des civilisations.
Est-ce son jeune âge, son séjour merveilleux ou ce pays, il se met au travail et parvient à un dessin qui enthousiasme le sultan mais Michel-Ange comprend que " Turcs ou romains les puissants nous avilissent ", que la mort frappe pour exorciser cette jalousie que l'oubli et la fréquentation des plaisirs terrestres auront du mal à dissiper. Trahi par ce pays qu'il ne peut pas comprendre et où il sera toujours un étranger, abandonné comme un paquet encombrant, c'est sans le sou et en secret, qu'il repart vers l'Italie qui lui manque tant.
Qu'est ce qui a poussé Michel-Ange dans cet intermède oriental ? L'appât du gain, l'envie de voir autre chose, la vanité d'être sollicité par un personnage puissant pour réaliser quelque chose qui était destiné à traverser les siècles, la volonté de se venger d'un pape mauvais payeur, la consécration de son génie précoce alors qu'il était boudé dans sa propre patrie ? L'auteur s'approprie des événements historiques et des moments de la vie du sculpteur florentin pour tisser cette histoire passionnante dont il nous fait seuls juges [" Pour le reste, on n'en sait rien " précise-t-il]. Il prête à son sujet un désir de revanche, une période de doute, d'exaltation, de découverte du merveilleux et de l'inconnu, d'expériences, de soif de reconnaissance, de foi dans les mirages, de recherche d'autre chose qui ressemble à l'enfance perdue, comme cela arrive à chacun d'entre nous... Dès le livre ouvert, il l'exprime en termes poétiques " La nuit ne communique pas avec le jour. Elle y brûle. On la porte au bûcher, à l'aube. Et avec elle ses gens, les buveurs, les poètes, les amants... Je ne sais quelle douleur ou quel plaisir l'a poussé vers nous, vers la poudre d'étoile, peut-être l'opium, peut-être le vin, peut-être l'amour; peut-être quelque obscure blessure de l'âme bien cachée dans un replis de la mémoire... Tu habites une autre prison, un monde de force et de courage où tu penses pouvoir être porté en triomphe; tu crois obtenir la bienveillance des puissants, tu cherches la gloire et la fortune. Pourtant quand la nuit arrive tu trembles. Tu ne bois pas, car tu as peur; tu sais que la brûlure de l'alcool te précipite dans la faiblesse, dans l'irrésistible besoin de retrouver des caresses, une tendresse disparue, le monde perdu de l'enfance, la satisfaction, le calme face à l'incertitude scintillante de l'obscurité... Alors tu souffres, perdu dans le crépuscule infini, un pied dans le jour et l'autre dans la nuit" .
C'est un livre agréable à lire, tout en nuances, plein de moments poétiques intenses et bienvenus. Il évoque autant le personnage de Michel-Ange que cette cité mythique où le lecteur se promène avec ravissement. Il est le témoin privilégié de ce rendez-vous manqué entre l'homme de la Renaissance et l'Orient.
Actes sud. Prix Goncourt des lycéens 2010
© Hervé GAUTIER n° 477 - Novembre 2010
 ATSCAF Fédérale
ATSCAF Fédérale